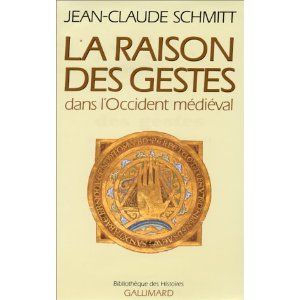Il est des livres d'histoire qui ne se laissent pas saisir aisément, non par le nombre, la complexité des faits et des phénomènes qu'ils s'attachent à décrire – c'est là le vice trop courant des manuels – mais parce qu'ils proposent un objet d'étude tout à fait inédit. En plaçant le geste au cœur de ses interrogations, Jean-Claude Schmitt ne travaille pas seulement en historien, mais également et c'est là tout l'intérêt de son livre, en anthropologue, suivant l'ornière déjà fort accusée de Marcel Mauss et sa réflexion sur les Techniques du corps. C'est une plongée dans l'épaisseur culturelle d'un Moyen Âge très largement entendu, mordant tout à fait sur les premiers siècles de l’ère chrétienne, un livre pensé non comme une étude exhaustive sur le geste, mais comme un programme dont il importait d'établir les premiers jalons.
Dès l'introduction l'ambition est d'ailleurs clairement affichée de ne dresser ici aucun catalogue, ni d'adopter de démarche purement descriptive, mais de poser plutôt un questionnement général :« Qu'est-ce que faire un geste au Moyen Âge ? Comment et par qui les gestes furent-ils non seulement accomplis, mais pensés, jugés, interprétés, classés ? À travers eux, quels modèles culturels, quelles attitudes à l'égard du corps, quelles conceptions des rapports sociaux se sont exprimés ? » Large problématique donc, tant qu'on redouterait de s'y perdre, si Jean-Claude Schmitt ne s'empressait de borner l'enquête à ce qui lui est matériellement possible, c'est-à-dire pour les époques qui l'intéressent, à une certaine morale du comportement et des attitudes, une « éthique » du geste pensée et construite par les autorités du temps. Ce choix, qui n'a rien d'arbitraire, ce sont les sources qui le motivent – situant l'observateur sur le balcon des élites – à savoir un large corpus de traités politiques et théologiques, et surtout les figures innombrables qui en ornent les manuscrits, celles encore qui animent les tympans des églises ou les coffres de reliques, car La Raison des Gestes, et c'est une des grandes forces de l'ouvrage, fait une large place à l'iconographie, abonde en images que l'historien observe, commente, interprète avec une impressionnante acuité. C'est en fait tout à la fois un livre sur le geste et sur l'image qui en restitue la forme, le mouvement, le signe.
Et quel n'est pas l'effroi du lecteur lorsque, confronté à l'omniprésence des images, il prend conscience de la diversité des gestes qu'elles recèlent, l'herméneutique dérobée à celui qui n'en saisit plus les codes ! C'est ici la paumée du chevalier, la main divine ordonnant aux anges le massacre des païens, celles du possédé nouant à ses fripes des phalanges sanglantes, celles encore de la veuve penchée sur la tombe, cueillant en perles ses larmes au défunt, la croix signée au front de l'orant qui conjure le mal, honore les saints, bénit le pain et le vin de l'eucharistie, la psalmodie du moine sous la plombe des arches, les farces de l'acteur, l'extase mystique. Foisonnement anarchique de gestes qu'une littérature religieuse a tenté d'encadrer dans un idéal de tempérance, la modestia qu'elle bût d'abord à la coupe de Cicéron, son héritage antique, puis versa à l'édifice imposant de la théologie morale, « tenace mépris du corps » irrigant depuis Saint Augustin l'ethos du clerc et sa conception du péché. Dans la prière d'Hildegarde de Bingen, les sermons de Saint Bernard, les traités d'Hugues de Saint-Victor, c'est elle, cette discipline partout martelée qui fonde et constitue selon son ordo la dignité de l'homme d'église, du seigneur laïc, de l'humble croyant. Tendus vers un absolu de concorde et d'harmonie, les membres du corps sont sommés d'obéir au geste qui lui est approprié en toute mesure, trouver l'équilibre qui caractérise aussi, à des degrés supérieurs, celui du cosmos, de l’Église, de la société chrétienne, expressions déclinées d'une même universitas.
Toute extravagance, débordements frénétiques du corps pavent ainsi la voie au péché, trahissent parce qu'ils en sont mécaniquement issus les désordres de l'âme qui les commande. Sous la plume des théologiens revient souvent d'ailleurs le contre-modèle de l'histrion et sa « gesticulation imitative », orgueilleuse, lascive, extravertie, dont l'abbé souhaite préserver ses jeunes novices, le maître ès arts ses écoliers. Paradoxalement, ces règles prescrites avec tant de rigueur éclairent aussi en négatif une société plus libre qu'on ne croit, donnant volontiers de l'ouvrage aux censeurs patentés : « Bien que bridé par la morale et le rituel, jamais le corps ne s'avoue vaincu ; plus se resserre sur lui et sur les gestes l'étau des normes et de la raison, plus s'exacerbent aussi d'autres formes de gestualité ». Dans les drames liturgiques qui s'épanouissent au XIIe siècle, les réjouissances cathartiques du carnaval, jusqu'à François d'Assise tordant sa silhouette au pied de l'Alverne, les membres percés des stigmates, dans les arts théâtraux enfin qui ravissent un Saint Bonaventure, un Thomas d'Aquin, la morale du geste craque dans toutes ses jointures, cède à de multiples et continuelles transgressions. L’Église elle-même en sape parfois les bases, lorsque forte d'une raison nouvelle, celle aristotélicienne qui culmine au XIIIe siècle dans toutes les universités d'Europe, elle toise d'un mépris neuf les ordalies, les miracles, les pratiques magiques, le culte des saints. Ne réduit-elle pas alors sans le savoir l'efficacité symbolique des gestes du prêtre consacrant l'hostie ou distribuant les sacrements ? Supplanté par les mots qui seuls opèrent la transsubstantiation, évincé par l'écrit qui seul règle les rapports de droit entre les individus, le geste ne perd-il pas de sa superbe ? Ce sont là certainement les plus belles pages du livre, un livre qui – je dois le reconnaître – est impossible à résumer tant il aborde de pans différents de la société, mais reste passionnant de bout en bout.