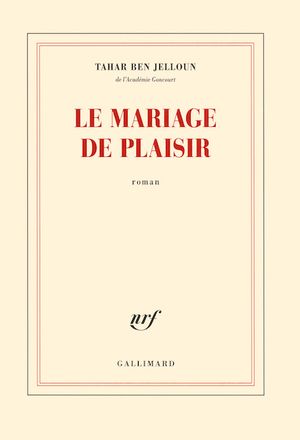Il paraît qu’on est tous « le con de quelqu’un »… mais de façon plus explicite et certainement plus rude, on oublie pourtant que l’idée associée est le sentiment de supériorité des hommes vis à vis d’autres hommes. « Tous les marocains sont africains mais tous les africains ne sont pas marocains », réflexion qui interroge nos oreilles occidentales et que Tahar Ben Jelloun met en évidence dans son livre pourtant débordant de tendresse, d’amour et de délicatesse. Il souligne la distinction entre noirs africains et blancs marocains, opposant la tolérance et l’acceptation de l’homme pour ce qu’il est, aux préjugés d’un temps qui subit son ignorance. Et c’est là un problème fondamental qu’il serait bon de garder en mémoire : le racisme n’a pas de frontières. Il est ancré au plus profond de l’homme lui-même, de son humanité, de son intégrité, et il finit toujours par refaire surface. Le Mariage de Plaisir publié cette année chez Gallimard nous conte la tolérance dans un monde nuancé, qu’on ne peut résumer en noir et blanc pour ainsi dire. Le récit se colore d’Histoire, de spiritualité, de philosophie et surtout d’humanisme, et met ainsi en évidence l’omniprésence d’un racisme presque inconscient, qui n’offusque que ses victimes dans ce Maroc encore sous protectorat à la veille de l’indépendance.
C’est dans ce contexte que se déroule cette histoire, dans la ville de Fès où la mentalité des habitants semble figée dans le passé. Là-bas, tout se sait un jour où l’autre, les rumeurs vont bon train entre voisins et commerçants et le hammam est l’école de la vie, et ce, surtout pour les femmes, qui sont encore dominées par un patriarcat indéfectible des mœurs de l’Islam. C’est là que vivent Amir et Lalla Fatma, mariés depuis une vingtaine d’année plus par tradition que par amour. Eux et leur quatre enfants sont considérés comme des gens honorables, qui suivent les principes du prophète et respectent les lois sunnites… peut-être, le jeune Karim mis à part, identifié comme un handicapé mental. Le petit souffre effectivement de problèmes d’élocutions et de relations sociales, mais ses parents le protègent de leur amour et c’est ce qui lui suffit à s’épanouir. Son regard sur le monde est dénué de toute appréhension, il voit le bon en tous, mais ressent le mal comme personne. Pour son père, il est un don de Dieu, « le rayon de soleil » qui unit sa famille, d’une pureté rare à choyer et préserver des maux de leur époque. Ce marchand de tapis est peut-être un peu naïf, mais c’est un bon musulman au cœur généreux et juste. Seulement de temps à autres, pour faire prospérer ses affaires, il doit effectuer un long voyage jusqu’au Sénégal pour quelques mois où il se fournit en nouvelles étoffes… mais pas seulement. Ce n’est pas pêché aux yeux du prophète de contracter un mariage de plaisir avec une femme sur place pour ne pas être tenté par la débauche, n’est ce pas ? Non effectivement c’est son droit, et il ne se prive pas de soulager ses tension dans les bras d’une noire sculpturale, instruite et débordante de curiosité et de tendresse : Nabou. Avec elle, Amir découvre des sentiments qu’il ne pensait exister que dans les romans. Et ramener une seconde épouse au foyer pour légitimer un amour, le prophète le permet-il ? Oui, une fois encore, mais les habitants de Fès apparemment pas. Évoluant dans une société peu marquée par les différences, ils méprisent les noirs. « L’esclavage » se perpétue dans l’intimité des maisons ou le racisme est couronné, et Nabou devra payer le prix de son amour pour son homme par les marques de mépris, parfois même de dégoût, et de supériorité que lui lancent chaque jour les marocains « blancs ». Là-bas, elle apprend qu’on ne plaisante pas avec les convenances ! Son dernier recours, pour prouver à la première épouse et à ses enfants qui cherchent à la chasser qu’elle va rester, c’est de faire un enfant à Amir… Oui mais voilà, comment réagir quand, sur les jumeaux qu’elle met au monde, l’un naît immaculé et l’autre portant la couleur de la terre ?
Nous avons tous peur de ce que nous ne connaissons finalement pas, ou trop mal, et c’est le drame de la différence et son lot d’inconnu. Ce drame, c’est Hassan, l’enfant noir qui devra le porter après Nabou, sa mère, et comme un héritage non dissimulable et lourd de conséquences, il le transmettra à son tour à son fils, Salim. A travers ces trois générations qui se succèdent au fil des 260 pages, l’auteur nous dépeint l’évolution, à peine perceptible au XX° siècle, du racisme au Maroc au fil des décennies, dans cette saga familiale détonante, quoi qu’un peu courte. On peut émettre ce regret, dans ce récit qui éblouit par sa justesse, mais dont on voudrait en voir plus. Les trois histoires nous laissent sur notre soif de connaissance, et on en ressort avec l’impression déroutante d’avoir lu le résumé de ce qui aurait pu être un grand livre.
« Il était une fois », c’est ainsi que commencent tous les contes, et celui ci ne déroge pas à la règle, entraînant le lecteur dans une histoire mise en abyme par un sage berbère sans âge. C’est peut-être cette particularité qui explique la parcimonie de dialogues au profit d’un récit au discours toujours plus rapporté, alors que les pages se succèdent en dévoilant peu à peu que la trame principale n’a finalement pas de héros : le personnage principal de ce livre, c’est l’idée.
« Tu sais, un vieux sage disait qu’il faut rendre grâce à Dieu d’avoir inventé le cheval, sinon, les Blancs auraient utilisés les Noirs comme monture. L’homme a de tout temps aimé humilier les autres, surtout les pauvres, les gens sans défense. C’est ainsi. L’esclavage a été une horreur et ça continue dans certains pays, pas de manière officielle, mais déguisée. Les Marocains ne se sentent pas africains parce qu’ils ont la peau blanche ». (Page 53 : de Amir à Karim).