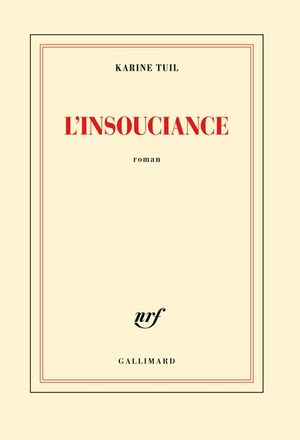Si vous vous arrêtez à la quatrième de couverture de ce livre, vous ne
saisirez pas la complexité infiniment bien tissée par l’auteur de toutes ces
intrigues entrelacées sur la toile de fond du monde d’aujourd’hui. Comme
Zola (entre autres), qui nous a permis de percevoir la réalité sociale du XIX°
siècle, Karine Tuil (entre autres), permettra aux lecteurs à venir de mettre un
pied dans notre époque, parce que c’est véritablement là, la force de son
talent. Elle a ce don de transmission propre aux Grands ; mettre au jour les
mécanismes les plus tendus et sous-entendus. Ici, ceux de la vie sociale de
personnes qui ne veulent se percevoir et n’être perçues qu’à travers leur
statut, mais que le monde ramènera a la réalité.
Dans cette vaste fresque sociale et politique émergent quatre
personnages dont les destins s’entremêlent :
– Francois Vély, 51 ans, bien assimilé parce qu’ancien Lévy qui refuse de
porter la charge de mémoire qu’implique la connotation trop juive de ce
nom de famille trop lourd, et son histoire qui ne le concerne d’ailleurs pas,
mais il se cache derrière un « souci d’intégration à la société française,
d’assimilation- de réinvention, peut-être ». Il allie charisme, richesse et
pouvoir, et incarne l’exemple typique de la réussite sociale au sein d’une
méritocratie plus forte que jamais. Enfin, jusqu’à la faute publique…
– Marion Decker, sa femme qui l’est plus par raison que par amour. Elle est
écrivain, journaliste, issue d’un milieu particulièrement défavorisé, elle est
fière d’avoir pu se hisser jusqu’aux sommets reluisants de la bonne société,
mais craint parfois de trahir ses valeurs et son éducation au nom de son
attachement à « sa zone de confort ». – Romain Roller, lieutenant de l’armée française dont le corps est revenu
indemne de « l’enfer afghan », mais l’âme beaucoup moins. Perdu quelque
part entre une vision brutale de la vie qu’il a perçue là-bas, et une vision
policée et convenue qu’on lui impose ici, Romain s’accroche à chaque lueur
de beauté pour sortir de son traumatisme et, dans le cas présent, incarnée
par Marion, avec laquelle il va vivre une passion interdite. Survivre lui
impose-t-il nécessairement de trahir ses engagements vis à vis de sa famille
et de sa fonction ?
– Osman Diboula, fis d’immigrés ivoiriens et parvenu à contourner le cursus
scolaire habituel pour briller dans l’entourage du président de la
république. Son école fut celle de la rue, de la vie, des violences des
émeutes, et ses qualités oratoires l’ont aidé à se faire remarquer et à gagner
sa place, presque au même titre que les autres. Osman sera le lien entre les
sommets de l’Etat et la banlieue, un « médiateur social », mission qui le
ramène inlassablement vers l’univers dont il essaie de s’extraire. Et s’il
n’était là qu’au nom de la diversité ?
L’insouciance est un texte utile qui met en évidence les paradoxes de
notre époque. Il est possible que le titre puisse interloquer. Quelle insouciance
pourrait demeurer sur fond de guerre et de crispations identitaires ? On a le
sentiment que l’ironie est bordée de cynisme, et pourtant… Pourtant ce titre
est honnête, parce qu’on y lit la lutte pour cette insouciance, de la part de tous
ces personnages en guerre. Oui, l’homme est capable de la guerre, et c’est ce
qui est terrible, parce que cela semble en chacun : Osman pour être
socialement reconnu. Marion entre ce qu’elle est, la vie qu’elle voudrait avoir
la force de choisir et la facilité fade de son quotidien. Romain, la guerre des
hommes, des armes, des corps, la vraie, et celle de l’amour. François, en
guerre entre son identité ancestrale et celle qu’il s’est forgée. Le lecteur est luimême
en guerre, partagé entre la reconnaissance de ces cruautés et l’envie de
les refuser et de croire encore à l’insouciance.
La plume de Karine Tuil ne fait aucun cadeau, elle est de fer et ses mots
sont d’acier, mais il n’aurait pas pu en être autrement, et cela ne gêne
aucunement la fluidité du rythme et de la narration. Si le lecteur parvient à
tourner les pages du premier chapitre, alors il parviendra jusqu’à la 525°
page, et ce roman l’habitera pendant longtemps, et probablement chaque fois
qu’il regardera les informations ou sera attentif aux phrases des anonymes
dans la rue. Même une fois refermé, ce livre continuera de vivre et de grandir
au sein des lecteurs qui l’auront accepté.
Je ne peux pas mentir, c’est un très beau livre, un très bon livre, et
même un chef d’œuvre, mais il est dur, et personne ne peut sortir indemne de
cette lecture. La morale peut paraitre pessimiste : on regarde autour de soi et
on se demande à quoi ça sert, parce que c’est très réel. La vie y est crue, y est
dure, les moments de bonheur ne sont pas majoritaires, on n’est pas dans le
happy ending, c’est piquant, on est dans la réalité brutale et glissante,
mordante et insatiable de ce XXI° siècle mangeur d’homme, mais ce lot de
souffrance et de douleur de l’être humain parait nécessaire et même capital,
justement parce que c’est humain, et parce qu’on peut écrire ce genre de
roman et l’intituler l’Insouciance.
« Dans notre société, tout est vu à travers le prisme identitaire. On est assigné
à ses origines quoi qu’on fasse. Essaye de sortir de ce schéma-là et on dira de toi que
tu renies ce que tu es ; assume-le et on te reprochera ta grégarité. » Osman.
Pour aller plus loin :
http://www.europe1.fr/culture/karine-tuil-a-contre-pied-delinsouciance-2832226
: « Le réel m’intéresse. C’est une matière littéraire
formidable. Moi, j’adore l’actualité, je suis une passionnée de l’information. Raconter
notre société dans un roman, c’est un défi, c’est un enjeu important. L’ambition,
c’était ça : écrire un roman social qui aborderait les grandes thématiques qui nous
agitent aujourd’hui ». Karine Tuil.