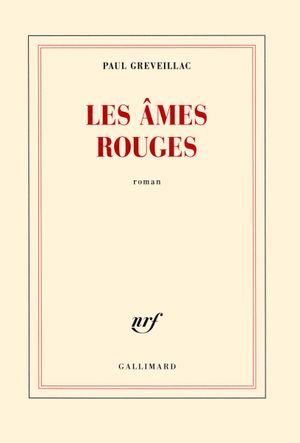Paul Greveillac ne manque pas d’air ! 35 ans, français, premier roman et voilà qu’il prétend raconter 40 ans d’histoire soviétique sur 400 pages, en choisissant par dessus le marché un angle apparemment assez connu et traité : celui de la censure littéraire en régime totalitaire. Inutile de dire qu’en commençant son livre, je l’attendais au tournant, sûr que l’auteur compenserait son éloignement vis à vis du sujet par un ton forcément grandiloquent, ou ses lacunes par quelques pleurnicheries mal assorties. Eh bien... quel plaisir parfois de se tromper si grandement !
En fait, le roman de Greveillac est étonnant à plus d’un titre, en commençant par la façon très déstabilisante dont il est écrit. Il faut un peu d'abnégation pour rentrer dans le style dépouillé de cette narration kaléidoscopique, qui tout en choisissant la carte de la déception parvient néanmoins à entrainer le lecteur patient toujours plus profond dans le récit de ces âmes damnées, rouges non de passion brûlante mais de passion éteinte, fragiles braises qui finissent par mourir par manque de combustible. Les deux personnages principaux sont pris à la sortie de l’adolescence, encore vibrants de toutes leurs illusions révolutionnaires : l’un est amoureux du cinéma, l’autre de la littérature, et les deux se sont enrôlés au coeur d’une machine à broyer les hommes : le Goskino pour le premier, le Glavlit pour le second, les deux organes chargés de contrôler la production artistique en Union Soviétique. Et la vraie surprise est là : réunir autant d'éléments romanesques dignes d'Aragon ou de Pasternak, pour les traiter de la façon la plus anti-romanesque qui soit.
Il faut dire que l'auteur a la bonne idée d'avoir choisi comme toile de fond (une toile de fond qui devient finalement le personnage principal, un ogre aveugle et destructeur dans lequel s'empêtre aussi bien les têtes brulées que les lâches, les malins que les faibles) les années post-staliniennes, ce lent glissement qui conduit de Khrouchtchev à Gorbatchev, années qui ont toujours moins intéressé les auteurs que celles d’avant-guerre. Choix qui parait étrange à première vue, mais qui permet à Greveillac à travers trois décennies de plus en plus trouées, rapiécées, moisies le portrait tout en nuance, mais sans relief aucun, de la désillusion et de l’échec . Double échec, d'ailleurs, à la fois d’un idéal et d’un système totalitaire qui s’effondre de lui-même, sur lui-même, non sans entrainer dans sa chute des millions de victimes plus ou moins innocentes.
Goutte à goutte, mot à mot, on assiste à cette lutte absurde où tous, artistes contestataires comme bureaucrates zélés, semblent se débattre contre une destinée implacable autant que dérisoire, qu'ils ont eux-même crée et ne savent plus arrêter. "Quel que soit le côté qu’on a choisi, à quoi bon lutter" semblent se demander les deux héros qui regardent, comme sonnés, cette course contre la montre, racontée comme un film au ralenti. Ils ont beau être aux premières loges, ils ne savent rien de ce qui se déroule dans leur pays, ne comprennent rien à ce qui se passe dans le monde. Même eux qui croisent les trajectoires et les oeuvres de Tarkovski, de Soljenitsine, de Grossman, de Zinoviev et cie, demeurent totalement impuissants face à la ruine et à la désolation qui frappent leurs concitoyens, et qui finissent par les réduire à néant également. Chronique désespérante, les Âmes rouges n’est certes pas un livre aimable, mais beaucoup mieux, car plus profond : un livre désespéré.