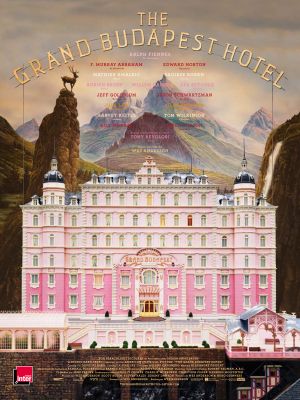Si la vie était bien faite, Wes Anderson se ferait écraser demain par un bus. Ou bien recevrait sur le crâne une bûche tombée d’on ne sait où qui lui ferait perdre à la fois la mémoire et l’envie de faire du cinéma. Pour finir en beauté, avec ce Grand Budapest Hotel en guise de testament.
C’est qu’enfin tout y est, à sa place, les engrenages tournent sans grincer, mécanique subtile et malicieuse, qui ne cherche même pas à se dissimuler puisque de la voir fonctionner si bellement fait partie du plaisir. Mais alors ? Et si chaque film jusqu’ici n’avait été pour Anderson qu’une expérience sur un point donné, comme ces virtuoses qui peuvent répéter mille fois le passage d’une note à l’autre pour s’assurer un doigté parfait : la fantaisie de la Vie Aquatique, les histoires intriquées de Tenenbaum, l’exotisme de Darjeeling, les stratégies de Mister Fox, les fugues et les fuites de Moonrise Kingdom, dessinent soudain les pièces d’un puzzle qui s’assemblent sous nos yeux écarquillés. Au bout de toutes ces années de tâtonnements, Wes est prêt : une main de fer dans un gant de velours, le spectacle peut commencer.
Et quel spectacle ! A pousser aussi loin son obsession du tableau parfait, des détails foisonnants et réglés au cordeau, à reléguer dans les limbes le monde tel qu’il est pour ne montrer que ce qu’il aurait dû être, Anderson risquait de se prendre un mur en pleine figure. Ou bien de réussir le pari le plus magique du cinéma : nous faire, pour quelques dizaines de minutes, redevenir petit enfant. Parler à cet être apeuré et triomphant, fragile et tête à claque, boudeur, capricieux, écorché vif, rêveur, idéaliste, généreux, naïf, qui se cache au fond de nos entrailles, n’acceptant ni de partir une bonne fois pour toute, ni de faire la paix avec nous. Certains créateurs l’étouffent, d’autres l’ignorent, il en est qui cherchent à l’éduquer, à l’endormir, à le brusquer, à le culpabiliser. Quelques uns même à force de tours hypocrites et de poses mercantiles tentent de lui parler d’une voix mielleuse pour mieux le violer. Wes non. Equilibriste casse-cou, toujours sur le fil prêt à casser qui sépare le ridicule du poétique, l’artificiel de l’enchantement, il jongle en le regardant, cet enfant. Dans les yeux, comme pour lui dire sans parler : viens, j’ai compris. Tu vas rire et pleurer, courir, sauter, trembler ou frissonner, t’essouffler, t’esclaffer, te bâfrer, jusqu’à l’étourdissement, pour que te revienne le gout de cette chose si douce : l’insouciance. Si douce et si cruelle, puisque pour s’épanouir pleinement, elle ne peut naître qu’au coeur des pires brasiers.
Pour arriver à ça il faut, plus que le talent je crois, la grâce. Cette chose délicate et incompréhensible, qu’on ne peut ni acheter ni vendre. Ni expliquer, ni transmettre, ni reproduire. Peut-on même la garder ? Ça m’étonnerait… L’avenir nous le dira. Si la vie était bien faite, Wes s’arrêterait là. Mais si la vie était bien faite, le cinéma n’existerait pas.