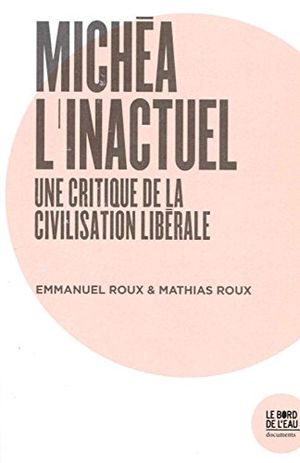C’est à une exégèse pointilleuse que se livrent Emmanuel et Mathias Roux dans cet ouvrage présentant les idées phare de la pensée de Jean-Claude Michéa. Divisant l’œuvre du penseur montpelliérain en deux parties (la généalogie philosophique du libéralisme et la généalogie politique de la gauche), ils passent en revue quelques principes fondamentaux : la décence ordinaire, la triple obligation de donner, recevoir et rendre, l’impératif des limites, la double pensée, etc. Regrettant la diabolisation subie par Michéa à gauche en général et dans les cercles universitaires en particulier, ils reviennent sur les critiques portées contre lui par Frédéric Lordon, Jean-Loup Amselle et quelques autres et démontrent leur insuffisance ou leur inanité. Seule la critique d’Anselme Jappe, fondée en partie sur la théorie de la valeur, trouve une certaine grâce à leurs yeux. « La façon qu’a Michéa de tourner en dérision les militants de gauche en démontant certains mots d’ordre des nouvelles radicalités alimentées par les manies déconstructivistes, ou sa manière sacrilège de jeter, dans une note expéditive, l’œuvre du “naïf” Bourdieu dans les poubelles de la “sociologie d’Etat” ont de quoi attirer le rejet d’un “milieu” déjà peu portée à la bienveillance. »
Pour le reste, les auteurs encouragent Michéa à poursuivre dans la voie d’un socialisme démocratique d’inspiration orwellienne (le seul capable de transformer immédiatement les rapports sociaux en rapports humains) et invitent le philosophe à tourner la page des polémiques contre la gauche et à passer à un stade plus constructif qui lui permettrait de « penser ensemble tradition civique et tradition socialiste tout en continuant d’assumer une partie de l’héritage de Marx ». L’époque s’y prête particulièrement à l’heure où « la gauche est moribonde électoralement mais son fond idéologique perdure à travers le parti du président Emmanuel Macron, qui semble porter la nouvelle synthèse du droit (la protection individuelle) et du marché (la réalisation de soi dans la prise de risque et l’entreprenariat) ».
Le chapitre portant sur ce que les auteurs pensent être des tentatives de récupération par la droite de la pensée de Michéa est un peu moins convaincant – on sourira en lisant que le socialisme michéen nourrirait « la nouvelle jeunesse d’Alain de Benoist, vieil intellectuel de droite en pleine opération de recentrage idéologique » – et s’explique en partie par l’obstination qu’ils ont à vouloir, envers et contre tout, coller à Michéa une étiquette de penseur de gauche. Mais à cette réserve près, on saluera avec ce livre une synthèse sérieuse, la plupart du temps honnête et d’un haut intérêt philosophique.