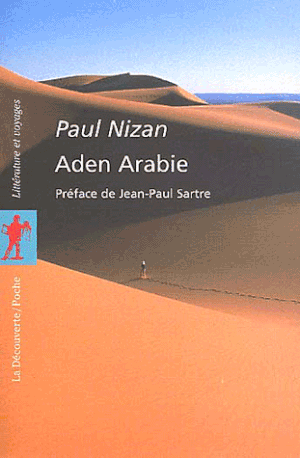Oui c’est à la fin qu’il rétablit une lutte de classes de pantins, qu’il érige d’ailleurs sur une scène de théâtre avec les figures forcément caricaturales du banquier et de l’ouvrier. Mais tout au long du livre, au contraire, il est dans une sorte d’ambiguïté très intéressante….
Je le préfère quand il dit qu’il n’y a vraiment plus d’air nulle part, ni à Paris ni au Yémen, quand il lui devient tout à fait certain que partout les hommes s’ennuient, et quand désespéré d'être seul il finit par dire “Il faut faire quelque chose pour les objets”.
J’aime aussi quand il critique les rêves des européens mous du slip qui s’illusionnent l’Orient comme un grand purgatoire, et le voyage à l’est comme le plus sûr chemin vers le salut pour échapper à la décadence du vieux monde. Et pourtant ! Pour le reste il est un bourgeois désoeuvré. Il nous fabrique son Orient à lui : un monde d’ouvriers, de manoeuvres, de marins et de capitaines authentiques parce qu’affairés dans la spontanéité de leurs métiers ; bienheureux parce que fondus dans la vie immédiate et concrète. Mais ces gens, ces chargés de besognes, ces serviteurs il les observe de trèèèès loin ; il l’avoue d’ailleurs : il décide de vivre avec les européens - les maîtres à abattre ! Reportées à demain les amitiés fraternelles avec les dominés ! Et là, bim ! il retombe dans les délices faciles de l’introspection de soi propre au voyageur. Et il nous entretient avec passion de l’abandon des anciennes habitudes et de la plénitude des gestes retrouvés une fois arrivé à Aden… Non mais. Alors oui, c’est toujours un peu comme ça les bourgeois - et les intellectuels - repentis : l’amitié sans amis, la fraternité avec des frères de papiers dont on loue l’authenticité mais qu’on tient fermement à distance. Pourtant il y a quelque chose dans ce livre, comme si son dernier chapitre n’était qu’un petit cri ridicule de révolte poussé du haut d’un immense haut-le-coeur…