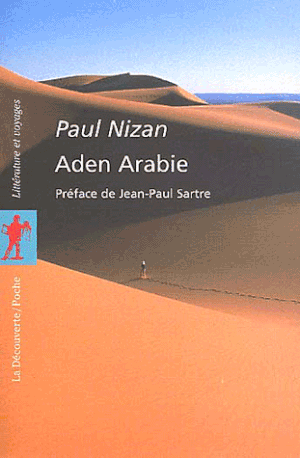Ce court récit s’est retrouvé entre mes mains par hasard : on me l’a conseillé, ses premiers mots (« J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. ») faisant écho aux miens. Et, en effet, il aurait pu s’agir d’un ‘grand livre’ dans ma vie, mais, pourtant, ça n’est pas vraiment le cas. Les tonalités sont bien celles que j’affectionne : sarcasme et polémique, qui naissent tout à la fois d’un découragement que d’une dénonciation énergique. C’est pourquoi ce livre relève autant de l’analyse introspective que d’un (discret) pamphlet politique ; mais il y manque, à mes yeux, un aiguillon de passion : allumer l’incendie à ses propres mots et y brûler tout entier.
Paul Nizan prend le parti de la froideur clinique pour subvertir le récit de voyage qui, finalement, se révélera n’être qu’un récit de retour comme le souligne les références à Ulysse. D’ailleurs, l’auteur n’hésite pas à se moquer du lyrisme des voyages littéraires en refusant presque systématiquement la poésie à ses descriptions. Ainsi, les paysages disparaissent rapidement derrière ce qui intéresse véritablement le narrateur : les hommes. Ce livre prend alors une tournure analytique franche tout en restant du côté de l’expérience vécue : le jeune locuteur nous livre ses observations sur un Aden purement économique, sans dépaysement, où l’homme est le même partout, à la différence près que le désert le dépouille de ses illusions.
Ainsi, cette expérience prend une allure politique franche, s’inscrivant dans les revendications communistes de l’auteur (qui était membre du PCF). D’une certaine manière, l’appel virulent au combat s’entremêle au désenchantement existentiel de l’homme de vingt ans, qui étouffait de l’intellectualisme phraseur et du pessimisme ambiant, et qui constituait la cause de son départ à Aden. Même si Nizan s’en défend, son engagement politique est indissociable de ses réflexions abstraites : effroi devant l’homme vidé, mort avant d’avoir vécu, rejet des discours abstraits au profit des actions réelles, dénonciation de la puissance anémiante des possédants.
Je suis dans cette position de faire la guerre pour être complètement délivré de la peur qui m’atteignit comme une flèche, jusqu’en Arabie, quand j’avais le droit de me croire dans un lieu écarté et enfin pacifique.
Mais c’est précisément cette contradiction, une introspection pleine et assumée malgré l’engagement politique impersonnel que j’aurais aimé lire, d’autant plus que la préface de Sartre laisse entrevoir chez Nizan une fièvre passionnée… En fin de compte, le narrateur va au bout des conséquences de son choix en refusant de faire de sa rage nouvelle un remède à la désespérance.
Quoiqu’il en soit, ce récit demeure un livre appréciable, où la sensibilité affleure sans jamais noyer la narration, où les observations sociales et politiques sont édifiantes et peuvent encore résonner aujourd’hui.