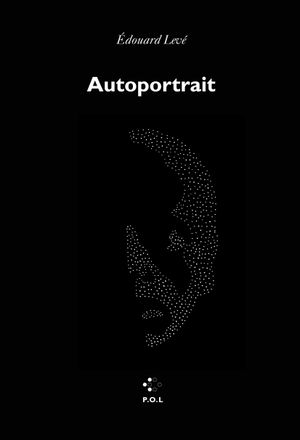De Levé, j’avais lu Suicide, il y a quelques années. Je n’en ai pas gardé de souvenir bien net. J’y ai retrouvé une allusion, page 90. J’ai trouvé Autoportrait nettement plus marquant. D’une façon générale, j’aime assez bien les textes à contraintes. J’ai assez vite compris celle qui régit ce livre, n’écrire qu’un seul paragraphe en utilisant la première personne du singulier dans chaque phrase. J’écrirai des paragraphes.
J’ai ri à certains passages : « À la radio, j’ai capté une émission où une femme pleine d’esprit racontait des anecdotes désuètes, ce n’est que lorsque l’interviewer a nommé son interlocuteur que j’ai compris qu’il s’agissait de Jean d’Ormesson » (p. 65-66). À beaucoup d’autres, je me suis pris à songer, plus ou moins loin : « Quand j’ai faim, j’ai l’impression d’être maigre » (p. 31). J’ai fini par m’attacher à Édouard Levé mais je le trouve parfois très rive gauche, ou dandy, ou snob, ou de quelque façon que je doive appeler quelqu’un qui écrit « J’aime achever une tâche à l’heure, c’est-à-dire lorsque la grande aiguille de la montre est sur douze » (p. 71). J’ai été surpris de trouver un point d’interrogation dans Autoportrait : « Tout ce que j’écris est vrai, mais qu’importe ? » (p. 82).
Je ne lis pas pour ne plus avoir à lire, alors qu’Édouard Levé écrit : « J’écris peut-être ce livre pour ne plus avoir à parler. » (p. 27-28). J’ai trouvé que par certains aspects, il me ressemblait beaucoup, mais que par d’autres aspects je n’avais rien à voir avec lui. Moi aussi « En me contredisant, j’éprouve deux plaisirs : me trahir, et avoir une nouvelle opinion » (p. 30). Mais je ne trouve pas qu’il pratique la contradiction, plutôt le paradoxe. « Je ne suis spécialiste de rien. J’ai d’autres sujets de conversation que moi-même » (p. 41).
Dans cette critique, je donne peu d’exemples de points communs entre Édouard Levé et moi mais il y en a beaucoup. Je défie n’importe quel lecteur de ne pas trouver dans ces quelque quatre-vingt-dix pages moins de cinquante phrases qui ne puissent pas s’appliquer à lui. J’ai beaucoup aimé le fait que certaines enchaînements constituent de très grands coqs-à-l’âne J’aime moins que d’autres phrases s’enchaînent avec fluidité : « Je m’étonne que mon écriture manuscrite se soit figée à un certain âge, seize ans je crois, et que depuis, elle n’évolue plus. Je me suis inventé une signature à l’âge de treize ans, sans penser que j’aurais la même toute ma vie » (p. 55-56). J’ai adoré quand deux phrases consécutives se répondaient en écho : « Je n’ai pas la nostalgie de mon enfance, de mon adolescence, ni de la suite. J’ai la tentation de faire des listes exhaustives, et je m’arrête en cours » (p. 35).
Je ne pensais pas apprécier un auteur qui écrit : « En poésie, je n’aime pas le travail sur la langue, j’aime les faits et les idées. » (p. 44). Je pense que tout le monde pourrait dire « Ma mémoire est structurée comme une boule disco » (p. 90) et je me demande ce que vaut la notion de miroir dans tout ça. Je trouve à la fois étrange et vrai d’écrire « Quinze ans est le milieu de ma vie, quelle que soit la date de ma mort » (p. 91).