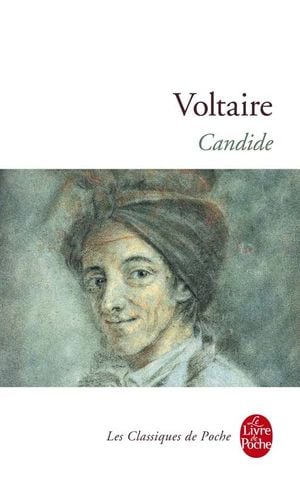Au bout de trois lectures, j’ai enfin apprécié Candide. En comprenant mieux la mentalité de Voltaire, ses opinions et sa vie, la lecture de Candide évoque plus de choses intéressantes.
Le texte est très agréable à lire, l’écriture est maitrisée et certains passages sont très drôles (alors qu’il va se faire ébouillanter et déguster par des cannibales qui le prennent pour un jésuite, Candide lance à Cacambo : « Ne manquez pas de leur représenter quelle est l’inhumanité affreuse de faire cuire des hommes, et combien cela est peu chrétien. »).
L’histoire est rocambolesque, parfois à la limite de l’absurde, mais les rebondissements incessants et la brièveté des chapitres permettent de tenir le lecteur en haleine.
« Candide » est aussi intéressant philosophiquement, car il présente un grand nombre de visions du monde : Pangloss est un optimiste leibnizien radical, Jacques l’anabaptiste est rousseauiste, Martin est pessimiste et anticipe Schopenhauer. Les revendications des Lumières sont toutes présentes, de l’éloge des sciences à la critique de l’absolutisme royal, en passant par la dénonciation du règne de l’Eglise et de l’esclavage.
En revanche, quelque chose m’a semblé étrange : alors que Voltaire et Rousseau étaient farouchement opposé, tant sur le plan matériel (richesse, lieu de vie, fréquentation) que sur le plan des idées (religion, valeur de l’homme), il m’a semblé que la conclusion de Candide donnait raison à Rousseau. « Cultiver notre jardin », c’est revenir aux choses simples, être proche de la nature, pratiquer le travail humblement : exactement ce que prêchait Rousseau.