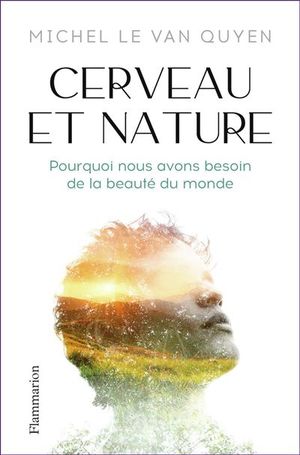Après le premier confinement, tous les indicateurs de la santé psychologique ont montré que près d’un tiers des Français vivait une situation de détresse.
Alors qu’il était confiné dans son appartement parisien, le neuroscientifique Michel Le Van Quyen a décidé de creuser cette question devenue centrale à l’heure où la pandémie entamait sensiblement notre liberté de mouvement « Pourquoi avons-nous tant besoin de la nature pour aller bien ? »
Michel Le Van Quyen intègre en 1987 Sup Télécom Bretagne afin de travailler dans l'industrie, en tant qu'ingénieur. Mais c’est la science qui l’intéresse et il a la chance de rencontrer le neurobiologiste chilien Francisco Javier Varela qui va diriger sa thèse de doctorat et le former à la neurobiologie.
Michel Le Van Quyen a développé des méthodes mathématiques pour rendre intelligible le cerveau qui a une dynamique très complexe et chaotique, et permettre l'identification de certaines lois cachées, en particulier dans le domaine de l'épilepsie. En 2000, il a intégré l'INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale) à l'hôpital de la Salpêtrière. En 2010, il a rejoint le nouvel Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) à la Salpêtrière où il dirige un groupe de recherche.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont :
- Les pouvoirs de l’esprit – Transformer son cerveau c’est possible ! (2015)
- Améliorer son cerveau – Le vrai pouvoir des neurosciences (2017) (2019 Poche)
- Cerveau et silence - Les clés de la créativité et de la sérénité (2019) (2021 Poche)
- Cerveau et nature - Pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde (2022)
Monsieur Le Van Quyen est très sérieux, son livre est très sérieux. Il m’arrive, ci-après, de déraper et de ne pas être "très sérieux", c’est ma nature…
Poètes et sentimentaux, abstenez-vous de lire ce livre, et même, ce commentaire !
Alors, pourquoi ce besoin de « nature » ? La réponse serait simple : la nature nous « ressource », elle « infuse en nous son énergie »…
Attention aux fantasmes culturels. C’est le mythe d’un « état de nature » (Rousseau), d’une nature innocente et bonne qui remonte au début de notre histoire.
Dans notre civilisation de la consommation à tout va, la mode du retour à la nature peut pousser à des comportements excessifs dans lesquels marchands et industriels se sont précipités et pour remplacer la nature lointaine, on achète Bio, local, végan et on se fait chouchouter à prix exorbitant dans des centres de naturopathie situés en plein Paris.
Mais comme le précise l’auteur, indépendamment de la sincérité discutable de ces comportements, le bien-être éprouvé grâce à la nature est bien réel. Nul n’est besoin d’aller jusqu’en Sibérie ou au Tibet pour s’exposer à des paysages régénérants (tel notre ami Sylvain Tesson). J’en veux pour preuve le bien-être apporté par la contemplation quotidienne (lors de la vaisselle journalière) de mon olivier-perchoir-à-oiseaux planté devant ma fenêtre de cuisine, pendant le confinement de 2020. Privilège considérable eu égard aux occupants d’un deux pièces-cuisine-sur-cour, bloqués chez eux !
Alors, ça vient d’où ? C’est écrit dans nos gènes ! Homo sapiens a un passé vieux de 300 000 ans dans la nature alors qu’aujourd’hui 70 % de la population mondiale vit dans les villes, et que cet exode rural date de moins de 200 ans : « Notre environnement a brutalement changé, passant du vert au gris, mais pas notre cerveau. »
Comme avec mon olivier, les malades, à l’hôpital, récupèrent mieux lorsqu’ils occupent des chambres donnant sur un paysage naturel. De même chez les personnes incarcérées, celles occupant des cellules avec vues sur un cadre verdoyant sollicitent moins de demandes de soins.
Je vais vous faire une confidence, vous connaissez "Lireaulit" ? Ce gentil membre qui nous charme avec ses chroniques enflammées, généralement enthousiastes, primesautières et lyriques, marque d’une humeur joyeuse et d’une santé rayonnante. Oh, ce n’est pas elle qui va s’angoisser au sujet du Grand Vide intellectuel, supposé, de ses "petits" contemporains. Eh bien, elle affectionne particulièrement les randonnées pédestres dans la campagne et elle en fait profiter tout un chacun : elle photographie aussi bien qu’elle écrit ! Et, sur Instagram, on peut la suivre dans ses périples campagnards ou forestiers et admirer ses splendides compositions qui fleurent bon la nature normande, et s’imprégner d’une paix bienfaisante.
Bon, on la laisse à son bonheur innocent ou on fait intervenir Michel Le Van Quyen ?
Avec ses gros sabots, il va lui expliquer que, dans ses adorables petits chemins creux forestiers, l’atmosphère est particulièrement riche en « phytoncides », un mélange de particules organiques, odorantes, émis par les arbres : terpénoïdes, pinènes, bornéol, linalol, limonènes… (comme c’est poétique !) Autant de molécules qui protègent les végétaux cotre les attaques par de bactéries ou de champignons nuisibles, un vrai bain d’« antibiotiques naturels ». Mais ce n‘est pas tout, les phytoncides agissent sur une zone cérébrale proche de celui des émotions (lorsque « ça sent bon » le circuit de la tranquillité et du bien-être est activé). Les phytoncides ont une action directe sur le système parasympathique qui régule les fonctions de régénération et de détente du corps… et sur le système sympathique qui réagit au stress… et encore, je ne vous parle pas du bénéfice sur le système immunitaire dont il multiplie durablement les cellules NK (« tueuses naturelles » ou Natural Killers) !
Vous croyez qu’elle a conscience de tout ça, notre marcheuse-photographe, dans ses bois ? Je pense que non, mais elle s’y sent bien et elle nous le fait savoir !
Ô toi, Sulfure de Diméthyle, fait nous rêver !
C’est quoi ce truc ? Encore une drogue hallucinogène qui nous vient d’outre-Atlantique ?
C’est presque gagné : ça peut venir de l’Atlantique, ça peut provoquer des images-souvenirs… Voilà, vous y êtes, « une bonne odeur d’iode » … sauf que l’iode est parfaitement inodore, et, très prosaïquement, ce qui nous fait entrevoir des Golfs clairs où l’on voit danser la mer, le sulfure de diméthyle, n’est autre qu’une molécule issue de la décomposition des algues et du phytoplancton par une bactérie… pas très onirique, en effet !.. Et les fines gouttelettes des embruns, chargées de sulfure de machin-truc, s’engouffrent dans nos fosses nasales et activent directement le cerveau via la muqueuse olfactive qui contient les prolongements de millions de neurones… et c’est parti pour le Grand Jeu psychédélique qui va, suivant l’âge et la personne, du château de sable au Vendée Globe, du plateau de fruits de mer à l’ascension du Cordouan, ou tout simplement du bruit des vagues au cri des mouettes... une sacrée pirouette de notre hippocampe !
Et alors ? Alors, notre cerveau programmé depuis la nuit des temps pour guetter et réagir à un danger immédiat se calme devant l’image d’un golfe clair… En résumé : « La proximité de la mer favorise la santé mentale. » Et vous pouvez faire confiance à l’auteur, il est breton !
Et à part ça ? À part ça, il m’arrive souvent d’être complètement largué (ou sceptique). C’est qu’il va loin, notre ami Michel, depuis les bienfaits du bain – qui n’a jamais apprécié un moment de détente dans sa baignoire ? –, mais pas n’importe lequel, en remontant au liquide amniotique (vous vous souvenez, sans doute, des tous premiers mois de votre vie qui expliqueraient notre attirance pour l’eau. Et ceux qui n’aiment pas l’eau, étaient-ils en "cale sèche" ?…), en poursuivant par le « sentiment océanique » et la « flottaison thérapeutique ». Il donne le sentiment de « racler les fonds de tiroirs » des hôpitaux psychiatriques pour trouver des arguments, Michel.
On continue avec la lumière. La lumière bleue, tout d’abord, celle du ciel bien sûr, pas celle des écrans. Et la vue de l’aube qui nous met de bonne humeur, juste avant l’apparition du Soleil, en allant titiller le « noyau suprachiasmatique » qui va sécréter l’hormone qui annonce que la lumière paraît (debout là-dedans !) réglant l’horloge circadienne (la montre connectée de Sapiens).
Bon, aller, c’est l’été, vous êtes en vacances, c’est relâche, chassez les contraintes et comme l’a chanté le poète, "prenez le temps de vivre, d’être libre, sans projet et sans habitude…" En un mot, prenez-vous en main pour ne rien faire…
Ah ! Vous croyez que ça va se passer comme ça ? Vous avez oublié "la montre connectée de Sapiens" ? Elle, elle ne vous a pas oublié. Pas plus que clock, tim, bmal ou cry ! Qu’est-ce que c’est ? Des gènes horlogers ! Et oui, on a même ça dans nos cellules et qui régissent la sécrétion d’hormones : « Ainsi, la mélatonine […] commence à être sécrétée en milieu de soirée […] Au contraire, le cortisol est produit juste avant le réveil, au matin […] En début de nuit, c’est le moment privilégié, par exemple, de l’hormone de croissance… » Et je ne vous parle pas de « l’horloge alimentaire » qui vous dit que vous avez faim et qui met en branle le système digestif, ni des autres horloges qui régulent la température du corps, la circulation du sang et même la pousse des cheveux !
Alors, "farniente" ?
Nous y voilà ! Début du chapitre 9. « Croiser le regard d’un animal ». Photo en gros plan sur les yeux d’un primate (gorille ?), sous-titre : « Le regard d’un primate nous subjugue, car il illustre à sa façon que singes et humains ont quelque chose en commun. » Et c’est vrai que ce regard-là est troublant, interrogateur, je dirais même inquisiteur, triste aussi, un rien menaçant, presque humain.
Impossible de résister à une anecdote perso récente : j’attendais d’être servi, dans un magasin et j’avais devant moi un client qui tenait en laisse un chien de petite taille, de ces chiens au museau écrasé que, personnellement je ne trouve pas très beau. Il était particulièrement excité, ne tenant pas en place, tournant la tête de tous côtés, jusqu’au moment où… il a planté ses yeux dans les miens et s’est figé sur pur place. J’aime les chiens, en général, et les regarde toujours avec curiosité et affection, mais là, c’est la première fois, en quatre-vingts ans que j’ai vu un tel regard, une telle intelligence, un regard absolument humain, je n’aurais pas été surpris qu’il me parlât. Une présence à couper le souffle ! N’en déplaise à Monsieur Buffon…
Cela dit, vous aimez caresser votre chat ou votre chien, il est content, et vous aussi, vous procurant un sentiment de bien-être. En étant bien terre à terre disons que ce geste va permettre l’augmentation de la sécrétion d’endorphine, une hormone antistress et diminuer celle du cortisol, l’hormone du stress.
Mais il y a une autre hormone qui apparait quand… on croise le regard des animaux de compagnie (Ah, tient !), l’ocytocine.
Sécrétée par l’hypothalamus quand nous éprouvons de l’empathie pour quelqu’un (l’hormone de l’amour). Il semblerait qu’avec les chiens, ça marche dans les deux sens :
https://www.letemps.ch/sciences/une-dose-chimie-entre-chien-maitre
J’ai comme l’impression, qu’avec le petit chien, ci-dessus, nous avons eu… un coup de foudre !
Mais ce qui me trouble, pour autant que je me souvienne, c’est que ce jour-là, je portais des lunettes de soleil…
Contempler le ciel… Là, il y a quelque chose que je ne pige pas. Mes connaissances en astronomie (ma passion) sont des plus primaires, j’en suis resté au modèle standard de la cosmologie qui inclus la théorie du Big Bang (https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Bang ), et au rayonnement fossile ou Fond diffus cosmique dont la découverte fut récompensée par le Prix Nobel de Physique en 1978 et qui établit historiquement la preuve du Big Bang.
J’avais cru comprendre que ce rayonnement provenait de la naissance de l’univers et que son décalage vers le rouge permettait de déterminer son origine à il y a 13,8 Milliards d’années. Or, l’auteur parle d’astres dont on reçoit la lumière et qui seraient situés à … 45,6 Milliards d’années-lumière ! Autrement dit des astres trois fois plus anciens que l’univers… Mes compétences ne me permettent pas de débattre. Si quelqu’un peut m’éclairer, avec des mots simples, je suis preneur.
Alors oui, contempler le ciel… Je ne sais pas quelle hormone nous sécrétons à la vue d’un ciel étoilé – Michel reste muet sur ce point – mais pour ma part, je regrette de ne plus pouvoir le faire, ou du moins, de ne plus pouvoir contempler le ciel de mon adolescence. À l’époque (fin des années 50) j’habitais une maison coiffée d’une terrasse sur les hauteurs proches de Périgueux (pas particulièrement réputée pour être une ville-lumière) où je m’installais, certaines nuits d’été, pour me plonger dans le ciel. Ce furent les dernières fois où je pus admirer, à loisir, la Voie lactée, le ciel n’étant pas pollué. J’avais 17-18 ans et le sentiment de mon insignifiance devant l’univers ne m’a jamais quitté, comme le souligne l’auteur : « Le plus tragique est peut-être que non seulement l’homme n’est rien face au cosmos, mais que, en retour, le cosmos ignore même son existence, au sens où il est strictement indifférent à sa présence. »
Sauf que je ne trouve pas cela tragique du tout, ayant définitivement accepté ma petitesse au sein d’un univers indifférent.
Malheureusement, nombre de mes contemporains n’ont guère évolués depuis Aristote et Ptolémée et sont restés bloqués sur un géocentrisme qui flatte leur égo, en plaçant l’homme au centre de l’univers, mais au nom duquel on ne cesse de s’entretuer.