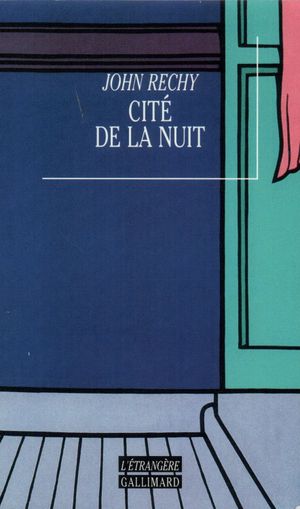Retrouvailles avec John Rechy après ma lecture de Numbers qui remonte à un an ou deux : j’ai lu cette fois Cité de la nuit, premier roman au parfum de scandale sorti en 1963.
Bien sûr on ne s’étonnera pas qu’un récit qui suit les pérégrinations d’un jeune prostitué dans des bars gays et des lieux de drague en plein air ait choqué l’Amérique des années 60. Mais on est pourtant encore loin, dans City of Night, du sulfureux Numbers dont le héros s’engageait, un peu comme un personnage de Selby, dans une spirale infinie, obsessionnelle et auto-destructrice de sexe avec des inconnus. Pour un peu, City of night paraîtrait sage, savamment construit qu’il est dans une alternance de chapitres focalisés sur un personnage rencontré par le narrateur au fil de son errance, dans lesquels John Rechy livre une série de portraits souvent très émouvants qui restituent une société des marges pas forcément moins hostile à ceux qui sortent du moule ni moins viriliste que celle qu’elle tente de fuir, et de chapitres plus kaléidoscopiques montrant le tourbillon des nuits de New-York, Chicago et Los Angeles, ces villes qui semblent n’en former qu’une, vaste cité tentaculaire et glacée constamment plongée dans l’obscurité.
Mais si les deux romans sont bien différents dans leur tonalités, bien plus mélancolique ici que dans le nerveux et solaire Numbers, ils mettent en scène deux (anti)héros quasi identiques, qu’on devine aisément être des doubles de l’auteur, engagés dans une course sans fin, sans objet autre qu’un narcissisme absolu érigé en muraille infranchissable entre soi et les autres. Culminant dans les scènes de carnaval de la Nouvelle-Orleans, lieu absolu de l’inversion et du désordre, Cité de la nuit ne propose pas plus d’issue que Numbers - les clés, trop profondément enfouies du côté de l’enfance, restent hors de portée, et la tentation de se dissoudre dans la foule et le tumulte est trop grande.