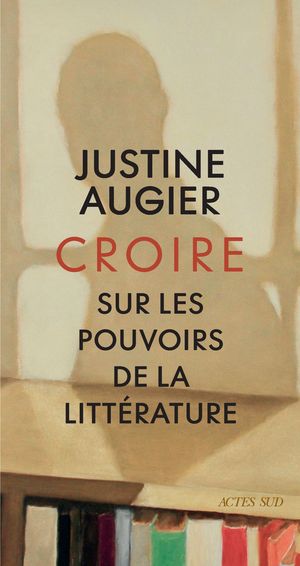Ce livre est un petit miracle. En 130 pages, Justine Augier écrit trois livres : un retour sur ses deux livres consacrés à des martyrs de la révolution syrienne (De l’ardeur et Par une espèce de miracle), un tombeau sublime à sa mère, la femme politique Marielle de Sarnez, jamais nommée, et une réflexion sur les mo(r)ts et la littérature. L’autrice ne compare pas du tout l’enfermement de l’avocate syrienne Razan Zaitouneh avec l’hospitalisation de sa mère, ni la lutte contre un régime dictatorial et la lutte contre une leucémie : le seul lien, et pas des moindres, c’est le langage. La littérature.
La littérature redonne au temps sa texture, l’épaissit, convoque les fantômes, ceux d’avant et ceux qui viennent, et cette conversation à laquelle toujours elle nous fait revenir demeure pleine d’espoir. Les livres ne provoquent pas de révolutions mais ils nous travaillent, longtemps et d’une façon mystérieuse (L’influence poétique est très lente, c’est une affaire d’accumulation, Mahmoud Darwich), ils résistent en nous, forcément engagés sous le règne de l’immédiat. Ils nous relient à l’histoire, creusent, […] raniment en chacun les disparus et les possibles, relancent notre imagination, font scintiller ce qui a été sauvé des ruines et traverse le temps. (p. 23-24)
Razan Zaitouneh croyait au pouvoir des mots pour décrire un réel devenu insoutenable, documenter les atrocités et crimes du régime al-Assad. Marielle de Sarnez croyait en la littérature comme ouverture sur le monde. Toutes deux croyaient en sa capacité à changer le réel. Justine Augier, dans un geste intertextuel sublime, convoque ses écrivain·es, les cite parfois longuement (Ernaux, Darwich, Beauvoir, Barthes, Didion…) et ses souvenirs pour les faire (re)vivre encore un peu – ou pour l’éternité. Voilà un des pouvoirs imprescriptibles de la littérature : ressusciter les morts, converser avec les fantômes. Comme d’autres écrivain·es du deuil avant elle, Augier cherche le fantôme de sa mère dans les livres, des indices que cette femme puissante et lumineuse qu’elle a fui autrefois pour se construire aurait laissés pour elle :
Un an pendant lequel ma foi en la littérature s’est confondue avec une forme de folie, découvrant des liens partout, fiévreuse, cherchant sur la page sa présence, forçant les échos, cherchant à adosser mon chagrin, recopiant des passages entiers pour m’y accrocher et ne pas tomber. (p. 117)
L’autrice fait le portrait sublime de Marielle de Sarnez, figure mystérieuse de la droite centriste antichiraquienne, inventeuse des t-shirts « Giscard à la barre » de 1974 (quand même, respect !), habitée par une foi profonde de l’Europe et de la littérature. Elle ne s’épargne pas quand elle raconte à quel point leurs divergences d’opinion ont pu la conduire à être violente envers sa mère, et on pleure avec elle quand elle réalise que celle-ci lui a légué les deux piliers de sa vie, quoique sous des formes différentes : la littérature et l’engagement pour la liberté.
À la fin, Justine Augier lit l’unique livre que sa mère a écrit, elle qui se rêvait écrivaine. Ses derniers mots pour sa fille furent : « Merci pour tout ma chérie ». Croire n’était pas encore écrit, mais on devine que Marielle de Sarnez avait pressenti l’importance et la beauté inouïes de ce texte littéraire.
Dans le livre, elle fait le récit de son enfance de lectrice, confie la manière dont les textes lui ont permis de s’échapper, de s’affranchir et surtout, écrit-elle, de se rassembler. Et je me dis que c’est sans doute là le pouvoir de la littérature auquel on finit toujours par revenir : elle fait tenir ensemble. (p. 127)