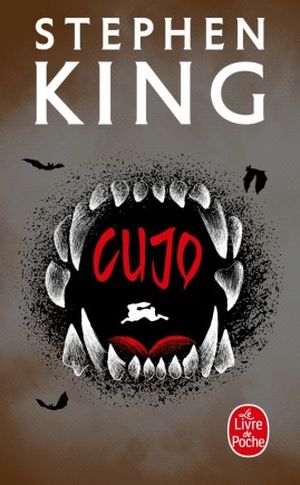Continuant de fouiller la monstruosité humaine, après Charlie, Stephen King publie Cujo où, si la menace émane bien d'un chien enragé, les protagonistes affrontent en grande partie leurs démons intérieurs en se débattant contre l'effroi glaçant et paralysant qui les y fige. Premier roman de l'auteur que j'ai lu à l'aube de mon adolescence, et qui m'avait profondément marqué de par cette
maîtrise millimétrée du suspense
qui fait la trace permanente de l'écrivain, j'avoue avoir été un poil déçu de ces retrouvailles presque vingt-huit ans plus tard. La faute en revient certainement à mon imaginaire d'une horreur et de frayeurs développées depuis ce petit pavé initial, qui s'est enrichie depuis quand le livre, évidemment, n'a pas bougé d'un iota. Pour autant, force est de reconnaître que Stephen King, encore jeune, sait merveilleusement poser l'ambiance étouffante d'un décor estival où le vent ne souffle pas afin de laisser peser l'ombre suspendue d'un drame que l'on sait inévitable et qui, tardant à venir, dilate le temps de la narration en creusant toujours un peu plus profondes les angoisses et les impatiences du lecteur. Mordu dès les premières lignes, enfiévré, insidieusement.
Au-delà de ce chien enragé, Cujo c'est avant tout l'histoire de deux couples qui se croisent sans se voir ni se reconnaître mais dont les errances se confrontent à distance. Deux couples parents chacun d'un fils et qui se débattent avec leurs angoisses - ces monstres tapis dans les recoins de leurs existences - pour survivre aux exigences du quotidien.
Le monstre avait disparu, le monstre était mort. (...) Mais les
monstres ne meurent jamais. Les loups-garous, les vampires, les
goules,les créatures innommables venues d'immensités perdues. Les
monstres ne meurent jamais.
D'un côté Donna et Vic Trenton souffrent de leur exil de New York au calme du Maine, se perdant l'un l'autre par ignorance sous la pression des difficultés professionnelles et de l'ennui qui guette ; d'un autre côté, Charity et Joe Camber survivent d'une misère intellectuelle qui ronge doucement les espoirs de vie meilleure de leur garçon, propriétaire du chien malade.
Deux histoires qui se font étrangement écho
à travers le désespoir de ces deux épouses perdues dans ce moment de leur vie qui les pousse à rêver d'autre chose que de leur morne solitude conjugale. Au cœur de cette petite bourgade isolée du Maine, Castle Rock, que l'auteur sait si bien dépeindre de ses habitants à la banalité si proche, si palpable, les personnages principaux se débattent là face aux monstres qui les accablent jusqu'à les laisser presque morts, inertes, les uns face aux autres.
Tout le temps elle s'était dit que la situation s'améliorerait quand
Tad serait plus vieux ; le fait de découvrir qu'il n'en était rien la
plongea dans l'effroi. (...) Dès qu'il était parti, la maison semblait
atrocement vide. L'embrasure des portes ouvertes baillait sans Tad
pour la remplir ; la cage d'escalier béait quand Tad ne se trouvait
pas assis sur une marche, sa culotte de pyjama à demi descendue, en
train de dévorer intensément un livre d'images. Les portes étaient des
gueules, l'escalier une gorge. Les chambres vides devinrent des
pièges.
Là sont les monstres de Donna : dans l'insupportable vide qui se répand autour d'elle quand elle se retrouve seule entre les quatre murs d'une maison isolée loin du bourdonnement agréable de ses anciennes habitudes citadines. Comblée du bonheur d'être mère, elle se retrouve perdue face à l'absence conjuguée de son enfant qui grandit et de son mari qui lutte pour sauver son entreprise de publicité. Elle erre donc, et trébuche dans les ornières des chemins de traverse que l'angoisse met là sous ses pas. Consciente, elle lutte, sombre avant de se ressaisir, se confesse, tente de retisser les liens piétinés, cherche l'absolution. Entre espoir et résignation, ses hésitations illustrent avec véracité
les combats anodins que chacun mène au quotidien
entre les envies spontanées, déraisonnables, et les limites à ne surtout pas franchir pour conserver son intégrité et continuer de se regarder fièrement dans le miroir. Consciente d'être faible, elle ignore sa force autant que sa rage de préserver les petits bonheurs qui lui paraissent de vaines illusions.
La panique est venue lorsque j'ai commencer à regarder les bibelots
ou à penser suivre des cours de poterie, de yoga ou autre. Quand on
fuit l'avenir, on ne peut plus se réfugier que dans le passé.
Ou comment se retrancher sur soi-même quand on ne sait plus comment communiquer à ceux qu'on aime ses regrets, ses désillusions et ses hésitations : reprendre confiance en soi passe alors malheureusement par la mise en péril de son intégrité, à ses propres dépends.
En parallèle, Charity Camber doute tout autant de son mariage et, paralysée par la peur d'un époux rustre et casanier aux penchants alcooliques qui laissent s'exprimer ses résidus de violence, reste tout aussi muette face à ses propres aspirations. Charity aspire pour son fils à une liberté qu'elle-même n'hésite pas à sacrifier, soumise à l'emprise de son mari, fidèle et sans réels projets personnels autres que
ce dévouement maternel instinctif
où elle trouvera, avec un peu de chance, la force d'envisager de s'émanciper pas à pas.
Elle n'avait rencontré la chance qu'un instant fugitif, aussi
merveilleux et magique qu'une danse de conte de fées exécutée à
l'aurore sous un gros champignon couvert de rosée... qu'une seule
fois, la dernière fois. Elle éprouva donc un serrement de coeur en
voyant disparaître le billet, malgré les insomnies qu'il lui avait
causées.
Boule de stress instable, autant que Donna, autant que Cujo quand la rage aura fini d'annihiler sa raison, Charity n'entreprend l'usage de sa liberté que précautionneusement, tiraillée par les terreurs palpables du quotidien et les incertitudes quant aux réactions de son mari. Son quotidien l'oppresse et elle reste longtemps cet animal malade qui ne vit que dans la réaction plutôt que d'agir, et reste alors incomprise aux yeux de ses proches. Jusqu'à effrayer son fils en cherchant à le protéger.
Brett se redressa, légèrement effrayé par la violence de Charity. Il
ne se rappelait pas avoir déjà vu sa mère se comporter ainsi. Cujo
lui-même, couché sous le porche, baissa les oreilles.
Ainsi ce sont les allers-retours de l'une à l'autre qui laissent déambuler
les monstres dans les espaces lâches de leurs errances et de leurs appréhensions tues.
Ce que nous raconte alors Stephen King, c'est que ces monstres ne prennent vie que parce que nous les laissons s'installer durablement, que nous les nourrissons de nos inactions et de ces angoisses que nous ne savons, et ne pouvons, surmonter seuls.
Derrière la force ignorée de ces deux héroïnes, l'auteur s'attache à dépeindre les faiblesses dérisoires d'hommes trop enfermés dans leur logique ou trop habités par leurs obsessions pour comprendre ce qui se joue autour d'eux. De ces hommes qui ne gardent comme part d'enfance que celle de la terreur et de l'effondrement et qui passent leur temps à remplir ce vide pour ne pas le voir, ne pas avoir à l'affronter. Préférant ignorer les monstres justement que d'accepter leur présence pourtant toujours palpable, insistante.
La porte ne se rouvrit pas. Vic la contempla longuement, songeant
aux impasses. Pas beaucoup de circulation dans les impasses. Tous les
monstres devaient vivre sous les ponts, au fond des placards ou au
bout des voies sans issue. Ce devait être écrit dans la Constitution.
Et dans leurs pas, incertains, l'innocence relative des fils :
Comme la plupart des enfants, il sentait les vibrations qui
émanaient de ses parents, il connaissait la façon dont les courants
d'air évoluaient d'un jour à l'autre, comme un vieux guide connaît les
moindres des détours d'un cours d'eau de montagne.
Stephen King a toujours eu
le sens des émotions humaines et la clairvoyance de l'intelligence enfantine.
Charlie était un manifeste de cette confiance dans les générations futures, Cujo ne fait que reprendre cet énoncé pour renforcer les impressions d'errances et de gâchis maladroits auxquels se livrent les adultes. Valeurs perdues dans l'urgence du quotidien, rêves écrasés sous la chape des impératifs de responsabilités. Si les monstres cachés dans les placards des gamins prennent vie, c'est dans l'insécurité involontairement transmise dans ces hésitations et ces questionnements insolubles que l'enfant ressent à défaut de les comprendre : puisqu'il ne sait y mettre les mots lors qu'il les sent vibrer, l'image se fige dans ses terreurs nocturnes, yeux rouges, malades, et crocs acérés, la vie affamée de sacrifices insensés.
Le monde était plein de monstres qui avaient le droit de s'attaquer
aux faibles et aux innocents.
Un mot sur la bête tout de même, pour acclamer le talent de l'écrivain, capable de nous transporter dans l'esprit du chien avec une simplicité virtuose impressionnante. Des pages entières sont narrées du point de vue malade de ce Saint-Bernard en souffrance, à tel point qu'il ne devient le monstre de l'histoire que contre son gré. Que le lecteur, malgré
la terreur savamment portée au crescendo,
ne peut que compatir et se sentir longtemps plus désolé pour l'animal innocent que pour ces adultes pitoyables de faiblesses et de renoncements. Jusqu'à accepter à contre-cœur l'irrémédiable idée que toujours en vie, la pauvre bête n'est déjà plus qu'un chariot de mort lancé contre des victimes qui peut-être ne récoltent là que le vent qu'ils ont semé à l'abandon de leurs stupides certitudes.
La bête grognait, la gueule déformée par un rictus, l'écume
s'écoulant entre ses crocs en épais filets. (…) Les crocs se
refermaient à quelques centimètres du visage de la jeune femme et elle
respirait dans le souffle de la bête un monde de mort, de maladie
fatale, de meurtre aveugle.
La mort déchaînée sous la douleur ne cherche plus qu'à se répandre.
Un classique finalement des structures de Stephen King pour qui rien ne vaut la banalité des lieux familiers pour que l'irruption soudaine de l'horreur grogne ses terreurs :
Mauvaises nouvelles du Maine. (...) Charity Camber semblait avoir
vieilli en quelques secondes. Des rides apparurent autour de ses yeux.
Sa poitrine s'affaissa ; malgré le soutien-gorge, elle s'affaissa.
(...) quand on appartenait à cette terre, chaque jour apportait son
lot de mauvaises nouvelles. Vous finissiez par vous regarder dans une
glace et l'image que vous renvoyait votre miroir était celle de
Charity Camber. Et voilà qu'il arrivait encore de mauvaises nouvelles
du Maine, cette terre d'élection de toutes les catastrophes.
Sans m'avoir rapporté les frissons que je suais il y a presque trente ans, Cujo ne m'a pas laissé sur ma faim : Stephen King y excelle dans l'art de construire patiemment la tension et d'étirer le suspense en allers-retours d'études humaines. Ce qui m'échappait alors me saute à l'esprit aujourd'hui, et si l'ouvrage n'est certes pas son meilleur roman, rien n'y manque de ce qui fait la puissance d'une œuvre tournant autour des mêmes démons tapis dans
les errances rageuses de l'homme.
Sous les angoisses solides et persistantes de ces adultes incapables de s'approprier les bonheurs qu'ils vivent naissent les monstres au fond des placards de leurs enfants, et tout le talent saisissant de Stephen King a toujours résidé là. Après l'alcoolisme de Jack Torrance dans Shining, après l'impératif de fuite d'Andy McGee dans Charlie, ce sont les immobilismes et les abandons de Donna Trenton et de Charity Camber qui nourrissent la rage de Cujo.
Rassasié mais pourtant toujours affamé, je vais ainsi m'en aller planter mes crocs dans la tôle de Christine en espérant ne pas succomber à mes propres détours.