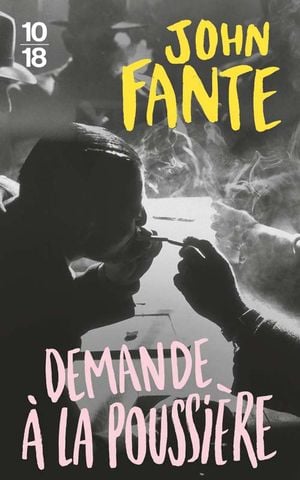Troisième opus du Quatuor Bandini, cycle des quatre romans autobiographiques de l'auteur, Demande à la Poussière c'est l'histoire crasse et désœuvrée d'un triangle amoureux dans la Californie des années trente à travers laquelle John Fante narre ses errances à la traîne d'une jolie fille toute entière dévouée à un autre. Errances qui s'impactent en miroir sur l'ardeur de ses écrits et les sentiments qui les habitent où les structurent : l'ouvrage déroule une balade en montagnes russes entre abandon de soi, dépréciation, dégoût et estime, chance et persévérance. Tous les efforts ne paient pas mais les récompenses qui surviennent, inattendues, gardent à travers la poussière d'avancées aussi déterminées qu'éphémères l'élan nécessaire à continuer.
À continuer malgré la misère insistante d'aimer, d'espérer, d'écrire, bref de vivre.
Arturo Bandini crèche dans un hôtel miteux de Los Angeles, se rêve écrivain à la mode, et traîne les rades pouilleux des quartiers où la grande dépression cultive la misère. C'est dans un de ces bouges qu'il repère Camilla, sensuelle serveuse au teint hâlé, et qu'il l'aborde, brusque, autoritaire et vindicatif. Elle est fière malgré l'indigence, hautaine et caractérielle : leur rencontre s'embrase de frictions, d'affrontements, de parades et de sentiments exaltés, violents. Elle en aime un autre, Sammy, le barman taciturne et désenchanté qui marche les derniers pas de son chemin, résigné à ne plus s'encombrer de rien ni de personne. Alors pour combler les manques, les frustrations, Arturo reprend parfois le fil de ses écrits, s'enrage sur une nouvelle, rêve de vendre un autre texte que celui qui l'a emmené jusqu'en Californie afin de s'assurer quelques mois de plus à l'hôtel, de beaux repas et de longues soirées abreuvées à la caresse des jupes de Camilla, entretient sa correspondance. Va-et-vient des espoirs aux déceptions, parcours solaire des grands espaces, des horizons, jusqu'aux impasses, le livre déborde de ce désenchantement austère et suranné qui semble envelopper l'Amérique de la Grande Dépression et se fait
témoin riche, poétique et suant du quotidien d'alors.
Le verbe de John Fante est celui franc, direct et argotique de la rue, de la pauvreté, de la sueur et des larmes : celui de la poussière. Un verbe qui s'emballe de colères, d'excès, d'embellies mais qui jamais ne triche, jamais ne cherche le beau puisqu'il n'y en pas à écrire. Les scènes heurtent, s'entrechoquent, se marchent les unes sur les autres, se dévorent ou s'oublient, toujours en déserrance même le repos fuit l'existence du jeune poète. Alors le lecteur est happé par l'urgence, par la passion autant que par la folie et le texte se fait longue descente d'ivresse livresque, un pavé de sueur et de sens éblouissant d'honnêteté autant que de fidélité contemporaine :
la poussière sans cesse soufflée déborde des pages,
déborde de l'ouvrage et vient s'insinuer, vorace, à l'impératif de cette épopée qu'on ne lâche plus.
Comprendre là que je découvre John Fante au hasard de cet axe autobiographique après avoir tant été happé par le verbe de ce maître annonciateur notamment de Bukowski est à la fois un indéniable plaisir autant qu'une petite frustration : l'emballement est telle qu'il me tarde maintenant de reprendre le cycle au début pour faire plus ample connaissance avec cet auteur hanté à l'urgence éphémère des désespoirs.