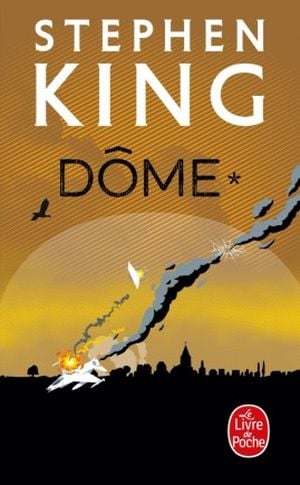Dans la lignée du Fléau ou des Tommyknockers, Stephen King revient avec Dôme à l’étude sociologique étendue au cœur d’un
long roman choral
en s’attachant à suivre une intrigue à travers une large multitude de points de vue : après les survivants continentaux d’une apocalypse ou l’invasion collective des esprits d’un petit village, c’est ici à Chester’s Mill, bourgade moyenne du Maine, que se situe l’intrigue, et ce sont ses nombreux habitants qui développent l’étude. De nombreux thèmes y sont abordés, de la dégradation de l’environnement au perversions religieuses, de la solidarité bienveillante et désintéressée à l’égoïsme ravageur d’un capitalisme débridé et des abus de pouvoir qu’il favorise, mais le point central du propos structure intelligemment cet ensemble disparate autour de
l’instauration douce et aveugle d’un fascisme impitoyable
et de son acceptation soumise, comme évidente et indispensable :
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de
sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux.
» disait Benjamin Franklin.
Un dôme invisible s’abat sur Chester’s Mill et enferme ses habitants, forçant une sécession involontaire de la petite ville vis-à-vis du reste du pays, et au-delà du monde. Comme à son habitude, Stephen King vient poser un élément perturbateur inexplicable, surnaturel, autour d’une population alors confrontée à ses propres démons, dévoilant peu à peu les réels caractères et les réels enjeux de personnages divers qui viendront doucement révéler ou se faire dévorer par leurs secrets les plus intimes. La valeur des narrations chorales du maître tient là, dans
la véracité des humanités qui se dispersent sur l’échelle morale,
jouant des zones grises pour souligner que jamais rien ni personne ne reste tout blanc ou tout noir. Ce que nous sommes – nos choix – ne résulte jamais que de cet incessant combat interne entre spontanéité et contrôle de soi, entre instinct et réflexion : l’intelligence n’est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qui fait de nous une espèce à part, capable du meilleur comme du pire selon que nous nous contentons de réagir dans l’instant ou que nous décidons de regarder, de comprendre et de nous projeter.
Dans ce premier tome, quelques personnages principaux, leurs qualités et leurs défauts, viennent illustrer cela dans une atmosphère de dégradation lente : l’angoisse et l’urgence accentuent les disparités, forcent la désagrégation de certains rapports ou l’intensification inattendue d’autres. Peu d’éléments fantastiques y impriment leur empreinte, l’auteur préférant largement s’attarder sur les comportements, sur l’humain et le réel. L’allégorie avec différentes situations politiques de par les époques et de par le globe s’affirme ainsi plus sûrement : l’opportunisme du second conseiller de la ville, Big Jim Rennie, ne découle pas de l’apparition du dôme mais s’en trouve simplement accélérée, favorisée, tandis que face à lui, le retour d’humanité du héros si discret, Dale ‘Barbie’ Barbara, se forge dans la compréhension, dans l’ouverture à autrui, dans ce qu’il avait sciemment abandonné avant l’événement afin de ne plus se retrouver en première ligne, cible sensible incapable d’en supporter davantage au risque de sombrer dans la folie et la haine la plus virulente. Le dôme devient, plus qu’un élément inconnu à comprendre, un principe de mise en lumière, la lentille d’un microscope qui vient mettre en évidence le pire – soif de pouvoir, envie, violence – comme le meilleur – solidarité et confiance, efforts d’ouverture et de compassion. Un élément aussi destructeur que salvateur : un élément révélateur, comme lorsqu’une photographie se fige sur une grimace de rancœur ou sur un sourire d’épanouissement. Tout l’art de façonner des personnages tangibles, une réelle patte de l’auteur, est là : cette impressionnante faculté de Stephen King à faire vivre ses univers.
Derrière tout ça, l’écrivain engagé dissèque
l’hypocrisie sociétale à l’œuvre dans nos sociétés occidentales
et plus particulièrement, évidemment, aux États-Unis. L’hypocrite ferveur religieuse des partisans du port d’armes et de la peine de mort, l’hypocrite manipulation d’un peuple maintenu dans la plus grande ignorance par l’ensemble d’une classe politique plus intéressée par ses propres intérêts que par celui de la communauté, l’hypocrite jugement de ceux qui jamais ne se regardent dans le miroir. Pas besoin d’aller chercher loin, tout cela est couché noir sur blanc au fil des pages de ce tome prenant et oppressant : magistrale peinture sociale où l’auteur excelle. Les personnages, aussi différents soient-ils, prennent tous vie de ces détails disséminés de leur parcours : de ce qu’ils vivent renaissent des souvenirs, s’éveillent des projections, et ainsi chacun prend le relief vibrant et toujours changeant, insaisissable semble-t-il, de ce qui fait de nous des êtres de chairs. Naturalisme, réalisme social, peu importe, Stephen King a l’art d’écrire le réel, de transmettre la réalité d’une époque ou d’une société jusqu’aux tréfonds de ses travers en gardant toujours le propos principal en ligne de mire. Ici la décadence irréversible de l’occident soumis à ce petit pourcentage de maîtres autoproclamés que la masse populaire laisse régner, abreuvée aux illusions de sécurité. Les dégâts environnementaux, la ferveur religieuse, la solidarité au quotidien : tout ça reste feu de paille sous la chape de plomb – ou d’épais verre invisible et impénétrable – d’un pouvoir lointain, abstrait et obscur. Aux motivations tout sauf altruistes. Même lorsqu’il se promène d’évidences sous nos yeux occupés ailleurs : ce que nous ne voulons voir ne nous empêche alors pas de dormir.
Un premier tome dense et intense au cours duquel Stephen King prend la mesure de
tout ce que l’homme est capable de sacrifier d’autrui pour sa survie individuelle,
Dôme pose les bases de l’installation insidieuse du fascisme là où l’homme cède toujours un peu plus de ses libertés jusqu’au point de non-retour, jusqu’à ce qu’il devienne impossible de faire marche arrière quand la conscience enfin s’éveille. Avec l’art magnifique d’emporter ses lecteurs en une transe inarrêtable, l’auteur américain retrouve le flot imposant de ses plus grandes fresques sociales, y décortique d’infinis aspects des faiblesses humaines et, au-delà du catalogue, nous immerge corps et âmes dans l’aventure en tentant de réveiller, violemment autant qu’intelligemment, les zombies aveuglés par l’éphémère du confort occidental et les mensonges des faux prophètes que nous nous sommes choisis. Nous alertant sûrement sur ce que nous y sacrifions.