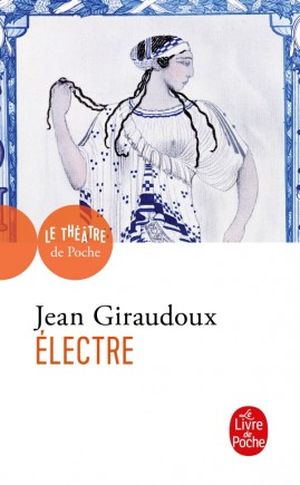Autant j’adore la plupart des tragédies classiques, autant j’ai un mal de chien à m’enthousiasmer pour les réécritures mythologiques des années 1930-1940 – en gros, Anouilh et Giraudoux. C’est accentué, dans le cas du second, par la teneur particulière que prennent, sous sa plume, diverses considérations sur la justice, l’honneur, la vertu, le courage… Par exemple quand, à la fin de l’acte II, une euménide dit : « Les redresseurs de torts sont le mal du monde. Et ils ne s’améliorent pas en vieillissant, je te prie de le croire. Alors que les criminels sans exception deviennent vertueux, eux, sans exception, deviennent criminels. »
Si je ne rechigne pas non plus à lire la Médée ou l’Antigone d’Anouilh, ou La guerre de Troie n’aura pas lieu ou, en l’occurrence, Électre, c’est parce que ces mythes sont suffisamment puissants pour soutenir à peu près n’importe quelle écriture. Mais – et ce serait peut-être plus vrai encore dans le cas d’Anouilh – ce théâtre a domestiqué les mythes. Pas au sens où le mythe serait une bête sauvage à laquelle il faudrait rendre l’homme tolérable : après tout le mythe est déjà, dans ce sens-là, l’objet d’une domestication – par le théâtre, par l’écriture, par la catharsis, par tout ce qu’on voudra… Mais dans la mesure où il transforme des enjeux d’État en enjeux d’intendance : on trouve dans l’Électre de Giraudoux un jardinier, un président et une vague histoire d’adultère petit-bourgeois. Il s’agit, j’ai bien compris, de montrer ce que les mythes – les situations vécues par les personnages – ont d’universel. (Et, dans cette pièce précise, de mettre en relief la figure d’Électre.) Mais les tragédies grecques, elles, les rendaient universels, et c’est toute la différence. (Peut-être que dans cinquante ans il sera temps de proposer des perspectives anthropologiques là-dessus.)
Le « Lamento du jardinier » qui tient lieu d’entracte – et qui, du reste, n’est pas la pire des trouvailles – est révélateur de cette esthétique selon laquelle le mythe se regarde lui-même, où le jardinier déclare « Moi je ne suis plus dans le jeu. C’est pour cela que je suis libre de venir vous dire ce que la pièce ne pourra vous dire. […] On réussit chez les rois les expériences qui ne réussissent jamais chez les humbles, la haine pure, la colère pure. C’est toujours de la pureté. C’est cela que c’est, la Tragédie, avec ses incestes, ses parricides : de la pureté, c’est-à-dire en somme de l’innocence. » Cette réflexivité du théâtre, en plus de faire son âge en 2017 – merci Pirandello ! –, tend à le désamorcer, à le rendre inoffensif. (On pourrait trouver des paroles qui insistent sur cette réflexivité dans la bouche de tous les personnages principaux. J’ai choisi le plus évident.) Ce n’est pas le théâtre de la cruauté, c’est le théâtre de l’affabilité.
Il reste, heureusement, de bons passages dans le texte – en particulier quand ils parlent de la tragédie sans en parler. « Et soudain vous en trouvez un [un hérisson], un petit jeune, qui n’est pas étendu tout à fait comme les autres, bien moins salement, la petite patte tendue, les babines bien fermées, bien plus digne, et celui-là on a l’impression qu’il n’est pas mort en tant que hérisson, mais qu’on l’a frappé à la place d’un autre, à votre place. Son petit œil froid, c’est votre œil. Ses piquants, c’est votre barbe. Son sang, c’est votre sang. […] Les dieux se sont trompés, ils voulaient frapper un parjure, un voleur, et ils vous tuent un hérisson… Un jeune… » (le mendiant, acte I, scène 3).