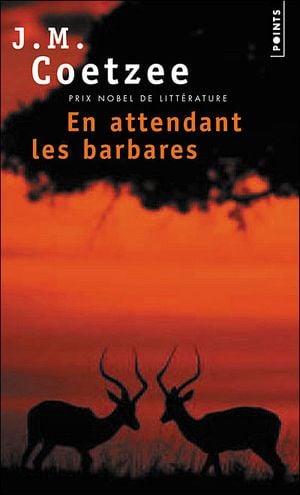Disgrâce est-il le chef d’oeuvre de J.M.Coetzee ? C’est bien possible. Il m’a tant marqué que je n’ai eu de cesse d’en savoir plus sur le Nobel sud-africain. Avec quelque déception, même si chacun des romans lus depuis reste de qualité.
De Disgrâce, on retrouve deux thèmes fétiches de l’écrivain : la violence tapie au fond de l’être humain et l’attirance sexuelle d’un homme vieillissant, le narrateur, pour la chair fraîche, ce qui entraîne sa déchéance. Le vieil homme en question est ici un juge dont la vie paisible d’administrateur d’une cité en plein désert est perturbée par l’irruption d’une délégation de l’Empire, menée par le colonel Jill. Celui-ci est d’emblée caractérisé par les cercles noirs qui couvrent ses yeux, objets glaçants jusque-là inconnus du narrateur : le roman s’ouvre sur ces deux petits disques de verre suspendus devant ses yeux, dans des cercles de fil métallique. Il n’est pourtant pas aveugle, contrairement à sa future victime, la jeune fille : il "voit à travers ces disques obscurs qui, de l’extérieur, paraissent opaques". Mais voient-ils vraiment ?... Ceux qui vont agir en barbares sont porteurs de la technologie, ici ramenée à de simples lunettes de soleil. Elles leur servent surtout à ne pas voir la folie de leur entreprise destructrice.
Bien sûr, comme toujours avec Coetzee, l’apartheid est en toile de fond. Il faut rappeler que, comme pour le régime nazi, c’est la paranoïa qui fut à l’origine des violences commises en Afrique du Sud. Les nazis avaient peur des Juifs comme les Boers se mirent à craindre d’être envahis par les Noirs lorsqu’ils affluèrent vers Johannesburg, main d’œuvre à vil prix réclamée par les colons. Ici, l’Empire craint "les barbares", entité mystérieuse, fantasmée. Le juge tente bien de faire valoir l’irrationalité de la traque que le régime veut engager, rien n’y fait. On torture ce qu’on ramène, notamment une jeune fille rendue quasi aveugle, qui va émouvoir le juge.
Au début, nulle relation sexuelle, c’est plutôt intéressant : il ne s’agit que de se masser, de retrouver l’effet bienfaisant du contact charnel, de se blottir corps contre corps. Page 72, alors que le narrateur la rejoint au sortir d’un coït avec une autre :
Je ferme les yeux, je respire profondément pour calmer mon agitation : je concentre tout mon être, cherchant à la voir du bout de mes doigts aveugles. Est-elle jolie ? La fille que je viens de quitter, et dont elle peut sans doute (je m’en aperçois soudain) sentir l’odeur sur mon corps, cette fille-là est très jolie, c’est incontestable : la vivacité du plaisir qu’elle me donne est aiguisé par l’élégance de son corps minuscule, de ses habitudes, de ses mouvements. Mais de celle-ci je ne peux rien dire avec certitude. Je ne peux définir aucun lien entre son être de femme et mon désir. Mon comportement érotique est entièrement indirect : je rôde autour d’elle, lui touchant le visage, lui caressant le corps, sans la pénétrer, sans trouver en moi l’impulsion qui m’y inciterait. Je quitte à l’instant le lit d’une femme que je connais depuis un an ; de tout ce temps, je n’ai pas eu un seul instant à m’interroger sur le désir qu’elle m’inspire : la désirer, cela a voulu dire l’envelopper et la pénétrer, transpercer sa surface et bouleverser sa paix intérieure en y levant les tempêtes de l’extase ; enfin se retirer, reprendre son calme, attendre que le désir se reconstitue. Mais, avec cette femme, c’est comme s’il n’y avait rien à l’intérieur : une surface, c’est tout - une surface que je parcours en tous sens, à la recherche d’un accès.
Et puis, lors d’une expédition destinée à ramener la jeune fille chez les siens, le rapport sexuel a lieu. Je l’ai regretté car le roman perd en singularité. L’expédition, en tout cas, est éprouvante mais la petite troupe parvient à rentrer. Au retour, voilà notre juge convaincu d’entente avec l’ennemi, et c’est la déchéance, la disgrâce, pour trahison mais aussi pour les relations qu’il a eues avec des jeunes filles.
Le narrateur est ramené au rang de bête, l’occasion de dénoncer la cruauté extrême du régime. Page 187 :
Dans ma souffrance, il n’y a rien d’ennoblissant. Et même, dans ce que j’appelle souffrance, la part de douleur est réduite. Ce qu’on me fait subir, c’est un asservissement aux besoins les plus élémentaires de mon corps : boire, se soulager, trouver la position la moins inconfortable. Quand l’adjudant Mandel et son aide m’ont ramené ici, qu’ils ont allumé la lampe et fermé la porte, je me suis demandé combien de douleurs un vieux monsieur grassouillet et bon vivant pouvait supporter au nom de sa conception excentrique de ce que devrait être la conduite de l’Empire. Mais mes tortionnaires ne s’intéressaient pas au degré de la douleur. Tout ce qu’ils voulaient, c’était me démontrer ce que cela veut dire de vivre dans un corps, d’être un corps, un corps qui ne peut se nourrir de la notion de justice que lorsqu’il est intact et valide, qui les oublie très vite lorsqu’on lui prend la tête, qu’on enfonce un tuyau dans son gosier, qu’on verse dans ce tuyau des litres d’eau salée, jusqu’à ce qu’il soit secoué de toux et de nausées, batte l’air de ses membres et enfin se vide. Ils ne sont pas venus me forcer à révéler ce que j’avais dit aux barbares et ce que les barbares m’avaient dit. (...) Ils sont venus dans la cellule pour me montrer ce que c’était que l’humanité, et en une heure, ils m’ont beaucoup appris.
Quelle belle leçon d’humanité en effet ! J’aime cette ironie subtile... Amateur aussi de ce style épuré, qui se confirme de livre en livre.
Qui sont les barbares ? C’est évidemment la question que pose le roman. Surtout lorsqu’ils se livrent à des châtiments sur la place publique dignes du Moyen Âge. Page 172, alors que l’on bat des hommes jusqu’au sang :
J’observe le visage d’une petite fille, debout au premier rang, qui s’accroche aux vêtements de sa mère. Elle a les yeux ronds, son pouce est dans sa bouche : silencieuse, terrifiée, curieuse, elle absorbe ce spectacle d’hommes nus et forts que l’on bat. Sur tous les visages qui m’entourent, même ceux qui sourient, je vois la même expression : ni haine, ni soif de sang, mais une curiosité si intense qu’elle draine toute vie de leur corps, la concentrant dans les yeux, organes d’un appétit nouveau et dévorant.
Coetzee ne se montre pas pour autant manichéen : la crainte de ceux que l’Empire désigne comme les barbares n’est pas non plus infondée puisqu’on les voit dresser un siège invisible autour de la forteresse. Il y avait simplement moyen de vivre en bonne intelligence, pense le juge. Raté.
Les barbares gagnent à l’usure, comme presque toujours dans les guerres asymétriques. Lorsque l’armée de l’Empire se retire, l’espoir renaît de bâtir quelque chose, comme lorsque le régime d’apartheid fut aboli. On sait que cet espoir fut en grande partie déçu : l’Afrique du Sud est aujourd’hui considérée comme le pays le plus inégalitaire au monde. Ce qui n’est pas un mince exploit, vu la concurrence...