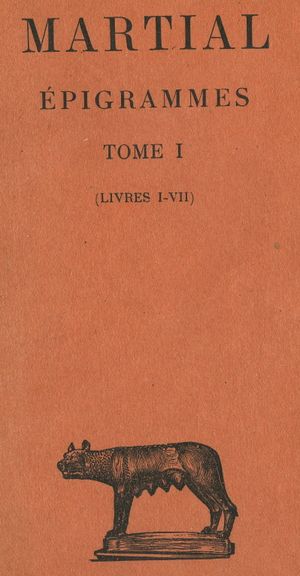Martial (environ 40-104 après Jésus-Christ) est l'un de ces poètes latins dont la vivacité d'esprit et l'élégance séduisent rapidement. Sa vie commence sous Caligula et s'achève sous Trajan. Né en Espagne, il tente rapidement sa chance à Rome, où il vit essentiellement en tant que « client » de personnages d'un certain rang. Les « clients » étaient à Rome des soutiens politiques, militaires ou privés de personnages importants, qui les protégeaient et les faisaient vivre en échange de toutes sortes de services.
Cette manière de vivre, qui s'apparente à des relations d'homme à homme de type féodal ou mafieux, était banale à Rome. Le patron nourrissait son client (combien de fois Martial se plaint-il d'avoir des patrons chiches en nourriture, ou avares lorsqu'il s'agit de donner la sportule (somme d'argent) !).
Poète habile, distingué et spirituel, il se fit une belle renommée dans la Rome du premier siècle, suscitant même de la part de Marcella, une riche veuve, la générosité de l'aider à rentrer dans son Espagne natale, où il s'ennuya, d'ailleurs, même s'il y fut plus à l'aise qu'à Rome.
Martial pratique l'épigramme ; c'est un poème bref (une page au plus), dont il n'a pas inventé le genre. Tous les mètres poétiques y sont plus ou moins utilisés, et il faut déjà une solide virtuosité pour les maîtriser car, rappelons-le, la poésie latine classique, qui se moque bien des rimes, est fondée sur le respect de la succession codifiée de syllabes longues et de syllabes brèves. On sait bien que le latin en prend parfois à son aise avec l'ordre des mots dans la phrase (ce qui peut faciliter les choses), il n'empêche qu'il faut bien de la virtuosité pour réussir une versification irréprochable.
L'épigramme, censée narrer ou décrire en peu de mots un fait ou un comportement remarquable (sa vocation première est d'être une inscription sur un monument), est souvent satirique, et se caractérise presque toujours par une « pointe » finale à la fois critique et drôle : désignation d'un travers, d'un vice, constat désabusé, pensée émue...
Martial, bel esprit qui fréquente et / ou admire les grands noms littéraires de son temps (Quintilien, Silius Italicus, Sénèque le Philosophe, Juvénal, Pline le Jeune...), se fait remarquer à la fois par l'élégance de son expression, la variété de son inspiration, et la causticité de ses satires. Il a su à la fois gagner l'estime de ses pairs, et plaire à un large public en l'amusant. Lui-même affecte de déprécier ses propres productions : nugae sunt, ce sont des bagatelles légères.
Ses épigrammes sont classées en quatorze « livres », ce qui fait tout de même du volume. Pour nous, la saveur de Martial tient à plusieurs caractères :
• la précision avec laquelle il décrit la vie urbaine et le quotidien des Romains : lieux que fréquentent ces citoyens, visiblement oisifs : thermes, cirque, lupanars, portiques, librairies, forums, promenades, basiliques ; leurs vêtements, luxueux ou misérables, propres ou non, les cadeaux qu'ils se donnaient ; ce qu'ils mangeaient ; les déplacements qu'ils effectuaient. On apprend comment un grand seigneur emploie sa journée. On rencontre dans la rue des marchands d'allumettes soufrées, de salaisons et de pois chauds, ceux qui vont offrir dans les cabarets leurs saucisses fumantes, les mendiants de toute espèce, les pique-assiettes, les coureurs d'argent, les avocats, les hommes de loi, les maîtres d'écoles, les colporteurs, les barbiers, les savetiers, les architectes, les commissaires-priseurs, les endettés, les fâcheux, les badauds, les philosophes, les empoisonneurs, les saltimbanques. Martial décrit une toge ou une coupe, un tableau ou une statue, le festin d'un riche débauché, les produits d'une ferme, un arc de triomphe, un lion dans l'amphithéâtre qui dédaigne une proie offerte, les terrains d'exercices, les saturnales, les vieux coquets qui se teignent les cheveux...
• les sentiments que les Romains éprouvaient vis-à-vis de la mort, des enfants, de la famille... Martial nous donne des poèmes pour un anniversaire, pour un mariage, des éloges, des épitaphes, des vers sur une éruption du Vésuve, sur un insecte incrusté dans de l'ambre...
• la place que tient l'Empereur dans la vie quotidienne : maître divinisé, toujours tout-puissant, généreux et compatissant (surtout quand il lit les poèmes de Martial et lui donne un petit quelque chose...). Les flagorneries de Martial vis-à-vis de l'Empereur (et c'est souvent Domitien, en plus !) constituent un aspect embarrassant de ses poèmes pour qui se laisse séduire par l'authenticité des sentiments et l'élégance générale du recueil. Il faut croire que tout le monde léchait les sandales du Prince...
• le regard que les Romains portaient sur la sexualité : visiblement, il était banal, pour un homme comme pour une femme libre, de recourir aux bons services de leurs esclaves des deux sexes, souvent fort jeunes. Martial décrit sans réticence la beauté de petits garçons « qui faisaient les délices de leur maître ». Et la description crue du comportement des homosexuels court-circuite la bonne volonté du traducteur (H.-J. Izaac), qui travaillait vers 1930 : combien de fois utilise-t-il des périphrases édulcorées pour mentula, pedicare, irrumare, lingere, et autres mots de sexe. (Ils signifient « pénis », « offrir son cul » (comme homosexuel passif), « donner son sexe à sucer », « lécher », etc.). Parfois même, Izaac met une note en latin sur ce genre de sujet, parce qu'en français, ce serait trop....incorrect. Rêvons aux noms de quelques femmes « libres » qui font commerce de leurs charmes : Thaïs, Lycoris, Chioné, Phyllis, Lesbia, Glycera, Lalagé... On notera que ces noms sonnent majoritairement grec et pas tellement latin.
• son côté gamin et enjoué quand il se moque de quelqu'un : on a peine à trouver de la vraie méchanceté quand il pointe un ridicule : plagiaires, parasites, poètes sans talent.
Les deux derniers livres (XIII et XIV) mettent encore mieux en valeur le talent créateur et mondain de Martial: ce sont des dédicaces à étiqueter sur des objets que les Romains de son époque s'offraient entre eux à diverses occasions, en particulier pendant la fête des Saturnales, et lors de repas collectifs. Les allusions personnelles (ou non), l'érudition, la finesse du tour pris par l'épigramme relèvent du tour de force pour ces quelque 300 distiques (poème réduit à deux vers). On n'est pas loin de la concision du Haïku, mais, il est vrai, dans un tout autre esprit.
L'intérêt de ce défilé d'objets étiquetés, c'est qu'ils nous mettent le nez sur le quotidien des Romains: la gamme impressionnante de mets culinaires, de légumineuses, de céréales, de fruits, de légumes, de douceurs, de volailles, de gibiers, de poissons, de vins, d'objets destinés à écrire et de supports d'écriture (le papier existait bien !), d'objets pour jouer, d'objets de toilette, d'outils, de luminaires, d'objets ludiques et décoratifs, de meubles, de coupes à boire (on faisait refroidir le vin en le faisant coulait sur de la neige, précieusement conservée), de vaisselle, de vêtements, de livres.... nous incite au respect face à l'ingéniosité et à la richesse du cadre de vie d'un peuple que nous n'avons que trop tendance à nous représenter comme démunie.
On est frappé par la parenté des Saturnales (17 au 23 décembre) avec la fête de Noël: véritable fête où tout le monde jouissait provisoirement d'une liberté de parole, on y échangeait de nombreux cadeaux. A l'évidence, les chrétiens, soucieux de placer Noël quelque part, se sont bornés à christianiser cette échéance solsticiale. Il est symptomatique que seul le côté festif ait survécu, et que le côté religieux soit en pleine débandade: on a affaire ici à une structure anthropologique: le corps, épuisé par le raccourcissement de l'arc diurne du Soleil au cours de l'automne, réclame sa part d'exultation au plus bas de la durée du jour.
Au jeu de l'épigramme piquante ou grinçante, Martial prend le lecteur et lui insuffle, deux mille ans plus tard, les parfums et les haleines de ceux qui nous ont tant ressemblé. On déguste ces poèmes en leur laissant leur saveur individuelle...