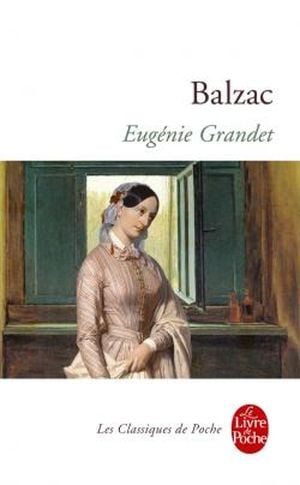Voir Saumur et ne pas mourir...
Cela faisait longtemps que je n'avais pas lu de Balzac, a fortiori un Balzac de province. Et Dieu sait que je connais moins bien ceux-là. "Eugénie Grandet" m'a donné envie d'en lire d'autres.
L'histoire se déroule sur 16 ans, entre 1819 et 1927, même si les événements les plus importants se déroulent en 1819. Le chapitre d'introduction décrit comment Félix Grandet, tonnelier de Saumur, réussit à faire fortune sous la Révolution en achetant les vignes confisquées au clergé, formant la première fortune foncière de la région. Grandet est un avare à l'ancienne, imposant à sa femme effacée, à sa jeune fille de 22 ans, Eugénie, et à sa bonne, Nanon, une vie ascétique. Deux familles de la bonne société saumuroise, les Cruchot (un abbé et un président de tribunal) et les Desgrassin (un banquier) tournent autour de l'héritière, ce qui fait bien rire Grandet.
Arrive Charles, le neveu du père Grandet, un dandy parisien. Son père Guillaume l'envoie à Saumur, puis se suicide du fait d'une banqueroute. Grandet monte une combinaison avec Desgrassins pour liquider la société de son frère et utiliser une partie pour se créer des rentes, en misant sur le temps pour décourager les créanciers. Pendant ce temps, Eugénie tombe amoureuse de Charles, qui veut partir faire fortune aux Indes. Eugénie lui donne son douzain (chaque année son père lui donne une pièce d'or rare) ; il lui confie un nécessaire en or représentant sa mère.
Charles part. Grandet découvre qu'Eugénie a donné son douzain, ce qui l'affecte. Le tempérament de l'avare s'aggrave, et Mme Grandet en meurt. Ce qui change complètement le rapport de force : désormais Grandet laisse un peu de marge de manoeuvre à sa fille, en échange d'une promesse écrite de celle-ci de ne pas réclamer l'héritage de sa fille. Grandet devient de plus en plus impopulaire à Saumur, pour son avarice et pour avoir dupé les vignerons de la région. Il n'en devient pas moins immensément riche.
Il finit par mourir, d'une mort pitoyable d'avare serrant son trésor. Eugénie refuse de se remarier. En 1827, elle finit par recevoir une lettre de Charles. Celui-ci a fait fortune aux Indes, en grande partie par les traites d'esclaves, ce qui l'a endurci. Il demande à Eugénie de lui envoyer son nécessaire par la dilligence, et annonce un mariage de convenance avec une noble, Mlle d'Aubrion. C'est assez ironique, car il se veut un bon carliste, trois ans avant la Révolution de juillet. Eugénie se résoud à épouser le fils Cruchot, devenu le président Bonfons, mais mène une vie de none. Elle se trouve veuve rapidement et consacre sa vie à des oeuvres de charité. Nanon épouse le garde-chasse et adopte un train de vie semblable à celui de Grandet.
J'aime beaucoup le chapitre d'introduction, qui fait une sorte de travelling à travers Saumur jusqu'à la maison Grandet, puis rappelle les étapes de l'ascension du père Grandet. Comme toujours, Balzac décrit magnifiquement la condition matérielle de ses personnages : l'escalier qui grince et dont Grandet ne veut pas réparer la marche, les tournées d'inspection de Grandet, les salons de province si désespérants pour les Parisiens, etc... On vit dans cette demeure Grandet.
Je n'avais pas réalisé avant ce roman tous les points de contact entre Balzac et Molière : Grandet doit évidemment à Arpagon, mais Eugénie doit aussi à l'Agnès de "L'école des femmes". Toute la comédie sur le bégaiement feint de Grandet, ou encore les personnages ridicules des Cruchot et des Desgrassin, dont Balzac va parfois jusqu'à nous donner les pensées profondes (pas très reluisantes), tout cela fait penser au théâtre.
Dans ce livre, comme dans bien d'autres, une, voire plusieurs femmes sont des figures angéliques, éminemment chrétiennes (Dernière page : "La main de cette femme panse les plaies secrètes de toutes les familles. Eugénie marche au ciel accompagnée d'un cortège de bienfaits. La grandeur de son âme amoindrit les petitesses de son éducations et les coutumes de sa vie première"). Balzac sent une profonde sympathie pour la femme qui s'affranchit peu à peu d'un tyran domestique, et c'est le cas d'Eugénie avec Grandet, du moins pendant un temps. La conclusion du livre est cependant fort sombre et triste, digne d'un Simenon, puisqu'il en ressort l'impression d'une vie brisée, qui se console en faisant le bien à des gens qui lui sont étrangers.
Il y a d'ailleurs au détour d'un paragraphe une curieuse tirade contre le matérialisme de l'époque de la Restauration et l'absence de spiritualité de l'époque, qui pourrait presque être d'un légitimiste, si on n'y prenait garde. Malheureusement je n'ai pas réussi à remettre la main dessus.
Eugénie Grandet est à juste titre conseillé pour se familiariser au monde de Balzac : la psychologie et l'analyse sociale sont sublimes, les montages financiers sont racontés en détail et incompréhensibles ; on sort ému aux larmes.