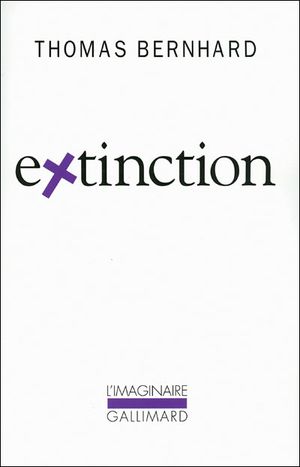**Cette critique a vu le jour suite à les fortes pressions d’un éclaireur qui se reconnaîtra (ça commence par N et ça finit par -ushku). Merci de votre compréhension**
Éditions Gallimard, collection L’Imaginaire… les dernières pages se décollent, je finis par les lire hors du livre, comme on lit une lettre. Elles se sont détachées de leur corps et ça m’énerve. Non que je déteste que mes livres s’abiment, au contraire, mais je n’aime pas que les pages se détachent… Pourtant, c’était de circonstance, comme si l’objet épousait ce qu’il contenait, ce qu’il renfermait. Des feuilles mortes. Un détachement. Une extinction. Un effondrement. L’ultime roman de Thomas Bernhard.
Il y a quelque chose de pourri au royaume de Wolfsegg… et en Autriche… et en Allemagne… Partout où l’on parle cette horrible langue qu’est l’allemand… Non, pour être plus précis, tout est pourri… L’État, la société, la religion, les gens. La photographie et ceux qui prennent des photographies. Sauf Rome, les jardiniers et l’oncle Georg. Mais le monde n’est plus qu’un ramassis d’hypocrites en plein processus d’abêtissement, et ceux encore capables de penser devraient se suicider avant que le nouveau siècle n’arrive. Je me dis que Thomas Bernhard, ou du moins le narrateur n’aurait pas pu survivre de nos jours. La mort aurait été la seule issue. Bernhard ne nous enseigne d'ailleurs pas à vivre, mais à mourir. D’où Montaigne en épigraphe.
Ça commence par un télégramme. Comme dans L’Étranger de Camus. Un télégramme annonçant la mort d’une mère. Comme dans L’Étranger. Mais aussi d’un père et d’un frère. Pas comme chez Camus. Tragiquement, dans un accident de voiture. Comme Camus. Le roman est divisé en deux parties. Comme dans L’Étranger. Et le personnage est devenu étranger à ses origines et à sa culture… en fait, je veux en venir nulle part en faisant rappliquer Camus. Il fallait bien commencer quelque part. Je balance les choses comme elles me viennent à l’esprit. La pression, tout ça.
Bref. Il est étrange d’aimer un livre écrit non avec de l’encre, mais avec du venin, avec de la bile. Aussi comique que tragique, et où respire une horreur endémique et contagieuse. Cette haine qui explose dans ces interminables phrases usant de répétitions forcenées, entre pensée et report. On va et vient suivant les marées de pensée du personnage. C’est une partition, certains mots utilisés, usés comme des notes. Il y a une véritable musicalité chez Bernhard. Le héros enterre sa famille, Bernhard enterre l’Autriche. Le siècle dans lequel il vit. Et c’est beau à pleurer.
Bien sûr, c'est plein de mauvaise foi. Bien sûr, il exagère toujours, il le sait, il le dit. Il se dit artiste de l’exagération. Mon regret est la perte de puissance dans la seconde partie, où le monologue est davantage conduit par la narration des évènements, là où la première peignait un homme seul dans son appartement de Rome, Piazza della Minerva, avec un télégramme, trois photos, et ses pensées. Pourtant, cela se termine par une montée en puissance saisissante, à bout de souffle, l'ultime vengeance. Je repensais au dernier monologue de La Maman et la Putain revu pendant la lecture. Je repensais à l’intensité de The Mercy Seat et aux tableaux de Francis Bacon… Puis j’ai tenté de cerner le sentiment qui s’est emparé de moi lorsque j’ai replacé la dernière page dans le livre. J’ignore si c’est de la tristesse, une sensation de solitude, ou peut-être de la compassion pour cet homme, ou de l’amitié pour un ami perdu qui écrivait pour lui et pour personne d’autre et qui survit par cette même écriture. Je n’étais pas joyeux. J’étais en deuil. Je suis en deuil. Et maintenant, il faut que j'achète de la colle, et que je recolle les pages.
« Chaque matin où nous nous réveillons, nous devrions mourir de honte pour cette Autriche, Gambetti, ai-je dit à Gambetti, ai-je pensé à présent devant la tombe ouverte. Toujours, encore et toujours je me dis, nous aimons ce pays mais nous détestons cet État, Gambetti. À Rome et où que ce soit dans le monde, Gambetti, ai-je dit à Gambetti, ai-je pensé à présent, cette Autriche ne nous concerne plus. Où que nous allions dans cette Autriche d’aujourd’hui, nous entrons dans le mensonge, où que nous regardions dans cette Autriche d’aujourd’hui notre regard plonge dans l’hypocrisie, peu importe avec qui vous parlez dans cette Autriche d’aujourd’hui, vous parlez avec un menteur, Gambetti, ai-je dit à Gambetti ai-je pensé à présent devant la tombe ouverte. »
BONUS > Idée de drinking game : boire à chaque fois qu’il prononce "Wolfsegg", par contre ça sera vite le coma éthylique. (également possible avec "Gambetti").