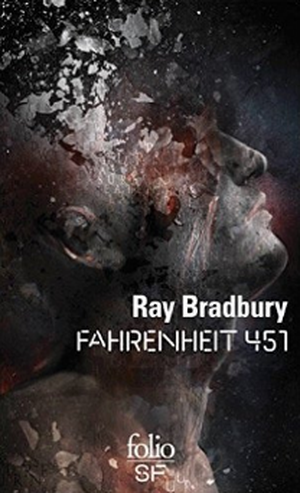Pas de quoi en faire des Montag(nes)
Quand on parle de dystopie, difficile de ne pas penser à 1984, au Meilleur des Mondes et à Fahrenheit 451, qui semblent être les classiques absolus du genre en littérature. Des trois, le roman de Bradbury fut le dernier à paraitre, et est à mon sens le moins poussé, mais le plus agréable à lire.
Mais la première chose qui frappe dans Fahrenheit, c'est son côté prévisible, "déjà-lu" et assez peu original pour une dystopie : on suit donc un héros, fonctionnaire au service d'un gouvernement totalitaire et qui vit dans une société où l'ensemble de la population semble abrutie par le conditionnement des politiques, et ce fameux héros va peu à peu se poser des questions, contrairement à ses camarades, et se rebeller. Je ne saurais l'affirmer pour le Meilleur des Mondes, mais on a, à peu de choses près, le synopsis de 1984.
Bon, il y a évidemment quelques spécificités, comme la réflexion plus poussée sur la littérature et son rôle dans le développement de la culture, de la connaissance et du sens critique humain ou la critique de la télévision qui tape en plein dans le mille, mais globalement, on en revient toujours à 1984 : le gouvernement a intérêt à maintenir les masses ignorantes, l'individu seul est impuissant face à une dictature, la propagande et le nationalisme sont essentiels pour contrôler d'une main de fer le peuple, etc. Au fond, des idées qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, mais qui ne le sont pas forcément, et c'est bien l'un des rôles de la littérature, et de l'Histoire, de nous le rappeler, et de l'illustrer concrètement. Mais une idée sans-cesse rabâchée finit par lasser, c'est sûr.
Bradbury a pourtant quelques fulgurances, tant dans son style que dans son analyse sociétale, notamment quand il préfigure (en 1953 !) l'importance que prendra la télévision (et puis internet ?) dans les foyers, et à quel point ce sera un instrument puissant de manipulation des masses. Le meilleur exemple est évidemment le débat présidentiel télévisé, qui ne porte pas sur le fond, mais juste sur la forme. Les gens veulent un président présentable, beau, éloquent, et tant pis si son candidat est convaincant, intelligent et plus apte à occuper le poste. En un sens, Bradbury a compris une partie des changements à l'oeuvre à son époque, et a plutôt bien estimé les conséquences potentielles qui en découleraient. Même si le tout est évidemment exagéré.
Mais le problème dans tout cela, c'est que ce roman est trop court, trop vide, et qu'il lui manque des éléments de réponse pour être complet. Bradbury esquisse les traits d'une société future "plausible", mais même ce croquis n'est pas terminé, et on n'a jamais l'impression qu'il maîtrisait son univers comme Orwell avec 1984. J'ai plus eu l'impression de lire le récit d'un homme, qui se fait quelques réflexions sur l'étrange société qui l'entoure, que celui d'une société à travers le prisme d'un homme. Et j'ai du mal à croire que ce soit voulu, tant l'auteur cherche en permanence à transmettre au lecteur de grands messages sur le sens de la vie (dans le genre, la fin est assez pompeuse) ou ses critiques sociétales. Parce que l'homme, Montag, au fond, il n'est pas intéressant. Sa vie n'a aucun intérêt, il n'a pas le moindre charisme et il ne me semble destiné qu'à être un avatar pour le lecteur, un homme simple, fade et peu expressif qui permet à chacun de percevoir son monde à travers ses yeux, comme Winston dans 1984. Mais une fois le bouquin refermé, on ne sait pas comment tourne son pays, son monde. Pourquoi cette fameuse guerre ? Un État dans le territoire se fait bombarder perd-il encore son temps à traquer pendant des heures un vulgaire malfrat avec une dizaine d'hélicoptères ? Comment les gens sont-ils éduqués ? Au fond, je n'ai jamais eu l'impression de comprendre la vie d'un homme normal dans ce monde parallèle. Je suis peut-être injuste, car ma déception est liée à la grande qualité d'une autre oeuvre du même genre, que ce Fahrenheit ne peut égaler...
Malgré tout cela, ça reste une lecture agréable, pas forcément idiote et dotée de quelques belles descriptions et phrases. Telles que "Et quand il est mort, je me suis aperçu que ce n'était pas lui que je pleurais, mais les choses qu'il faisait" ou "Elle ne voulait pas savoir le comment des choses, mais le pourquoi. Ce qui peut être gênant." En fait, Fahrenheit ne brille pas par l'élégance de ses mots, ou ses métaphores, mais par ses idées simples, énoncées comme telles. Du coup, malgré toutes les critiques que je peux émettre, j'aime bien ce livre en fait, et je ne peux me résoudre à lui mettre moins de sept.