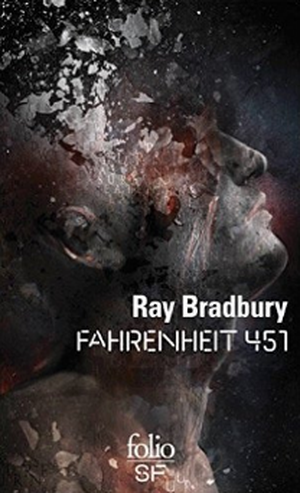Fahrenheit 451, un des piliers du genre de la dystopie, quoique écrit dans les années 50, entre étrangement en résonance avec notre époque. En racontant l'histoire d'un pompier d'un nouveau genre dont l'office est de brûler des livres, devenus trop subversifs pour une société d'hyper-consommation gavée aux loisirs de masse, Ray Bradbury a des accents terriblement prophétiques.
Comment ne pas voir dans l'abrutissement des peuples hyperconnectés via des "télé-écrans interactifs" une peinture peu amène de ce que pourrait devenir l'Internet actuel, bien loin de ses préoccupations universitaires d'origine ? Comment ne pas se sentir étrangement oppressé en découvrant au fil des pages cette société où se promener à pied plutôt que de filer à toute berzingue sur l'autoroute est un acte suspect ?
Fahrenheit 451, c'est avant tout une écriture poétique appuyant une réflexion sur l'importance de ce que la culture, l'art, la philosophie apportent à l'humanité ; sur les dangers de la censure, notamment de l'auto-censure, même drapée des meilleures intentions. C'est ce qui en fait une lecture quasi-obligatoire de nos jours, malgré les défaut criants que l'ouvrage de Ray Bradbury traîne : une structure narrative mal fagotée qui peine à tenir en haleine, un univers finalement peu décrit (frustration ultime pour le genre de la dystopie), une fin qui n'en est pas vraiment une faisant l'effet d'une perruque usagée tombant dans un potage trouble.
De fait, ne vous laissez pas abuser par un quatrième de couverture aguicheur, les aventures de Guy Montag sont accessoires (J'ai tendance à voir dans Clarisse la véritable héroïne du roman), Fahrenheit 451 est avant tout une invitation à déconnecter un peu, se poser, et tenter de se dérouiller les neurones.
Et quoi de mieux pour ça que d'aller saisir un bon bouquin poussiéreux traînant sur une étagère ?