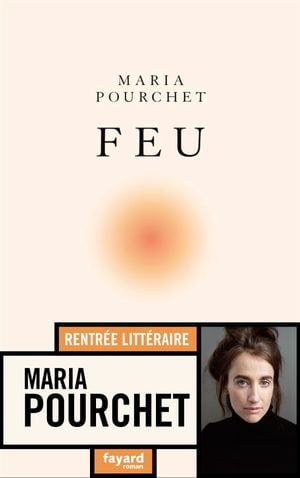[Critique à lire après avoir terminé le livre]
Une liaison adultère passionnelle, sans doute le sujet le plus banal de la littérature : un Nième avatar de Madame Bovary, la référence incontournable en la matière. D’ailleurs le mari de Laure est médecin, comme le cocu du roman de Flaubert.
Mais nous sommes au XXIème siècle. Le médecin n’est pas ridicule mais simplement accaparé par sa vie professionnelle. Laure n’est pas désoeuvrée mais active, voire débordée elle aussi, notamment par les frasques de sa fille ainée, Véra, l’adolescente rebelle que chacun rêve de ne pas avoir. Véra organise des actions politiques, comme se lever et sortir de la classe dès qu’un nom masculin est mentionné. Eh oui, ça existe vraiment. Plus d’amour envers son Anton de mari : le constat désabusé d’une époque, à la Houellebecq, avec qui on a pu comparer Maria Pourchet. Un ton qui m’agace un peu d’ailleurs, comme s’il suffisait d’être cynique pour être de son temps. Un peu facile, non ?
Feu, c’est l’attelage baroque de la carpe et du lapin : une intellectuelle par excellence, universitaire, et un cadre de haut de niveau de la finance. Deux mondes très largement hors sol, pour des raisons différentes. On ne voit pas ce que ces deux-là pourraient avoir à se dire. Et pour cause : ils ne se disent rien. Ils n’ont qu’un truc en commun, le cul. Clément et Laura, c’est une passion purement charnelle. Certains y ont vu une faiblesse, j’y vois un parti pris intéressant, tenu avec une belle rigueur.
Les mal aimés
Le point commun de tous ces gens qui déconnent, Laure, Clément, Véra ? Ce sont des mal aimés.
Laure est sous la coupe de sa mère, réminiscence de Toutes les femmes sauf une sans doute très largement autobiographique : une mère invasive, castratrice, impitoyable. Doublée ici d’une grand-mère, qui s’est battue pour l’émancipation des femmes. Ce double regard est intéressant, en ce qu’il met en perspective l’évolution de la femme sur trois générations, avec l’effet de balancier classique. On ne peut pas dire que le résultat soit glorieux, Laure ne fait pas très envie : à la fois dévorée par un désir compulsif (intéressant d'attribuer cette caractéristique très masculine à une femme) et carpette, prête à ramper pour avoir accès à son homme (à qui elle fait une fellation, une première pour elle : intéressant aussi de la part d'une écrivaine d'inclure ce fantasme masculin dont Houellebecq use et abuse). Les chapitres consacrés à Laure sont rédigés à la deuxième personne du singulier, la femme se parlant à elle-même.
Clément, lui, parle à son chien, qu’il a nommé Papa. On ne peut dire plus clairement le manque d’amour subi dans l’enfance. La 4ème de couverture nous dit qu’il est addict à Youporn, c’est un peu racoleur car dans le roman il n’en est quasiment pas question : notre homme consomme bien de la chair fraiche, pas de façon virtuelle. Plus proche du chaud lapin que du frustré devant son ordi. Pour attirer le chaland ? Au-delà de l’indigence de l’argument, comprendre ce qu’il se passe dans la tête d’un drogué du porno eût pu être intéressant. Donc, publicité mensongère ici. Bref. Clément ne s’aime pas, il se sent incapable d’aimer qui que ce soit, à part son chien. Il ne fait pas très envie non plus.
Enfin, Véra est née de père inconnu. D’où la rage qui l’habite, tournée alternativement contre la société et contre sa mère. Sa réaction à la fausse couche de Laure est assez glaçante. D’où aussi son idée de se faire embaucher sous le pseudo Cécile par Clément. C’est elle qui déclenchera le geste fatal de ce dernier.
La langue
Jusque-là, rien de très reversant, il faut le dire. Ce qui fait tout le prix de ce Feu, c’est la langue, très et bien travaillée. J’aime ouvrir le roman au hasard. Page 58 :
Douzième, treizième jour. Désormais le matin, tu mimes un sommeil profond, le temps qu’Anton se lève et disparaisse. Quand tu entends le fracas de l’eau dans la baignoire, tu as moins d’une minute pour te branler d’un seul doigt, deux autres ravivant très vite dans ton ventre le souvenir des siens. Quand l’eau se tait, ta débauche d’éternelle pensionnaire chronométrée sous les couettes et les paupières [bien, ça], se termine en tremblant mais sans gémir. De retour dans la chambre pour y prendre une chemise et te trouvant invariablement couchée, Anton gueule qu’à ce train c’est encore lui qui déposera Anna à l’école, tandis que ses premiers patients s’échangent déjà, dans la salle d’attente, leurs miasmes volatils [bien aussi, ça]. Désormais Anton te dérange et cela ne changera plus. Tu t’excuses, tu t’étires, tu félicites ta peau patiente en embrassant ton épaule [bien encore], et tu t’habilles.
Notons tout de même une faiblesse de la ponctuation : il y a dans ce seul paragraphe deux virgules qui posent problème. La deuxième phrase eût été meilleure à mon sens sans virgule après matin. Et dans « Quand l’eau se tait… », la virgule après paupières est carrément incorrecte selon la règle qui veut qu’on ne sépare pas le sujet du verbe par une seule virgule. On constate ce second problème à plusieurs endroits du roman. Page 288 :
Toi et ton invité envisagiez sur le canapé dépliable de l’unique pièce, une de ces étreintes silencieuses…
Il faut soit une virgule après envisagiez, pour créer une incise, soit enlever celle après pièce. Certes, un romancier a le droit de s’affranchir de ces règles, pour créer un effet littéraire. Le lecteur jugera si c’est le cas ici.
D’une façon générale, je trouve que Maria Pourchet abuse des virgules. Mais cela n’enlève rien à l’inspiration, par ailleurs, de son écriture. Ouvrons encore au hasard. Page 114, cette phrase au rythme asymétrique, qui chute brutalement :
Sa main entière te déforme, tu imagines le noir rouge du cœur des volcans mais c’est toi.
Page 115 :
Un instant, il pleure, rapidement, s’en excuse puis éloigne son corps du tien, au motif d’une démangeaison. Il dit qu’il ne s’agit pas de tomber amoureux, amoureux c’est ordinaire et casse-gueule. Je ne suis jamais, dit-il en se rhabillant dans l’habitacle [belle allitération], qu’une plaque de verglas sur la route, et toi tu souris, tu prétends savoir tomber [joli]. Tu commences à le connaître. Tu sens dans chacun de ses mots l’hiver dont il arrive [aussi].
Tomber amoureux : casse-gueule oui, ordinaire je ne suis pas sûr, tout le monde a peur de ça aujourd’hui. Autre exemple du caractère très contemporain du roman. Mais là encore, la virgule après "Un instant" ne me semble pas pertinente.
Le style est vif, abrupt, plein de surprises comme le montrent les quelques exemples ci-dessus. Parfois abscons, c’est le second reproche que je ferais à son écriture. Un style riche et limpide, il faut bien le dire, très peu d’écrivains en sont capables, en tout cas sur la durée. On reprochera aussi à l’auteure ces inscriptions mystérieuses en en-tête des chapitres où c'est Clément qui parle : FR 16/min, FC 70/min, TA 14. TA, tension artérielle d’accord mais FR et FC c’est quoi ? Soit dit en passant, une tension artérielle entre 14 et 16, c’est énorme non ? Mais pour ce genre de job, c’est possible.
Malgré quelques travers, Feu est un roman brillant, percutant, incisif. Qui ressemble à l’époque, comme Houellebecq oui. C’est sa force et sa limite : car l’époque n’est pas enthousiasmante. Sans doute ne l’était-elle pas plus, finalement, du temps de Flaubert ?
7,5