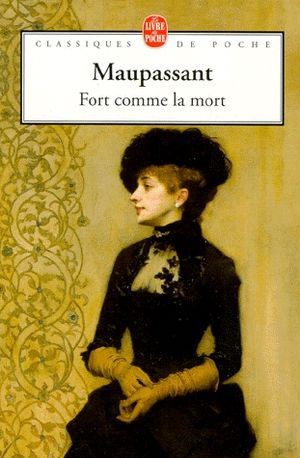Je n’avais lu jusqu’ici que trois des six romans de Maupassant, il était grand temps que je m’attelle à la lecture d’un des trois autres. Alors, pourquoi ne pas commencer par celui-ci, puisque @Blanchefleur321 me l’avait suggéré au détour d’une liste ?
On retrouve ici en grande partie tout ce qui fait l’intérêt des récits de l’auteur : une finesse psychologique incomparable, des descriptions saisissantes de vérité qui nous font voyager dans le temps pour nous plonger dans l’ambiance du Tout-Paris à la fin du XIXe siècle, avec ses occupations souvent frivoles, ses lieux de prédilection, ses goûts, ses exigences, ses règles qui concernent plus l’apparence que la morale. L’intrigue, somme toute assez banale, est fondée sur l’usure du temps et des passions ainsi que la peur de vieillir : le héros, Olivier Bertin, est un peintre mondain plus talentueux que véritablement génial mais qui, se pliant de bonne grâce au goût de la haute société, a fini par y être admis et même recherché, sans toutefois en faire totalement partie. Il a pour maîtresse une femme du monde d’une grande beauté, la comtesse Anne de Guilleroy dont il a peint le portrait, il y a longtemps. Au soir de sa vie, il sent l’inspiration le quitter, tandis qu’il en vient à regretter son célibat qui le fait rentrer chaque soir, après quelques visites à ses amis ou à son cercle, dans la froideur et la solitude de sa grande maison vide. La comtesse, quant à elle, use d’artifices et d’onguents pour retenir une jeunesse qui s’éloigne inexorablement et pour continuer à briller dans les réceptions mondaines qu’elle fréquente avec assiduité. Mais un beau jour sa fille fait à son tour son entrée dans le monde, portrait craché de sa mère à ses heures de gloire et double vivant du tableau de Bertin, entraînant le peintre dans un vertige amoureux dont il ne sortira pas, tandis que la comtesse, effrayée et malheureuse, se mure dans un chagrin que vient alourdir le deuil de sa propre mère.
Comme toujours, le style de Maupassant est empreint de sensibilité et d'une grande justesse : il donne vie aux personnages dans leur détresse et leur désarroi, leur peur de l’avenir, leur quête éperdue de prolonger leur jeunesse, voire le délire quasi faustien de la revivre, leur nostalgie d’un passé qui s’éloigne et que seul l’art, en particulier la musique, leur restitue intact par bouffées, bien des années avant que la sonate de Vinteuil ne vienne frapper l’oreille et la mémoire du héros de Proust. J’avoue pourtant que les héros, tous policés et bienveillants, m’ont paru parfois manquer un peu de sel, tout comme leurs activités m’ont souvent semblé insipides : promenades au bois de Boulogne ou au parc Monceau, réceptions mondaines, parties de lawn-tennis, courses chez le bijoutier ou la couturière … Toute cette agitation me semble plus tenir du divertissement pascalien que d’une réelle qualité de vie. Quant aux états d’âme des héros, si je peux les comprendre, ils n’ont éveillé en moi que peu de véritable compassion. La solitude de Bertin n’est-elle pas in fine la conséquence de la vie libre qu’il s’est choisie ? Son désir d’une passion amoureuse plus forte que la mort et qui lui donne une illusion d’une seconde jeunesse n’est-elle pas des plus communes chez un homme sur le déclin ? Quant à la comtesse, toujours à interroger avec appréhension son reflet dans le miroir telle la femme vieillissante des contes, si je la plains, ce n’est pas vraiment pour la perte de sa beauté ou de sa fraîcheur qui lui fait considérer sa propre fille comme une rivale qu’il est temps d’éloigner de chez elle par un beau mariage. C’est plutôt d’avoir été conditionnée à n’exister que pour briller aux yeux des autres, comme un bijou qu’on exhibe fièrement avant qu’il ne paraisse démodé, sans lui offrir d’autre possibilité de consolation que celle d’une religion qui ne l’attire guère. Mais si la détresse d’Anne me paraît respectable, elle ne me parle pas vraiment. Sa crainte d’être supplantée par sa fille dans le cœur de son amant qu’elle adore est évidemment légitime, mais sa peur de vieillir a quelque chose de pathologique.
Reste que pèse sur ce roman, l’avant-dernier terminé par son auteur, une atmosphère empreinte d’une grande tristesse liée sans doute à la mort prochaine qu’il devait pressentir mais également à cette ambiance fin de siècle qui planait sur la société de l’époque et que dépeindront si bien les décadents. Derrière le lustre étincelant et la joyeuse animation des grandes soirées mondaines, se cache un univers maladif et crépusculaire, fait de tristesse et d’inaction, celui des appartements parisiens dont la pénombre étouffante qui occulte les ravages du temps plaît tant à la comtesse, celui des hôtels particuliers sinistres comme des tombeaux lorsqu’ils n’ont à offrir qu’une solitude glaciale. La longue nuit est en marche, elle finira par tout engloutir, étendant sur la gaieté de façade comme sur les sentiments sincères son voile de deuil : les lettres d’amour se consument, les esprits vacillent, les corps s’abîment et pressentent leur déchéance prochaine. Même si je ne me sens pas vraiment proche des héros, je dois avouer que Maupassant, miné lui-même par la maladie dont il connaît par avance les ravages qui le conduiront inéluctablement à une fin tragique, signe avec ce roman une œuvre d’une terrible et poignante mélancolie.