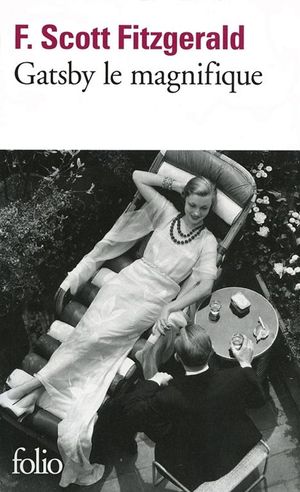Trois fois que je lis Gatsby, trois fois que je sombre avec lui dans l'adoration amère d'un bonheur clinquant qui s'éloigne à mesure qu'on s'en approche.
Bien entendu, l'histoire en elle-même est d'une relative banalité. Un jeune type sans le sou s'installe, en 1922, sur la côte Est, à proximité de New York, et se retrouve un peu par hasard à fréquenter la haute société des environs, se lie d'amitié avec Gatsby (qui est un peu, comme dans La grande belleza, le roi des mondains) dont il comprend qu'il a bâti toute sa fortune en poursuivant un rêve unique et obsédant : l'amour d'une femme à qui il s'est lié avant la guerre.
Ce qui fait merveille, chez Fitzgerald, c'est son regard sur les choses, et surtout, surtout, la distance où il se place vis-à-vis d'elles. Le narrateur de ce roman-là, Nick Carraway, est un exemple parfait de cette acuité rare : il est un témoin, un peu en retrait, tout en s'impliquant en bordure de l'intrigue (il sert principalement de maillon, de conduit des confidences qui s'écoulent jusqu'au lecteur), et sans faire mystère de ses propres sentiments (donc sans se laisser désincarner). La forme des événements, qui finiront par tirer Gatsby du côté du pathétique plutôt que de l'héroïsme, rencontre l'écho contradictoire du prisme émotif de Carraway, qui a nettement décidé de prendre le parti de Gatsby malgré son désaccord avec lui sur à peu près tous les points.
Fitzgerald a une exceptionnelle maîtrise de cette intonation si particulière qui me ravit au plus haut point et que j'ai appris à aimer chez Nabokov ou Proust: quelque chose de romantico-ironique, d'ironico-romantique, une expressivité subtilement désespérée qui ne renonce jamais au lyrisme sans résister, non plus, à débusquer le grotesque qui se cache ou se montre dans chaque pli de l'âme humaine.