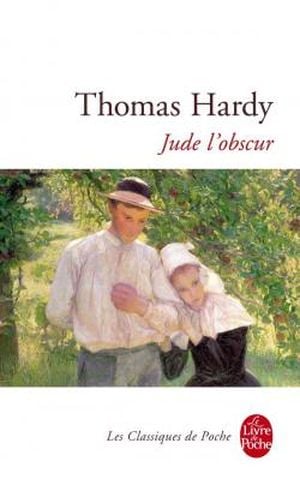Roman de la destinée tragique d’un jeune homme, pris entre ses aspirations à une vie intellectuelle qui lui est difficilement accessible, les vestiges d’un premier désir aveugle, et son amour pour une cousine elle-même en proie à des tourments moraux qui participeront aussi à rendre impossible un éventuel bonheur commun.
Comme sous le décret d’une détermination malheureuse, Jude semble né pour souffrir ; sa sensibilité, son honnêteté et sa naïveté sont contrariées et meurtries tout au long de son histoire. Où qu’il soit, il ne semble pas bien à sa place : tailler des pierres entraîne sa maladie, et la fascination qu’il garde pour la vie de Christminster, laquelle se lit jusque dans les gâteaux qu’il confectionne, nourrit un regret délétère au sein de son mariage – aussi ne peut-il s’empêcher de s’attarder lors d’une fête commémorative avant que d’assurer d’abord un toit à sa famille.
Sue n’est pas en reste, intéressant personnage qui selon moi a tendance à éclipser celui de Jude. L'état des lieux de sa conscience déchirée est donné dans sa complexité, et cette authenticité se retrouve même dans son revirement moral, à la fois étonnant et non. Que ses convictions premières soient balayées à la faveur d’un drame familial dans lequel elle lira un châtiment céleste, qu’elle renonce à son inclination libre et naturelle pour Jude pour entamer une pénible rédemption dans un remariage avec le professeur, jusqu’au sacrifice final qui lui réclame de se faire violence et d’âme et de corps pour surmonter l’insurmontable aversion, tout cela en fait une figure écorchée vive de la déchirure morale dont les dédales pénibles, les revirements et les décisions pour le pire dessinent remarquablement la vérité. A travers ce personnage, l’auteur sait aborder avec importance certaines épreuves relatives à la condition féminine.
Jude l’obscur met en lumière les oppositions qui peuvent exister entre la nature, sa nature propre, et les lois religieuses et les considérations sociales, tout comme en soi entre les désirs, charnel, amoureux, intellectuel, qui se livrent bataille et se freinent. L’institution du mariage est malmenée, dans une œuvre qui nous rappelle que deux êtres officiellement mariés ne le sont parfois pas réellement, quand deux êtres qui ne le sont pas aux yeux de l’Eglise peuvent l’être intimement de cœur et d’esprit. Un silence du narrateur sur le statut réel du couple à un moment (finalement discrètement marié ou non ?) chatouille ingénieusement la curiosité et le regard du lecteur sur la chose.
J’ai pu trouver que la mort des enfants était un événement un peu improbable et détonnant, un peu trop gros (sans être trop facile néanmoins), alors que dans une telle œuvre le regain du malheur aurait pu survenir de manière plus subtile, plus sournoise. Cependant, en convoquant, du point de vue de Sue, la sphère divine, autrement que sociale et plus que religieuse, cela ajoute une nouvelle dimension et un nouveau degré de souffrance à la complexité morale du personnage, avec l'idée d'avoir fauté au regard de Dieu. Cela grossit également la destinée du couple d’une dimension mythique, avec cette image qui nous vient à l’esprit d’un Chronos dévorant les enfants de la faute, qui n'auraient pas dû naître.
C’est une œuvre foncièrement pessimiste, où s’invite par moments une sorte d’ironie méchante (ainsi, par exemple, le maître d'école Phillotson ne reconnaît pas son ancien élève plein d’affection et avide de retrouvailles, et c’est Jude qui lui présente sa cousine bien-aimée, contribuant ainsi à sa propre infortune), et qui dit sans concession les difficultés, les illusions, les impasses, les défaites terribles d’une vie, en évoquant le déterminisme, la fatalité, d’où qu’elle vienne. Elle nous montre deux êtres qui ne peuvent pas être heureux ; où et avec qui soient-ils, Jude et Sue semblent regarder sur le côté, par manque, par incomplétude, et le semblant de bonheur qu’ils connaissent ne peut durer qu’un temps de bascule.
Le personnage d’Arabella est un modèle de malveillance et de cynisme occasionnels et médiocres : elle ne représente pas le mal, elle représente moins un adversaire qu’un obstacle presque indifférent dans la dynamique des adversités (voir avec quelle facilité elle se détache de Jude après qu’elle l’a ramené à lui), ainsi que le vulgaire, le grossier des sens et de l’esprit, quoique possédant sa propre perspicacité, en témoigne le mot de la fin ; sa brusquerie et son manque de sensibilité n’agacent pas comme peuvent même le faire à certains moments les réserves et l’entêtement de Sue, parce qu’on n’attend rapidement rien d’autre de sa part qu’une efficacité et un prosaïsme charcutiers. Il faut également reconnaître en Phillotson un homme heureusement doux et peu combatif, qui a préféré d’abord renoncer à son épouse plutôt que de lui faire violence, avant qu’elle ne finisse par choisir elle-même de se faire violence. Ces deux-là ne sont donc pas des figures contre lesquelles Jude et Sue auraient pu concentrer leurs forces pour obtenir une victoire ; les combats se font et se refont partout ailleurs et en soi.
C’est le presque trop étrange personnage du petit Père le Temps, fruit de mauvais mariage, qui donne l'impression d’avoir incarné toute la mélancolie, la fatalité, la menace qui pèsent sur les vies, sorte de bizarrerie appréciable et cohérente avec le ton général, et qui dit la défaite et la laideur d’un monde où les rencontres se produisent sous le signe de la vessie de porc ou des statuettes d’amour broyées.
Jude l’obscur est un tableau du malheur dépeint avec un regard attentif et distancié, comme revenu sans joie de toute illusion de bonheur possible, et où le parcours initiatique d’un couple se déploie à peine dans l’épaisseur des circonstances ; tableau qui dans son ensemble peut sembler sans éclat, assez pratiqué et commun en littérature, mais auquel la qualité du détail psychologique, la franchise et le pessimisme apportent un caractère et une profondeur remarquables.