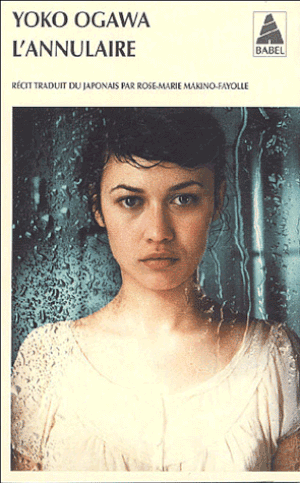Célèbre novella de la prolifique Yôko Ogawa parue en 1994, traduite du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle pour les éditions Actes Sud en 1999, «L’annulaire» s’aventure au-delà de l’étrangeté habituelle des récits de l’auteur, présente dès ces premiers écrits, pour pénétrer un territoire véritablement fantastique et obsédant.
Une jeune femme, employée dans une usine de sodas, a arrêté de travailler après avoir perdu un morceau de son annulaire sur la chaîne, dans la cuve de limonade. Suite à cet accident sans gravité, néanmoins point de bascule de son existence, elle a quitté son emploi, et son village en bord de mer pour la première fois.
«La seule chose qui m’a fait souffrir, c’est le fait que je me demandais où était passé le morceau de chair arraché à mon doigt. L’image qu’il m’en restait était celle d’un petit bivalve rose comme une fleur de cerisier, souple comme un fruit mûr. Il tombait au ralenti dans la limonade et restait au fond, tremblotant avec les bulles.»
Arrivant en ville, elle trouve par hasard un emploi dans un laboratoire, sis dans un immeuble paisible et défraîchi, un ancien foyer de jeunes filles où ne restent plus que deux anciennes pensionnaires devenues des vieilles dames. L’emploi mystérieux proposé par le fondateur de ce laboratoire, M. Deshimaru est désigné comme l’«aide à la fabrication de spécimens». Ces spécimens sont en réalité des souvenirs douloureux attachés à un objet, que leurs dépositaires souhaitent «naturaliser» dans ce singulier laboratoire, pour s’en détacher sans les endommager, et pour continuer à vivre sans eux. À l’instar de l’annulaire de la narratrice, ils représentent la perte, mais métaphorique, d’un fragment de soi.
«Tous les spécimens sont rangés et conservés par nos soins. C’est la règle. Bien sûr, nos clients peuvent venir leur rendre visite quand ils le désirent. Mais la plupart des gens ne reviennent jamais ici. C’est le cas aussi pour la jeune fille aux champignons. Parce que le sens de ces spécimens est d’enfermer, séparer et achever. Personne n’apporte d’objets pour s’en souvenir encore et encore avec nostalgie.»
Dans ce lieu envoûtant, mais à l’atmosphère troublante et légèrement malsaine, la narratrice, confinée mais libre de manipuler et de classifier les spécimens, connaît un bonheur sans limites. «J’aime beaucoup de laboratoire. Si c’était possible, j’aimerais y rester pour toujours. Je crois que M. Deshimaru m’y autoriserait.»
Mémoire, mort et séparation, les obsessions de Yôko Ogawa sont présentes dans «L’annulaire», mais aussi le fétichisme, l’érotisme, dans un registre fantastique qui rappelle certains récits d’Edogawa Ranpo. Finalement, le plus important est sans doute ici le non-dit, cet art si particulier d’évoquer sans les nommer les choses les plus importantes. Alors, en refermant le livre, on ne pourra s’empêcher de se demander qui parle, ou d’où parle la narratrice anonyme qui raconte ici son histoire, et d’admirer ainsi le génie de la mise en abîme opérée dans ce court récit par Yôko Ogawa.
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/07/21/note-de-lecture-lannulaire-yoko-ogawa/