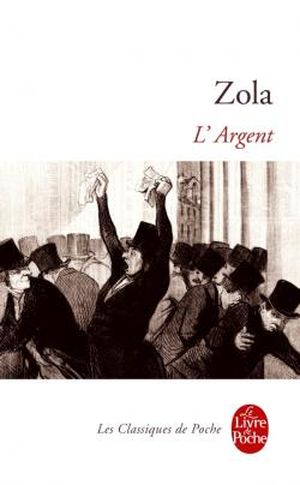En 1891, Zola se situe au plus fort de sa renommée. Unanimement reconnu pour sa qualité de romancier, il n’en est pas moins estimé (et décrié par la suite) pour ses engagements politiques. Aussi, après la vague du boulangisme, la présidence Mac-Mahon, il démontre ses talents de satire politique. L’Argent en est un très bon exemple. Une action qui se situe dans les années 1860, dans un Second Empire luxuriant mais dont le déclin s’amorce, un régime ultra-libéral, qui gagne tout à la Bourse. Saccard, redondant personnage des Rougon-Macquart, tente de s’établir une fortune colossale derrière une entreprise très branlante, l’Universelle comme il l’appelle, cotée à Paris.
Zola nous permet ainsi de découvrir ce monde du jeu, du hasard, de batailles sans merci, où tout le monde peut se retrouver plumer d’un jour à l’autre. On ressent presque l’ambiance des lieux comme d’une arène où l’on se déchiquète à mort. Les personnages sont tous très ambivalents, à tel point qu’on ne sait pas exactement sur quel pied dansent-ils : Saccard peut très bien promettre la fortune à tout le monde, et dépenser tous les capitaux de l’Universelle pour sa luxure personnelle. D’un antisémitisme sans borne (renforcé dans les années 1880 par le boulangisme ou les Drumont et consort), il voue une lutte sans merci contre Gundermann, le parrain vénéré de la Bourse de Paris, un juif qui possède une aura sacrosainte autour de lui, faisant que toutes les actions qu’il touche (alors qu’il dit ne jamais jouer) partent immédiatement à la hausse.
On sent qu’une épée de Damoclès se tient au-dessus de toutes ces têtes tout le long du livre. On a l’impression que Saccard ne pourra jamais monter autant s’il ne chute pas lourdement. Aussi, le chapitre X le voit, tel Napoléon à Waterloo, contempler son action, dépréciée de plus de 70% (pas de spoil, je pense que tout le monde attendait cette dépréciation) en une journée, au milieu d’un brouillard et de dépouilles ruinées. Superbe, il ne pense encore qu’à ses camélias. Mais cette comédie, si bien décrite par Zola (des graves répondant à des flûtes, des papiers rouges et verts s’entremêlant) doit bien avoir une fin.
Zola peut ainsi dénoncer cette racaille financière, affairée à se ruiner ou à s’enrichir quotidiennement, où une rumeur peut gâcher une entreprise qui a mis des années à se bâtir, ou bien en enrichir une sur le vif (la nouvelle de l’offre de la Vénétie par la Prusse à la France). Assise sur une chaise à trois pieds, cette bourgeoise financière ne peut qu’attirer les foudres des couches socialistes des années 1890, et faire dire à Zola que l’argent est un fléau sans nul pareil, en témoigne l’intéressante attention qu’il porte à Sigismond, le frère du juif Busch, marxiste très convaincu, qui propose des théories très plausibles à Saccard sur le collectivisme. Déterminisme historique (qui déplaisait pourtant beaucoup à Jaurès), mais qui montre que l'argent ne peut profiter s'il est utilisé sur des ouï-dires ou des rumeurs, comme une pièce perpétuellement posée sur sa tranche, et qui attendrait de tomber d'un côté ou de l'autre.