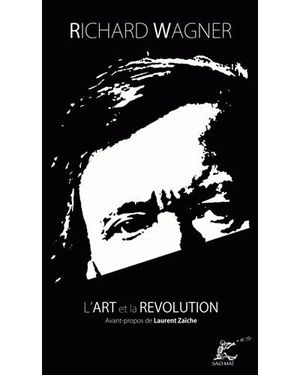Le Wagner bismarckien et zélateur de la grande Prusse a fait oublier à beaucoup l’autre Wagner, le révolutionnaire, l’insurgé favorable au peuple en armes, le compagnon de route des radicaux. Les éditions Sao Maï, en republiant son essai "L’Art et la Révolution", accompagné d’extraits choisis de son autobiographie et de quelques autres écrits, comblent cette lacune et dressent le portrait d’un artiste engagé, habité par une généreuse indignation. Participant activement à l’insurrection de 1848 à Dresde, Wagner aura été marqué par une rencontre fondamentale, celle de Bakounine, à qui il conservera sa sympathie jusqu’à la fin, ce qui lui vaudra d’ailleurs de se brouiller par la suite avec Gobineau. Défendant les intérêts sociaux des musiciens de son orchestre comme un vrai délégué syndical, rêvant d’instaurer un grand théâtre national démocratique et autogéré, impliqué dans une sombre affaire de fabrication d’explosifs, le Kappelmeister révolté, exilé à Zurich, rédige un court essai dans lequel il expose sa vision d’un art total et synthétique sur le modèle du théâtre grec.
Développant des idées qui ne sont pas sans faire penser à "La Naissance de la Tragédie" de Nietzsche, il explique que cet art antique est mort du morcellement des disciplines qui le constituaient, et que c’est de ce déclin, à l’époque romaine, qu’est né un sentiment diffus de mépris de soi, lequel a ouvert la voie au christianisme. Son texte prend alors le ton d’une diatribe violente contre la religion chrétienne, terreau le plus défavorable qui soit à l’éclosion d’un art vivant : « Le christianisme justifie une existence terne, inutile, lamentable, de l’homme sur la terre pour le merveilleux amour d’un Dieu, qui n’a nullement créé l’homme, ainsi que les beaux Grecs le croyaient par erreur, pour passer sur la terre une existence joyeuse, consciente de soi, mais l’a jeté ici-bas dans un cachot répugnant pour lui préparer, après la mort, en récompense de s’y être imbibé du mépris de soi-même, une éternité dans la plus béate et la plus inactive de toutes les splendeurs. » Il s’en prend également à Mercure, dieu du commerce, devenu le saint patron d’un art moderne prostitué à l’industrie. Rêvant d’une communion populaire autour d’œuvres se confondant avec la vie elle-même, Wagner rappelle qu’il ne saurait y avoir de rupture artistique sans révolution sociale. Comme l’écrit le préfacier Laurent Zaïche, le wagnérisme peut être vu comme un « phénomène à bien des égards anarchiste-conservateur ».