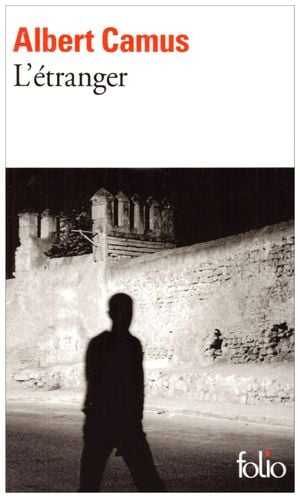Aujourd'hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais plus.
Probablement une des phrases d'introduction les plus célèbres - on ne compte plus les romans français et étrangers qui ont copié et réactualisé cet incipit, tant il a marqué la littérature contemporaine, à juste titre. Tant aussi il illustre parfaitement l'étrangeté de ce roman. Car l'étranger c'est tout autant le personnage de Meursault, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il a perdu sa mère et que ça l'indiffère, incapable de la moindre empathie, que le roman lui-même, un roman absurde, déphasé, au style concis et blanc, presque irréaliste dans la platitude de ce qu'il décrit.
Sans doute est-ce cliché que de le dire, mais L'Etranger est une sorte d'OVNI littéraire, à l'originalité remarquable bien qu'il soit devenu un classique de la littérature française et mondiale. Cela tient à l'étrangeté de son sujet et l'étrangeté de son traitement mais aussi au fait qu'il soit profondément marquant. L'histoire d'un homme qui n'a pas de sentiments pour les autres, l'histoire d'un homme qui prend toutes les mauvaises décisions et qui les paye au centuple, l'histoire d'un homme qui tue pour une absurde et sordide affaire, pressé par les coups de boutoirs d'un soleil insistant, l'histoire d'un homme inconséquent. Puis le roman bascule dans le procès de cet homme. Camus prend pour témoins les lecteurs et juge son personnage. Ce n'est pas seulement le jugement d'un meurtre, c'est le jugement d'une vie, c'est le jugement de la moralité d'un homme indifférent, incompatible avec notre société gouvernée par la tyrannie de l'émotion. On lui reproche presque plus d'avoir oublié sa pauvre mère que d'avoir sciemment abattu un arabe sur une plage. L'indifférence est pire que le meurtre. Le voilà bouc-émissaire, mouton noir, jeté au piloris, à attendre la mort, dans la "plus tendre indifférence" et "sous les cris de haine". Etranger à jamais.
Quand j'ai lu ce court roman pour la première fois, j'étais adolescent, j'étais révolté par l'injuste sort réservé à Meursault. Je trouvais les juges inhumains, je m'identifiais à ce personnage retors, rebelle, farouche. Et pourtant, je soutenais un assassin, un meurtrier, qui a tué non pas par accident mais sciemment un autre homme, de plusieurs balles de pistolet. Adolescent j'adulais l'inhumanité de Meursault, sa différence affichée, son indifférence volontaire. Camus m'avait pris au piège. En utilisant la première personne du singulier, en rendant son personnage non défini, physiquement, mentalement, presque neutre, presque blanc, un personnage vide de sens, il laissait ainsi le lecteur le personnifier à outrance, le remplir de sa propre psychologie, si bien que je finissais par m'identifier pleinement à Meursault. Nous sommes tous Meursault, et on en vient, pour cette raison, à accepter son mépris pour les autres et à presque justifier son crime, quelle posture intenable ! Quand Camus fait le procès de Meursault, en réalité il fait aussi le nôtre.
On se réfugie alors dans le point de vue des autres personnages mais on se rend compte qu'ils ne valent peut-être pas mieux que Meursault. Je pense par exemple à son amante qui, au début, pense à la mère de ce dernier, gênée, puis finit par trouver la situation normale. Raymond lui aussi est étrange, certainement pas un enfant de chœur et les juges à la fin font preuve d'une froideur et d'une intransigeance terrifiante. Au fond, tout le monde est un peu Meursault. Meursault n'est un pas un personnage, c'est la part indifférente de l'homme. Nous sommes tous des étrangers pour les autres et aussi pour nous-même. Ce constat terrible entre en écho avec la thèse d'un grand intellectuel concurrent de Camus, Jean-Paul Sartre qui disait de l'humanité que " l'enfer c'est les autres." Camus est un peu plus dérangeant, il ne remet pas la faute sur autrui, l'enfer c'est peut-être avant tout soi-même.
On ne peut pas comprendre Camus romancier si on ne comprend pas Camus philosophe. Penseur de l'absurde et de la révolte, il puise son inspiration notamment dans le travail de son professeur, Jean Grenier, sur les îles. Cela explique le rapport qu'entretiennent les personnages du livre avec le soleil. Meursault semble commandé par le soleil comme si le soleil était un dieu meurtrier qui exigeait des sacrifices et des crimes. Le soleil peut rendre malheureux. On peut vivre baigné de lumière, dans les rues ensoleillées d'Alger et ne plus pouvoir sortir du piège lumineux dans lequel les esprits fulminent. Il n'existe rien au delà de l'horizon de clarté. Camus résume les choses ainsi dans sa préface de Les îles de Jean Grenier : "Les hommes de la lumière, où fuiraient-ils, sinon dans l'invisible ?" Ce thème du soleil assassin est typiquement méditerranéen et infuse toute la littérature antique et bien au-delà. Le héros grec est guidé par la lumière. L'Iliade et l'Odysée irradient de lumière. Sauf que Meursault n'a rien d'un héros. Il est tout l'inverse, il est réduit à n'être qu'un corps physique à l'esprit guidé par des instincts primitifs, animaliers. Meursault ne se projette pas, il vit au temps présent. Cette phrase de Jean Grenier à propos de son chat peut éclairer son caractère : "Il joue et ne songe pas à se regarder jouer. C'est moi qui le regarde, et je suis enchanté de lui voir remplir son rôle avec une précision de mouvements qui ne laisse place à un aucun vide. A tout instant il est tout entier dans son action. S'il désire manger, ses yeux ne quittent pas les plats qui sortent de la cuisine et trahissent une si violente envie qu'on l'imaginerait transporté dans la nourriture même. Et s'il se pelotonne sur les genoux c'est avec l'application de toute sa tendresse (...) Ses actes coïncident avec ses mouvements (...). Si le chat allonge sa patte à moitié c'est qu'il est nécessaire qu'il l'allonge et qu'il l'allonge seulement à moitié. Le contours le plus harmonieux des vases grecs n'a pas cette nécessité."
Le roman est bref, il n'en a que plus d'éclat. Le style est blanc, plat. L'exemple le plus probant, c'est ce rendez-vous à la piscine avec l'amante de Meursault, une description sans aspérité, vide, sans sentiment. Meursault contemple les seins de sa copine et éprouve du désir. Il se demande pas ce qu'elle en pense, il ne pose pas d'autres questions, il ressent, il ne pense pas : il est tout entier occupé à sa tâche. il en est de même pour son meurtre. Il est en colère, il tue. Il ne calcule rien. Meursault a quelque chose du chat et donc d'inhumain. Meursault est tantôt Icare, épris de liberté, tantôt Sisyphe, esclave d'un monde de convention et oppressant. Il refuse de choisir parce qu'il vit absolument le temps présent. Il ne se projette jamais, sauf à la fin, dans la mort, enfin face à lui-même, comme retrouvé. Il y retrouve toute son humanité, toute sa dignité et le texte de Camus devient d'une poésie somptueuse. Sa conclusion est peut-être encore plus forte que son introduction.
On en vient alors au thème de la révolte. On pourrait dresser un parallèle entre ce roman et le film Joker de Todd Philipps. Meursault comme le Joker n'existe que par la révolte, le meurtre car c'est le seul moyen de sortir de l'ordinaire, de l'effacement, du désoeuvrement. C'est ce que soulignait Camus dans L'homme révolté. Lorsque Meursault tue, c'est pour exister. A la fin, il va mourir, jugé de tous, mais jamais il ne se sent autant vivant et lui-même que dans sa criminalité.
Ce roman est absolument parfait. Et le plus extraordinaire c'est qu'il est d'une accessibilité universelle, d'une simplicité déconcertante tout en emmenant le lecteur dans une interrogation philosophique infinie. Tout a été dit de ce livre, tout le monde ici ou presque l'a lu, il est un point de passage obligé. Un rite initiatique. Ce roman d'adolescent est sans doute la plus merveilleuse introduction à la pensée et à la littérature. Je me réjouis de savoir que des collégiens ou des lycéens pleurent ou exultent en lisant ces lignes. L'écriture n'est pas vaine. Ils reliront ce chef d'oeuvre, plus tard, et y verront tout autre chose. Ils apprendront à détester les juges d'abord, puis Meursault ensuite et enfin eux-mêmes, avant de relativiser. Car telle est la progression inéluctable de la réflexion qu'on se fait en lisant ce livre. On en ressort lessivé, fatigué, confus alors que le roman - mais est-ce vraiment un roman ? - se dévore en deux heures. On le referme, subjugué ou en larmes avec la certitude d'avoir grandi un peu plus.