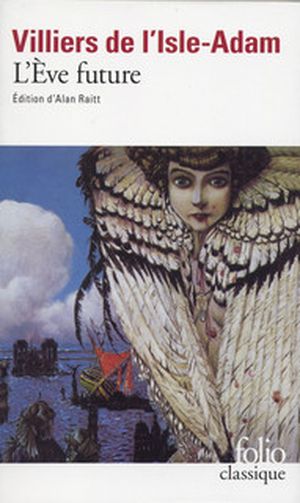Une Ève future pourrait-elle lire l’Ève future ? Nous tenterons d’y penser quand nous serons devenus de parfaits petits androïdes rendus immortels et invulnérables par la Silicon Valley.
Ceci dit, la science-fiction – ou l’anticipation, c’est la même chose ici – n’est qu’une des façons de lire ce roman. Tout aussi bien on peut le lire comme une satire de cette pensée mercantile, positive et philistine auquel Villiers ne cessa jamais de s’attaquer : « une grande artiste se mesure à l’argent qu’elle gagne ! » (livre VI, chapitre, 2, p. 961), déclare la belle mais incroyablement sotte Alicia Clary, qui devant la Vénus de Milo « s’écria[it] naïvement : / “Tiens, moi ! […] Oui, mais moi, j’ai mes bras, et j’ai l’air plus distinguée.” » (I, 18, p. 816). De fait, l’Ève future prend parfois des airs de profession de foi spiritualiste, tout en illustrant la misogynie très particulière de Villiers, chez lequel la femme est littéralement sacrée – c’est-à-dire intouchable au sens « hindouiste » du terme et objet de vénération.
Mais l’Ève future, c’est aussi la construction de deux caractères : on peut la lire comme un roman psychologique, voire « cérébral » au sens où l’entendait Gourmont. Il s’agit, en somme, de la rencontre entre un jeune aristocrate déçu (dans les deux sens du terme) par un sphinx sans énigme, et un scientifique plus âgé, inventeur éclairé qui considère que « l’amour moderne, s’il n’est pas seulement (comme le prétend toute la Physiologie actuelle) une simple question de muqueuses, est, au point de vue de la science physique, une question d’équilibre entre un aimant et une électricité » (II, 10, p. 864).
Comme souvent chez Villiers, les personnages s’analysent eux-mêmes : « Tenez, mon cher lord, à nous deux, nous formons un éternel symbole : moi, je représente la Science avec la toute-puissance de ses mirages : vous, l’Humanité et son ciel perdu. » (II, 6, p. 845) déclare l’électricien au noble – c’est d’ailleurs cette lucidité qui distingue Edison d’un Prométhée ou d’un Victor Frankenstein : il sait que « tout homme a nom Prométhée sans le savoir – et nul n’échappe au bec du vautour » (II, 6, p. 841). De la même façon, Ewald est trop déçu par autrui pour mourir de sa propre main, comme le ferait un héros romantique lambda. Cependant, ce qui unit le plus profondément ces deux personnages, c’est le fantasme de toute-puissance, de toute-maîtrise si on préfère, qui les anime.
En fin de compte, on n’est même pas obligé de lire l’Ève future comme un roman : les dialogues s’y taillent la part du lion, la coïncidence entre temps de l’action et durée de la lecture est presque généralisée, et la division en trois journées – la première très longue, la deuxième en moins de deux livres, et la troisième en un chapitre – constituerait les trois actes d’une tragédie dans laquelle l’expérimentation tient lieu d’action. L’Ève future serait l’inverse du Prétendant ou du Nouveau Monde de Villiers, pièces de théâtre qui ressemblent à des romans.
Le récit de Villiers – et celui-ci en avait conscience – a quelque chose d’unique : sans véritable modèle dans l’histoire littéraire, ni descendance identifiable. Sous certains aspects, il est bourré de défauts : lent, invraisemblable, emphatique voire boursouflé, – et par ailleurs une épreuve pour typographes !, – il a pour lui une grande générosité, dans le sens où, dès sa dédicace « Aux rêveurs, Aux railleurs », il propose aux lecteurs une réflexion à la fois riche et ambiguë, qui ne se réduit pas à quelque débat sur le thème science et éthique.