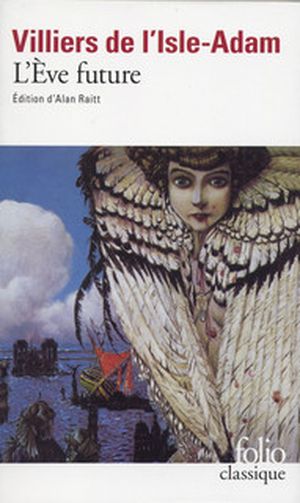Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889) n'a pas eu la vie facile. Né aristocrate breton trop tard, à une époque post-révolutionnaire où les ors et prestiges de la noblesse d'Ancien Régime sont gravement démonétisées, il peint dans son œuvre la tragique victoire de la modernité sur la pensée traditionnelle. D'opinion très conservatrice, d'éducation très catholique, il prend de plein fouet le choc du machinisme, du scientisme, et expérimente toute sa vie, somme toute brève (mort à 51 ans), le peu de cas que l'on fait d'une culture classique dans un monde devenu bourgeois, cynique et mécanique.
Subjugué par les inventions d'Edison et de ses précurseurs (le télégraphe, le phonographe, le téléphone), il met en scène dans « L'Eve Future » ce génie scientifique de son temps, présenté à grands renforts d'effets romantiques comme un nouveau Docteur Faust œuvrant dans son cabinet à toutes sortes d'innovations géniales, au milieu d'un bric-à-brac énigmatique rappelant le laboratoire d'un alchimiste.
L'inspiration et les références de Villiers sont aisément repérables au fil du roman : Menlo Park (le domaine d'Edison) rappelle trop « Le Cottage Landor » des « Histoires Grotesques et sérieuses » d'Edgar Poe, pour qu'on n'y retrouve pas l'amitié qui unissait Villiers à Baudelaire, traducteur de Poe.
Au début du roman, les fantasmagories de Menlo Park, vite expliquées par la technique, restent dans la lignée des romans gothiques « à explication rationnelle » comme ceux d'Ann Radcliffe.
Loin d'être présenté comme un technicien borné et desséché, Edison montre des capacités de réflexion philosophique d'une ampleur considérable lorsqu'il minimise l'importance de ses découvertes, et lorsqu'il pense avec mélancolie aux voix du passé qu'il aurait pu enregistrer s'il n'était né si tard. Ce sentiment de n'être pas de son temps, couplé avec celui de considérer les choses sous le regard de l'éternité, est typiquement romantique. Mais, - aristocratie bretonne et catholique oblige – le gros des voix et des images du passé qu'Edison regrette de n'avoir pu enregistrer relève de récits bibliques, et d'une solide culture gréco-latine.
Le côté prométhéen et l'ampleur de vues d'Edison en font un second Docteur Faust, qui ose envisager de capter l'image même de Dieu. Faust est une icône de cette génération post-romantique, depuis que Nerval (mort alors que Villiers avait 17 ans) a traduit en français les deux « Faust » de Goethe. Edison parle lui-même de ses inventions comme des « miracles », dignes parfois des « Mille et une Nuits » (I, IV), et tout le roman de Villiers oscille entre le féérique subjectif et la tristesse stupidement technique de la réalisation des souhaits les plus chers. En fait, l'invraisemblance vient de ce que Villiers substitue sa sensibilité classique et romantique à celle d'Edison, qui se montre, de ce fait, d'autant plus universel, qu'il est capable de se distancier de ses propres réalisations au point de les envisager sous un angle magique et poétique.
Ce roman est fondé sur la dissociation de la beauté et de l'âme pure : Lord Ewald, à qui Edison est redevable, est tombé fou amoureux d'une fille parfaite mais assez inconsciente de sa propre beauté. Les vrais amoureux idéalistes n'auront pas manqué de ressentir au moins une fois ce sentiment : pourquoi celle que j'aime n'est-elle pas consciente de la supériorité que lui confère sa beauté, et se comporte-t-elle d'une manière aussi commune que possible ?
Cette dissociation conduit Villiers à représenter des personnages féminins plastiquement parfaits, mais vidés de toute chaleur émotionnelle (écho érotisé du désarroi que les romantiques tardifs éprouvent face à un monde qui concrétise les rêves magiques grâce à la technique, mais qui, par là même, en chasse le merveilleux, l'ineffable et le sacré). La description d'un membre de femme amputé, mais revêtu de tous les artifices de beauté (I, VIII) est déjà dans le ton de ces beautés lointaines et idéales fin-de-siècle, dont l'exotisme et l'indifférence peuplent les tableaux des symbolistes et nourrissent le spleen des prétendants, conscients de leur incapacité à s'emparer de l'âme en sus du corps de l'aimée.
Les références fréquentes à l'Antiquité accentuent cette schizophrénie platonicienne : la femme idéale apparaît comme figée dans le marbre antique de sa beauté, que plus aucune chaleur ne saurait mettre en mouvement. Le cœur est orphelin de son anima en ces temps de matérialisme mécaniste.
Edison outrepasse la vraisemblance dans laquelle un personnage de roman doit être contenu : non content d'être un inventeur génial et universel aux vues philosophiques élevées, il se transforme en personnage de mythe immémorial : il se fait Dieu créateur en confectionnant dans le secret de ses caves des corps de femmes parfaites (et l'ombre de Frankenstein rôde tout près, née elle aussi du rêve que la science pourrait se faire créatrice à l'égal de Dieu) ; il se fait Diable en soumettant Ewald à la tentation d'un Pacte : accepter de se voir confectionner une créature de rêve en échange du renoncement au suicide. Il se fait Prométhée en s'immisçant dans les règles communes de la création. Il se fait Pygmalion en façonnant la femme idéale selon les configurations suggérées par le désir d'Ewald. C'est beaucoup pour un seul homme, tout de même. Mais le romanesque y trouve son compte.
On sera reconnaissant à Villiers de formuler à l'avance les conceptions jungiennes de l'anima : en effet, l' « âme » idéale qu'Ewald reproche à Alicia de ne pas avoir, c'est en fait le désir d'Ewald lui-même qui la produit et qui la projette sur une créature. La notion de « projection » (psychologique ou cinématographique) est récurrente. On ne s'étonnera pas davantage que le mot « illusion » revienne souvent dans le roman. Le chapitre VI, VIII est admirable à ce sujet : l'anima est intime, personnelle, archaïque, riche de toutes les potentialités de métamorphoses, manipulatrice, perceptible aux confins de l'inconscient.
En soi, ce constat est une tragédie : il met en lumière le caractère illusoire de l'espoir romantique de l'Amour idéal. Le surgissement cynique de la technique toute-puissante renvoie le désir à l'intériorité, à la subjectivité, et, si Ewald désire se suicider, c'est qu'il est l'un des derniers héritiers d'une époque agonisante où l'on pouvait se permettre de projeter son désir sur le réel, dans toute sa littéralité.
On s'étonne davantage que Edison – probable porte-parole de Villiers – se lance dans une longue diatribe venimeuse contre les femmes sans intelligence qui piègent les hommes au cœur pur mais naïfs ; l'anima est devenue poulpe, araignée, vampire, et mérite la mort précisément pour n'être que l'émanation d'un pur instinct de prédation visant le mâle vulnérable. Villiers doit régler par là quelque compte personnel. La Femme Fatale – Mortelle ainsi dessinée est bien loin de l'Idéal romantique, et la fange des instincts de mort qu'elle attise commence à pencher vers Freud. Ce morceau d'anthologie de misogynie est réjouissant en notre époque de pensée unique, où il faut penser que tout le monde est beau et gentil.
L'ironie se situe donc dans la recherche d'un nouvel Idéal vers le bas (l'antre souterrain des expériences d'Edison est profond et glacial, mais on y trouve un Eden reconstitué grâce à la technique), ce qui est inhabituel dans la symbolique. On y recherche le féminin dépouillé de ses artifices séducteurs, toujours enrichis au fil des millénaires par les progrès de l'ingéniosité cosmétique. Le rapport nouveau à la femme (le choix de l'Artifice séducteur technologiquement purifié de toute perversion, de toute imbécillité létale) reflète le nouveau rapport au monde : l'irruption de la Machine toute-puissante dépoétise le cœur de l'Homme. L'Eve Future est le fruit du désespoir né de la vision d'un monde qui agonise.
Si Edison est à ce point placé au-dessus du commun des mortels, c'est que ses inventions présentaient des affinités avec les désirs magiques de l'enfance. Mais, lorsque Villiers en arrive à l'indispensable notice technique du fonctionnement de « Hadaly » (sa poupée marchante où doit s'incarner la beauté d'Alicia), on voit de l'électricité partout, du fer, de l'huile de roses, dans un assemblage étonnant qui frise le comique involontaire. Villiers est un poète, pas un technicien.
Sur le fond, la distance que prend Villiers – contraint et forcé – avec le monde moderne qui lui déplaît se manifeste dans le sens ironique sous-jacent du récit : l'homme moderne doit, pour être heureux, se contenter de l'artifice, de la poupée (pas gonflable, mais...). L'éternité que l'on recherche dans l'amour est garantie par la répétition assurée des gestes, expressions et paroles qui ont séduit la première fois. Ce fixisme dans la séduction semble faire fi de l'évolution naturelle des désirs et des sentiments, mais, précisément, répond au besoin d'enfermement de Villiers dans un passé que le monde moderne ne saurait en aucune manière faire revivre (sauf Edison, qui se fait pour l'occasion apologiste de l'Illusion).
Les nombreuses citations placées en épigraphe des nombreux chapitres (dont certains sont assez courts) montrent que Villiers a soigneusement découpé le récit en mini-séquences, dont chacune est raccordée à une ou plusieurs références littéraires ou mythologiques : pour donner de la chair à son récit, Villiers a pensé en philosophe et en héritier de la culture classique avant même de se documenter sur les oripeaux techniques gracieusement offerts par Edison.
Villiers, ambitieux candidat à la succession des plus grands romanciers français du XIXe siècle, écrit dans une langue recherchée, dont les nuances vont parfois jusqu'à une relative obscurité, et soucieux d'une pertinence lexicale au point de forger quelques néologismes supposés mieux traduire sa pensée (illécébrant, duyser, projectif, compoinct...).
Le troisième quart du roman est relativement fastidieux : Edison y décrit en de nombreux et brefs chapitres les secrets de la composition et du fonctionnement de son Andréide. Visiblement, Villiers a voulu sacrifier à la science-fiction de son temps, mais ces exposés sont rédigés selon le vocabulaire scientifique de l'époque (allez donc le traduire en vocabulaire scientifique actuel, si vous avez du temps à perdre !), laissent dans le flou quelques effets miraculeux (ce n'est pas avec ses « cylindres gravés » qu'Edison peut expliquer la capacité de l'Andréide à répondre à n'importe quelle phrase !), et constituent parfois une cuisine modérément appétissante (l'épiderme de l'Andréide contient de l'amiante...). Parfois, Edison-Villiers est obligé de recourir à des explications qui étaient peu admises par la science de l'époque (et encore moins aujourd'hui), telles que l' « état radiant » de William Crookes comme quatrième état de la matière, hypothèse qui servait à Crookes, vrai savant mais spirite, à expliquer les communications paranormales ; ou encore, à la communication « fluidique » émanant de l'énigmatique Sowana...
En revanche, la description de l'inquiétude et de l'agitation du monde extérieur lorsque Edison s'enferme chez lui pour fabriquer son Andréide, est brossée avec une ironie mordante et d'une grande drôlerie.
Rédigé dans une langue serrée jusqu'à la préciosité fin-de-siècle, le roman de Villiers de l'Isle-Adam témoigne de la perte d'un monde où l'imaginaire tenait une plus grande place dans la vie quotidienne, plus encore celle des poètes et des sensitifs. Le désespoir que ce romantique tardif éprouve face à la machine et à la tristesse du positivisme est nappé d'une ironie sourde. A nous de retrouver les voies qui mènent aux mêmes sources imaginatives en nous-mêmes, sous peine de laisser la machine de la Culture marchande substituer ses images et ses délires à nos propres rêves. Il y va de notre identité.