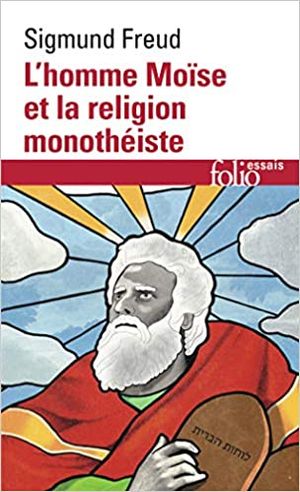Nature de l’ouvrage
Trois essais, de longueur croissante, à propos de Moïse et de la fondation de la religion juive. Les deux premiers essais proposent des hypothèses de nature historique. Le troisième essai, de loin le plus long, propose des hypothèses psychologiques.
Contenu de l’ouvrage
Le premier essai
Le premier essai, très court, propose une thèse frappante : Moïse, dont le nom est d’origine égyptienne (cf. Ra-mses, « enfant de Râ »), était un égyptien. L’analyse du mythe de ses origines le révèle. En effet, la fonction d’un mythe des origines est de légitimer le héros ; c’est pour cela que, le plus souvent, le mythe raconte comment un héros de basse extraction se trouve en réalité, dès le début, être un prince (Œdipe, par exemple, mais c’est loin d’être le seul). Or, dans le cas de Moïse, c’est le contraire : le prince se révèle être de basse extraction. Conclusion de Freud : le mythe cherche à intégrer Moïse, d’origine égyptienne, à son peuple juif d’adoption.
Le second essai
[Pour un résumé par Freud lui-même de ce second essai, on pourra lire la première section du troisième essai (« A – La Prémisse historique »), d’une dizaine de pages.]
Le second essai approfondit cette thèse. Que Moïse soit égyptien, cela suggère une hypothèse quant à l’origine de la religion monothéiste juive. En effet, le premier monothéisme dont nous ayons une trace est égyptien : c’est le culte d’Aton, instauré dans au XIVème siècle par Amenothep IV, qui prit le nom d’Akhenaton durant son court règne, de 1375 à 1358.
À l’appui de cette hypothèse, plusieurs fais marquants. D’abord, l’un des noms du dieu juif : Adonaï, où l’on reconnaît la racine Aton. Ensuite, la nouvelle religion juive, comme la religion d’Aton, ne parle nulle part de vie après la mort – trait fondamental de la religion polythéiste égyptienne, et auquel s’était opposé vigoureusement la religion d’Aton. Plus frappant encore, le fait que la circoncision est une pratique d’origine égyptienne d’après Hérodote, et que les égyptiens avaient, déjà, une horreur des porcs [ainsi que de la vache ; mais cela ne retient pas vraiment l’attention de Freud, sinon pour indiquer que c’est un trait qu’on retrouve chez les Hindous]. De plus, Moïse aurait eu la « parole difficile », signe possible d’une origine étrangère. De là, Freud fait l’hypothèse que les fameux lévites seraient d’abord les proches égyptiens de Moïse l’ayant accompagné, puis leurs descendants. D’ailleurs, le caractère irascible de Moïse pourrait être expliqué par ses origines étrangères et royales : il n’était pas habitué à traiter avec des populations peu éduquées et peu disposées à lui obéir.
Dans ce contexte, l’hypothèse de Sellin, selon laquelle Moïse aurait été assassiné par son peuple, acquiert un élément de vraisemblance supplémentaire : étant égyptien, sa domination aurait été d’autant plus dure à accepter pour les Juifs.
Vient alors le moment d’expliquer le lien entre Adonaï et Yahvé. L’écriture biblique garde la trace d’une fusion entre les Juifs arrivant d’Égypte, et de peuples sémites du pays de Canaan. Ces peuples avaient, parmi leurs Dieux, un Yahvé, dieu des volcans. Sans que l’on puisse savoir ce qu’il s’est passé exactement, il semble qu’un compromis ait eu lieu, d’où Yahvé soit ressorti « gagnant ». Le personnage de Moïse, colérique, est fusionné avec un autre individu, prêtre de Yahvé, au caractère doux.
Mais ce compromis effaça la religion des juifs égyptiens pendant plusieurs siècles. Yahvé n’est pas Aton, il a les traits du dieu des volcans, et le texte garde la trace d’une religion assez primitive à ce moment-là. Ce n’est que bien plus tard que les prophètes réactualisèrent l’héritage égyptien de Moïse, à savoir la conception d’une religion spirituelle, opposée à la magie et aux idoles, où la divinité n’exige que la foi et une vie de vérité et de justice. Ces caractères proviennent de la religion d’Aton, et ont dû se confronter, sans succès au début, aux pratiques et aux idées des populations juives, pour finir par s’imposer en fin de compte.
Le troisième essai : première partie
Dans le troisième essai, Freud s’interroge : comment se fait-il que les idées mosaïques d’origine égyptienne, plus ou moins oubliées au moment de la fusion d’Aton avec Yahvé, aient fini, non seulement par réapparaitre, mais même, par s’imposer ? Il s’agit là d’une question psychologique et non plus seulement historique.
Un tel phénomène de refus, puis d’acceptation d’une nouvelle idée, s’observe souvent : la théorie darwinienne de l’évolution est un exemple parmi d’autres d’idée ayant pris du temps à être acceptée. Plusieurs autres analogies sont proposées par Freud, mais celle qui retient son attention est la névrose traumatique, dont la source est un souvenir oublié de la petite enfance qui ressurgit plus tard, sous forme de conflit psychique plus ou moins conscient.
Le traumatisme, ici, serait le meurtre de Moïse, qu’il aurait fallu expier. Dans cette optique, le christianisme propose une solution au conflit : un individu innocent prend sur lui la faute, et sa mort, en rejouant la scène du meurtre, permet de s’en libérer : « le christianisme fut un progrès du point de vue de l’histoire religieuse, c'est-à-dire sous le rapport du retour du refoulé : à partir de ce moment, la religion juive fut en quelque sorte un fossile » (p. 181).
Reste à comprendre cependant comment le souvenir de Moïse ait pu perdurer au travers des siècles et des pratiques contraires. On doit postuler, nous dit Freud, la possibilité d’une transmission de souvenirs inconscients à ses descendants, via la génétique. Après tout, les animaux possèdent bien des instincts, qui sont des connaissances innées, et la pratique psychanalytique, nous affirme-t-il, montre maints exemples de telles transmissions générationnelles.
Troisième essai : deuxième partie
Cette deuxième partie est, nous dit Freud, le premier jet de la première partie : la matière est la même, la forme change.
Ici, on chercher à comprendre la formation du caractère juif, fier et spirituel. Pour Freud, les Juifs doivent ce caractère à Moïse, « grand homme », c'est-à-dire figure paternelle pour un peuple. D’abord, une partie de la fierté des Juifs est due à l’élection dont ils auraient fait l’objet. Le peuple Juif est le peuple élu, choisi par Dieu. Par suite, plus Dieu sera grand, plus on sera fier, mieux on se sentira protégé. Freud compare la fierté du Juif à la fierté du Britannique au milieu du British Empire qui sait que personne n’osera lever la main sur lui.
Moïse, en bonne figure paternelle, a également fixé les interdits, dont, notamment, l’interdit de la représentation. Ce dernier explique à la fois la fierté et la spiritualité du peuple Juif. En effet, l’interdiction de la représentation oblige la religion à se spiritualiser, à s’éloigner de la vie des sens. Or, nous dit Freud, tout progrès dans le sens d’une spiritualisation a pour effet d’accroitre l’orgueil de l’individu, qui regarde comme d’en haut ceux qui ne sont pas « parvenus » à se détacher du monde sensible. Contrairement aux Grecs, les Juifs n’ont pas développé d’idéal de beauté ou de force physique : ils sont restés du côté de l’intellect.
Mais pourquoi un progrès spirituel cause-t-il de la fierté ? Pour Freud, c’est là la conséquence de l’enfance, pendant laquelle l’individu, pour faire plaisir aux parents, doit limiter ses pulsions. La contrepartie de la frustration causée par le renoncement est le plaisir de sentir qu’on mérite l’amour, c'est-à-dire, la fierté.
Pour les Juifs, le père, c’est Moïse, et le renoncement, tous les interdits et prescriptions de la religion. On comprend ici que ce renoncement aux pulsions constitue le véritable cœur de la religion, plus encore que la foi. Le sacré, l’interdit, c’est la volonté du père primitif, une volonté qui se transmet inconsciemment à travers les générations, et que l’on ressent d’autant plus fortement.
Reste à comprendre la force psychique de la religion. Il faut penser, nous dit Freud, que cette force provient de la vérité historique de la fondation de la religion, qui commence par le meurtre du père et la culpabilité qui s’ensuivit (cf. Totem et tabou, 1912). La relation au père, en effet, est toujours ambivalente. On veut mériter son amour, mais on lui en veut de devoir renoncer aux pulsions. La religion juive, ne laissant aucune place à l’expression de cette haine du père, aggrave le sentiment de culpabilité (causé par cette haine), et pousse ainsi à toujours plus de renoncements.
Le Christianisme, dans ces conditions, proposa une issue : tuer le Père sous les traits du Fils, et « à la place de l’euphorique sentiment d’élection, il y eut désormais le rachat libérateur » (p. 242). Ainsi, il faut dire que le reproche chrétien à l’égard des Juifs – d’avoir tué Dieu – trouve sa justification psychanalytique profonde : les Juifs sont ceux qui refusent de reconnaître ce qui est pourtant vrai depuis le début, à savoir qu’ils ont, comme tous les autres, tué le père primitif.
Remarques
Les hypothèses de Freud sont, évidemment, hardies. Freud avait envisagé, d’ailleurs, d’intituler son ouvrage Roman historique. Mais le psychanalyste a beau indiquer à plusieurs reprises sa conscience de proposer des hypothèses fragiles, on ne peut qu’être frappé de l’assurance générale du ton qu’il emploie. On se prend à croire à ce qu’il avance, même lorsqu’il affirme des thèses à proprement parler farfelues. Ce ton, on le retrouve dans tous les ouvrages de Freud, mais il n’est nulle part aussi frappant qu’ici, où il est souvent évident qu’un tel ton n’est pas justifié. C’est peut-être de là, de ce ton, que vient l’assurance antiscientifique des psychanalystes contemporains, malgré l’insistance répétée de Freud sur l’importance fondamentale de la démarche scientifique...
Avis
Lecture amusante, stimulante, agréable : on recommande.