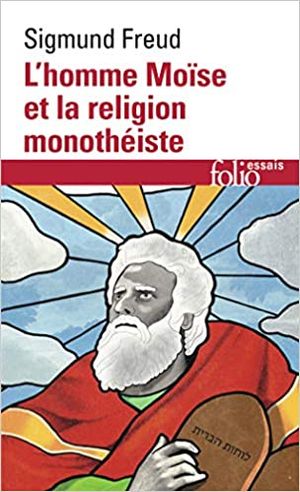Dans son livre, Freud n’utilise jamais les termes "nous" ou "mon peuple" en parlant des Juifs, bien qu’il emploie volontiers ces expressions dans d’autres contextes. Il préfère toujours dire "eux" ou "le peuple juif". Dans un moment aussi crucial pour le destin des Juifs (avec Hitler au pouvoir), Freud semble vouloir éviter toute accusation de partialité. Pour prouver son objectivité scientifique, il va jusqu’à suggérer que "le plus grand des Juifs", Moïse, n’était pas juif. En émettant une hypothèse aussi dérangeante pour les Juifs, Freud cherche à convaincre ses lecteurs de la solidité de sa démonstration.
Ce qui est peut-être le plus troublant dans cette position, c’est que Freud n’a pas inventé l’idée de l’origine égyptienne de Moïse. Cette théorie était déjà bien présente chez certains intellectuels allemands. Elle était presque devenue un lieu commun dans les écrits sur Moïse, le père du peuple juif. On la retrouve chez Goethe, dans les travaux d’égyptologues de l’époque, chez Max Weber, et même chez Joseph Popper-Lynkeus, un proche de Freud. Cependant, l’influence directe vient de l’historien et archéologue allemand Ernst Sellin. Dans son livre publié en 1922 (Moïse et son importance dans l'histoire de la religion israélo-juive), Sellin affirme que Moïse aurait été assassiné par des Juifs. Freud reprend cette idée, aussi invraisemblable soit-elle, car elle s’inscrit dans la reconstruction historique qu’il entreprend. Il avait besoin d’un lien avec sa théorie développée dans Totem et Tabou, où le meurtre du père joue un rôle central. Ce lien devient indispensable, car Moïse et le monothéisme pose des questions similaires : comment une tradition naît-elle et se transmet-elle ?
Cette question semble obséder Freud, et pour deux raisons principales : 1) Il a rompu avec la tradition juive concernant sa descendance, mais continue de se percevoir et de se revendiquer comme juif. 2) En parallèle, il est en train de fonder une nouvelle tradition – presque une religion – avec ses disciples, qu’il considère comme une horde dont il est le père tout-puissant, tout en sachant qu’ils cherchent à le renverser.
Mais comment la tradition juive s’est-elle transmise à travers les siècles ? Freud rejette l’idée d’une transmission directe. Si cela avait été le cas, une tradition n’aurait ni l’intensité émotionnelle des phénomènes religieux ni leur capacité à échapper à la pensée rationnelle.
Doit-on alors faire appel à l’idée d’un inconscient collectif, chère à Jung, autrefois héritier de Freud, mais devenu son ennemi et sympathisant du nazisme ? Freud écarte fermement cette hypothèse.
Pour lui, la seule explication réside dans le modèle qu’il a développé dans Totem et Tabou. Moïse et le monothéisme n’est finalement qu’une reprise de cette théorie, appliquée à l’histoire juive, vingt ans après sa publication. À cet âge avancé, Freud ne cherche plus à innover ; il revisite et reformule ses idées pour expliquer les origines du peuple juif.
Résumons à nouveau : au commencement des temps, le père primitif a été assassiné par ses fils ; ensuite, dans le polythéisme, ce père a été complètement oublié, sa mémoire refoulée. Le monothéisme est le retour du refoulé sous la forme d’un Dieu unique et omnipotent. Le formidable impact de la révélation de Moïse proviendrait de ce qu’il rappelle au peuple juif ce Père perdu après lequel l’humanité a toujours soupiré. D'où l’impression d’être le peuple élu. Mais même cet enseignement de Moïse n’aurait pu à lui tout seul devenir une « tradition ». Pour qu’il en soit ainsi, Moïse devait, dans un remake du parricide primitif, être à son tour assassiné, et son enseignement oublié. Après une période de latence qui aurait duré de cinq à huit siècles, la religion mosaïque revint à la conscience du peuple juif pour tous les âges à venir.
Ce château de cartes ne peut tenir debout que s’il s’appuie sur le contrefort de l’hérédité des caractères acquis, théorie chère à Lamarck. Et Freud le reconnaît explicitement : "En admettant que de semblables traces mnésiques subsistent dans notre hérédité, nous franchissons l’abîme qui sépare la psychologie individuelle de la psychologie collective, et nous pouvons traiter les peuples de la même manière que l’individu névrosé." Rejoint-il Jung sans le nommer ? D’une certaine manière.
Certes, Freud admet que la biologie "à l’heure actuelle, ne connaît absolument l’hérédité des qualités acquises", mais il ajoute immédiatement qu'en toute modestie, que, malgré cela, il nous paraît impossible de nous passer de ce facteur quand nous cherchons à expliquer l’évolution biologique. Pourtant cela serait aussi impossible, nous venons de le voir, dans les domaines de la psychanalyse et de la psychologie. En fait les assertions inspirées de Lamarck pullulent dans le Moïse... sans que pour autant il ne soit jamais nommé.
Freud, en fin de vie, le dos au mur de la mort, est obligé de passer par Lamarck pour faire la pige à Jung et sortir de sa propre contradiction de godless jew, de « juif mécréant », comme il se désigne lui-même. S’il est encore juif, malgré tous ses efforts pour rompre avec la tradition, c’est à cause de l’hérédité des qualités acquises. Et il en va de même pour tous les Juifs, qui restent juifs même convertis et baptisés, même apostats, même germanisés, même athées, même païens. Terrible argument offert au nazisme. S’agit-il de concurrencer Jung sur le terrain glissant, fangeux où son ancien disciple s’aventure au même moment dans l’Allemagne hitlérienne ? (Ah ! Il faut faire l’histoire de la psychanalyse dans l’Allemagne nazie — elle n’a jamais été vraiment écrite — et du silence de Freud à son propos). S’agit-il de s’engouffrer dans la voie ouverte un siècle plus tôt par Benjamin Disraeli ? Le célèbre Premier Ministre britannique, fier de ses origines juives, et convaincu de la supériorité de sa "race", fait dire, dans son roman Tancrède, à un magnat de la finance juive : "Tout est race : il n’y a pas d’autre vérité." Formule qui sera citée ad nauseam par les nazis pour justifier leur propre racisme.
L'ouvrage de Freud est à la fois désespéré et insensé. Si l’on devait accorder du crédit à la reconstitution historique qu’il emprunte à des penseurs allemands, et admettre que les Juifs ont réellement tué Moïse, ce meurtre n’aurait pas été refoulé, mais plutôt largement relaté dans la Bible. En effet, la Bible et la Midrash (l’exégèse juive) sont remplies de récits de prophètes assassinés, lapidés ou lynchés. Le meurtre de Moïse lui-même est même envisagé dans certains commentaires midrashiques.
Dans la tradition juive, le choix divin d’Israël s’accompagne d’une règle : aucune de ses fautes ne doit être oubliée. Le récit de Freud apparaît donc d’autant plus invraisemblable qu’il contredit tout ce que l’on connaît du judaïsme à travers les siècles.
Reste encore une question. Si Moïse, l’Égyptien, a légué le monothéisme au peuple juif installé en Égypte comment ce peuple pouvait-il se distinguer des Égyptiens ? Question inextricable. Alors ? Puisque les Égyptiens eux aussi pratiquaient la circoncision et le monothéisme, le peuple juif est-il supposé décider à un moment donné de faire son choix ? Le choix serait d’autant plus légitime que la place du peuple juif dans la Bible n’était pas assimilable à celle des Égyptiens. Ce peuple n’était-il pas assimilable ? Ainsi, Freud incite, son lecteur pour l’antisémitisme servi sur un plateau de Hitler.
Freud lui aussi fait le mal pour le monothéisme.