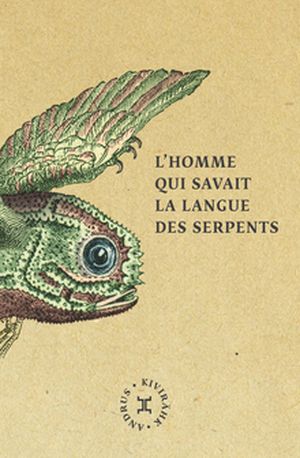L'homme qui savait la langue des serpent se commence un peu mollement mais ne se lâche plus avant les dernières pages, malgré la noirceur du récit, malgré la tristesse lucide du propos.
C'est une fable qui raconte la métamorphose des "premiers" Estoniens chasseurs-cueilleurs en "hommes modernes" qui plantent des graines, mangent du pain et prient Dieu. Pourtant, point d'idéalisation bien puante du "c'était mieux avant", au contraire : les fanatiques anciens ou modernes sont repoussants, les arrivistes sont partout, et quoiqu'il arrive, les hommes sont les hommes. Le sauvage ne vaut pas mieux que le paysan, tout dépend des personnes et puis c'est tout. Certains fuient la forêt parce que le top de la modernité c'est d'utiliser un rateau et tous ces beaux outils venus de l'étranger, d'autres les suivent parce qu'ils savent que c'est le futur et que rien ne sert de vivre dans le passé. Ce qui est drôle, c'est qu'on comprend vite qu'on est tous le moderne de quelqu'un et qu'il ne sert à rien de regretter une époque révolue et embellie par le temps. Cette fable un peu bizarre est donc bien plus maline qu'il n'y parait et prend tout son sens à notre époque de revival nostalgique à l'échelle mondiale.
C'est une fable à la fois misanthrope et humaine, désespérée et lucide, aussi triste qu'elle est drôle.
Tous les personnages brillent d'une lumière bien à eux et l'ironie sous jacente se transforme souvent en éclat de rire chez celui qui lit. C'est vrai, parfois l'absurde est poussé à bout, mais c'est un bien petit prix à payer pour une aussi réflexion aussi drôle sur la place de l'homme dans le monde. Bref, un bouquin d'une finesse et d'une intelligence rare. Terrible.