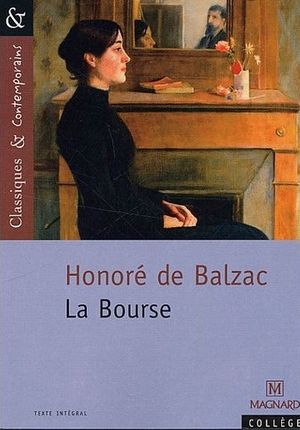C’est drôle : dans ma critique précédente, je parlais des titres des récits de la Comédie humaine, et voilà qu’après avoir fini la Bourse, je cherche en vain le féroce univers de spéculateurs que je m’attendais à y voir dépeint ! Tant pis pour les agioteurs…
Ce sera un peintre, encore un après le Sommervieux de la Maison du chat-qui-pelote : Hippolyte Schinner en est au moment de sa carrière où « il commen[ce] à ne plus connaître le besoin, et joui[t], selon son expression, de ses dernières misères » (p. 416 en Pléiade). Une chute dans son atelier, qui ouvre le récit, lui fera rencontrer ses deux voisines, une mère et sa fille. Innamoramento, timidité mutuelle, doute, etc. La nouvelle ne brille ni par son originalité, ni par sa profondeur et soyons honnête : si le créateur de la Comédie humaine n’avait écrit que des récits comme celui-ci, on l’aurait compté au rang des écrivains mineurs du XIXe siècle. Voire de ces petits romantiques (1).
Et c’est peut-être en cela que la Bourse a de l’intérêt. En les considérant dans un contexte quasi nervalien, les fameuses descriptions de Balzac prennent une autre coloration – comme cette évocation du crépuscule parisien qui ouvre la nouvelle (p. 413) : « Il est pour les âmes faciles à s’épanouir une heure délicieuse qui survient au moment où la nuit n’est pas encore et où le jour n’est plus. La lueur crépusculaire jette alors ses teintes molles ou ses reflets bizarres sur tous les objets, et favorise une rêverie qui se marie vaguement aux jeux de la lumière et de l’ombre. » De sorte qu’on ne pourrait donner tort à l’auteur lorsqu’il intervient dans le récit pour les défendre : « Si la peinture est ici trop franchement dessinée, si vous y trouvez des longueurs, n’en accusez pas la description qui fait, pour ainsi dire, corps avec l’histoire ; car l’aspect de l’appartement habité par ses deux voisines influa beaucoup sur les sentiments et sur les espérances d’Hippolyte Schinner » (p. 420).
De même, son goût décrié pour la physiognomonie est ici atténué, dans la mesure où celle-ci n’est pas présentée comme une science univoque : « Ces traits si fins, si déliés [de Mme de Rouville] pouvaient tout aussi bien dénoter des sentiments mauvais, faire supposer l’astuce et la ruse féminines à un haut degré de perversité que révéler les délicatesses d’une belle âme » (p. 425) : Balzac, une fois n’est pas coutume, laissera le lecteur ne trancher qu’à la fin. (Le lecteur, comme souvent chez Balzac mais c’est formulé explicitement dans la Bourse, doit être un enquêteur : « À ce spectacle, tout homme de bon sens se serait proposé secrètement et tout d’abord cette espèce de dilemme : ou ces deux femmes sont la probité même, ou elles vivent d’intrigues et de jeu », p. 423.)
D’ailleurs, on ne sais pas toujours si l’auteur de la Bourse prend ou non le lecteur pour un demeuré : quand il écrit (p. 419) qu’« il se rencontre des plaisirs inexplicables que comprennent ceux qui ont aimé. Ainsi quelques personnes sauront pourquoi le peintre monta lentement les marches du quatrième étage, et seront dans le secret des pulsations qui se succédèrent rapidement dans son cœur […] », pense-t-il vraiment que savoir reconnaître les manifestations de l’amour n’est pas à la portée du premier venu (2) ?
Dans l’introduction aux Études de mœurs, Balzac, par la voix de Félix Davin, parle de la Bourse comme d’« un de ses plus jolis tableaux de chevalet » et je crois que c’est ainsi qu’il faut la lire : le récit n’est certes pas un chef-d’œuvre, mais il est suffisamment pictural pour présenter de l’intérêt. Dans un cadre resserré, un décor plein d’« objets innommés participant à la fois du luxe et de la misère » (p. 421) comme ce « vieux tapis d’Aubusson, bien raccommodé, bien passé, usé comme l’habit d’un invalide » (p. 423), et dans ce décor quelques personnages à l’image de ces « deux hommes dont le costume, la physionomie et l’aspect étaient toute une histoire » (p. 427).
On pourrait penser à une peinture flamande – il ne manque qu’un miroir caché dans un coin de l’arrière-plan.
(1) A contrario, on peut lire Balzac en pensant à ce qu’en fera Barbey d’Aurevilly – la Bourse aurait pu s’intituler le Dessous de cartes d’une partie de whist.
(2) En revanche, cette fameuse phrase moquée par quelques pêcheurs de perles plus ou moins pions : « “[…] Il est onze heures”, répéta le personnage muet » (p. 430), demande un lecteur qui comprenne qu’à ce moment-là du récit, Du Halga – c’est son nom – n’a pas encore dit un mot, et qu’il n’en dira plus d’autre.