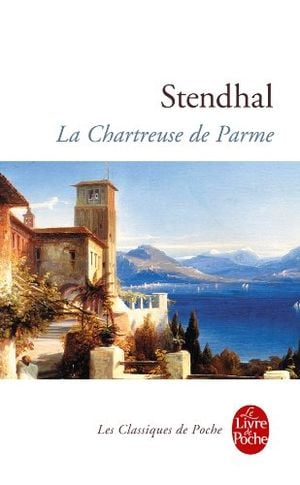C’est dans l’apparent non-sens du hasard que se précise notre destinée, et il s’agit d’un processus joyeux.
Ce qui frappe en premier lieu dans ce classique est la distance ironique de Stendhal vis-à-vis d’un personnage principal qui doit pouvoir sembler médiocre malgré sa fougueuse noblesse romantique, le narrateur laissant clairement le choix de l’appréciation au lecteur. Procédé redoutable : le héros, Fabrice Del Dongo, victime éternellement guidée par la peur et par l’amour, avance dans sa vie dans une totale ignorance de ce qui l’attend, avec une naïveté certaine, mais aussi avec jubilation. Le (re)lecteur d’aujourd’hui peut trouver ça « pathétiquement drôle » ou peut au contraire considérer qu’il est logé à la même enseigne.. Mais ça serait sans compter avec le génie stendhalien qui parvient à maintenir une forte tension entre fatalité d’un côté et hasard de l’autre.
En effet, bien que constamment guidé la peur (la dimension « ironique » du roman), Fabrice se laisse aussi balloter par le hasard avec un enthousiasme qui pourrait s’apparenter à de la servilité : mais ce que nous montre notre héros c’est que dans le hasard il y a initiation, et que tout évènement imprévu revêt une importance fondamentale car il permet de se trouver vraiment, par opposition à ce qui est planifié.
Une des premières illustrations du roman en est la métaphore du champ de bataille où le soldat, privé de carte d’Etat-Major et de vue d’ensemble des évènements, est balloté au gré d’ordres qui lui semblent incompréhensibles et dénués de bon sens.
Jusqu’au bout, jusqu’au fond du trou, ce héros stendhalien est joyeux et heureux de son destin : le signe du destin s’accompagne de joie et la joie donne le vrai sens aux signes du destin. Le roman se déploie comme une quête de sens à partir de signes mis sur le chemin de Fabrice, la fatalité impliquant le hasard et non le calcul, et c’est l’inconnu qui ne se réalise que dans l’impondérable : là réside bien le dernier mot de la vie. Magnifique Stendhal. A ce titre, l’épisode de la prison est frappant : à la solitude de Fabrice face au monde s’oppose la relation amoureuse avec Clélia. C’est la double prison: la vraie, la physique, matérielle et malheureuse, mais aussi la prison de l’amour, la prison heureuse. Et finalement la prison matérielle est heureuse car elle détermine aussi la prison amoureuse, symbole du bonheur stendhalien. C’est même dans la prison qu’il est le plus heureux : la jonction du plus grand bonheur et du plus grand risque se réalise enfin.
Un reproche souvent fait au roman est une fin expédiée en quelques pages radicales. Je trouve au contraire que ce procédé lapidaire couronne de façon jubilatoire l’ensemble de l’oeuvre : tout le monde meurt rapidement, sauf le grand ministre, tel Zadig, le ministre de Voltaire, heureux de chanter les louanges de la providence. Les autres ont été emportés par leurs passions, ils ont choisi le bonheur du malheur ou le malheur du bonheur. Ca ne pouvait pas se terminer autrement.
Définitivement un beau conte.