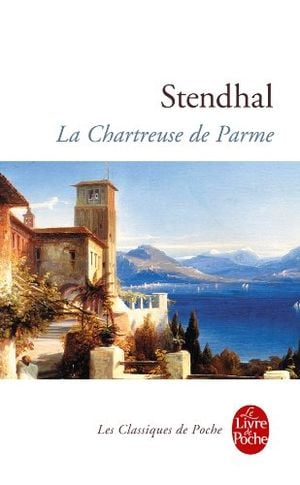Rares sont les romans qui communiquent à leur lecteur un tel plaisir, mieux, une telle joie. On ne peut que tomber d'accord avec Béatrice Didier, responsable de l'édition de La Chartreuse de Parme en 1972 chez Folio. Se découvre dans ce roman un plaisir de la péripétie et un goût pour l'anecdote qui le rendent profondément vivant où dans le foisonnement de l'action, la constance des psychologies tient lieu d'unité. Ainsi, les personnages se résument-ils pratiquement à un caractère et exemplairement, la relation de Fabrice à Clélia se réduit au combat acharné de la puissance d'un désir contre l'obstination d'une vertu.
Les héros de Stendhal n'ont rien de commun, ce sont des âmes hautes qui ressentent plus profondément la grandeur et sont naturellement portés au sublime. Ceci n'a à voir ni avec leur vertu ni avec leur esprit, mais à rechercher au niveau de la fortune ou de l'infortune de leur naissance. A bien des titres Julien Sorel et Fabrice de Dongo s'opposent. Pourtant, chacun à sa manière siège au-dessus de son époque et son échec ou son triomphe n'est que de son fait. Ils ne demandent ni indulgence ni reconnaissance.
A la sortie de La Chartreuse, les lecteurs eurent sans doute bien des difficultés à reconnaître leur époque dans le roman. Inspiré des chroniques de l'histoire des Farnèse qu'il avait lues, c'est davantage les mœurs d'une Italie de la Renaissance ou du Moyen-âge que Stendhal décrit ici plutôt que véritablement celles qu'il a connues. L'introduction de certains éléments comme les présages, le poison et une certaine idée du "sang" (qui incline Fabrice à rejoindre Napoléon, lui donne un certain esprit français, selon Stendhal) renvoie de même à certaines résurgences d'un archaïsme magique qui place le roman sous le signe du surnaturel.
Malgré l'exception des personnages stendhaliens, l'anachronisme dans la peinture qui est faite de l'action et une présence du surnaturel, à quoi tient pourtant cette sensation paradoxale de réalisme, bien qu'encore, souvent, l'invraisemblable n'arrête pas Stendhal ?
Cela tient à deux raisons principales. D'abord, la fine analyse politique des intrigues de cour est le récit d'un homme qui sait de quoi il parle, Balzac devait saluer bientôt La Chartreuse comme "Le Prince moderne, le roman que Machiavel écrirait s'il vivait banni de l'Italie au XIXe siècle". Surtout, il existe une constance des passions dont la peinture chez Stendhal est saisissante. Les éléments de contexte qu'il dispose autour de ses personnages à la sentimentalité exacerbée les contraint à l'exprimer de façon paroxysmique peut-être, mais chacun peut y lire, exagéré, c'est-à-dire rendu visible, manifeste, un reflet déformé de la sienne, dont l'écart avec le sentiment éprouvé et connu est seulement de mesure, non de nature. L'écriture stendhalienne lie ensemble les analyses sentimentales et politiques par le recours à un procédé similaire : l'antichambre est l'origine de l'événement, que ce soit celle des palais ou celle de l'âme, et la description précise des intrigues répond à celle des consciences. Ceci donne bien sûr l'occasion d'une variation de focalisations et de discours. Le ton global du roman alterne ainsi entre la farce du pouvoir et le drame sentimental selon que les personnages sont pris sous l'extériorité de leurs ridicules ou depuis l'intérieur sublime de leur âme, dont Stendhal ne s'interdit pas parfois de traiter avec ironie. Certaines sentences définitives sanctionnent dans leur concision les intérêts politiques et la bassesse de ceux à qui ils profitent : " C'est ainsi que les petits despotismes réduisent à rien la valeur de l'opinion." Et s'opposent au long développement des mouvements intimes, qu'on songe au retour de Gina sur les rives du lac de Côme au début du roman, à la déclaration de Clélia lors de sa visite à Fabrice à la tour Farnèse, à la description du sonnet dans les marges du Saint Jérôme. Il y a ainsi plusieurs vitesses chez Stendhal et une vive opposition de styles entre l'action et la rêverie. Ainsi, à l'exemple de la duchesse, qui, dès qu'elle n'a plus la visée de son bonheur sombre dans la mélancolie, l'ennui est comme chez Baudelaire, le grand ennemi. Ici encore le retour à l'action guérit du chagrin : "Cette nuit, la duchesse n'eut pas le temps d'être malheureuse.", qui clôt un long développement sur l'accablement de la Sanseverina. Et cette variation des rythmes n'est pas en reste dans l'impression profondément vivante que l'on ressent à la lecture de La Chartreuse et à la musicalité si particulière de l'écriture stendhalienne. C'est qu'encore, la recherche du bonheur est un motif régulier du roman et suffit à décrire la totalité des mobiles de la duchesse, qui malgré une profondeur indéniable, paraît pourtant légère face au sérieux austère de son neveu. Nombreux ont vu une faiblesse dans la fin, on se doit pourtant de saluer la puissance du style de Stendhal dans l'ellipse. C'est seulement que, quand tout élan est brisé, le souffle s'interrompt et l'intrigue s'arrête, privée d'aliment. Les personnages tombent avec le rideau.
Il faut maintenant se pencher sur un aspect de l'œuvre de Stendhal et qui apparaît comme le motif générateur de son écriture et qui est la question des pères et plus particulièrement celui de l'indignité des pères. Fabrice et Julien ont ceci en commun qu'ils ne sont pas aimés de leurs pères. Ceci les poussera à sortir de leur condition mais orientera leur rapport aux femmes dont le doublement des figures est encore un point commun aux deux romans. Au trio Julien, Mme de Rénal, Mathilde de la Mole, répond celui formé de Fabrice, la duchesse et Clélia. A chaque fois se trouve une figure de mère et une figure d'amante, disposées autour de l'homme, comme l'exposition de deux pôles amoureux. La situation de Fabrice est celle d'un Œdipe empêché. C'est Œdipe qui s'arrête devant Laïos et ne lui dispute pas sa place au monde. C'est pourquoi l'inceste ne sera jamais consommé et que Fabrice n'est pas amoureux de sa tante. C'est pourquoi, surtout, la tragédie se commue en mélodrame qui est la forme définitive du romantisme, on y reviendra. Mais la relation au père est doublée d'un non-dit.
L'introduction du roman et l'arrivée de l'armée napoléonienne à Milan se passe un an avant la naissance de Fabrice, à un moment où le lieutenant Robert, soldat français, fréquente assidument le salon milanais de la marquise del Dongo, moment où la pusillanimité de son mari, vieux réactionnaire au service de l'occupant autrichien, l'avait poussé à se retrancher dans son château de Grianta, laissant sa femme et sa sœur à Milan. On comprend que Fabrice est le fruit adultérin des amours de Robert et de la marquise. C'est ainsi qu'il est à la fois français et italien, c'est-à-dire qu'il occupe une position dans laquelle Stendhal n'a aucun mal à se reconnaître. A bien des titres, l'arrivée de Napoléon à Milan est donc séminale : elle ouvre le roman, elle est attachée à un tendre souvenir pour Stendhal et donne naissance à Fabrice. Il est facile d'imaginer combien la réminiscence chez Stendhal d'un souvenir heureux, son premier séjour en Italie, terni par sa réclusion à Civitavecchia a pu libérer l'idée de son roman, comme la réclusion de Fabrice lui offrira de hautes visées.
Waterloo constitue la double occasion pour Fabrice, offerte et manquée, de rencontrer à la fois son géniteur et son idole, Napoléon. Comme le remarque à juste titre Béatrice Didier, le retrait de son cheval sous l'assise de Fabrice pour le donner au général A*** qui n'est autre que l'ancien lieutenant Robert, est le symbole d'une castration. Par le double jeu des promotions et des pseudonymes, Fabrice aura raté l'occasion de se faire reconnaître. Pourtant le sang français irrigue bien les veines du marchesino, qui porte en lui cet idéal des Lumières et voue un culte à Napoléon.
Il faut peut-être lier à cela l'absence totale d'ambition du jeune del Dongo tel qu'il s'en ouvrira à Clélia, ou en tout cas une incapacité à mener sa vie selon les termes du monde. Et c'est ainsi que Fabrice incarne comme le regret d'être né. Les neuf mois de sa première réclusion dans la tour Farnèse s'apparentent à une gestation dont l'évasion est décrite comme un accouchement difficile, sinon regretté, que le motif du retour indique bien. Ce qu'il trouve dans sa prison, en hauteur, dont la nuit dans le clocher du père Blanès est une préfiguration, c'est l'idéal d'un amour transparent. Blanès va lui apprendre la vanité du langage face à la puissance des signes. Autrement dit, il va rendre pour Fabrice le monde chiffré, c'est-à-dire déchiffrable et compréhensible. On passe de la confusion absolue du monde à une possible lisibilité. Or ce monde est celui que crée le romancier, la volonté d'inventer un monde illustre le besoin de créer un sens.
Ce passage où Fabrice est envoyé par son père légitime, le marquis del Dongo à l'abbé Blanès pour qu'il lui enseigne le latin est l'occasion d'un passage de relai d'un père à un autre (accentué encore par la référence au cheval qui renvoie au père naturel : "que sais-je de plus sur un cheval […] depuis qu'on m'a appris qu'en latin il s'appelle equus ?") Ce que vont apprendre Clélia et Fabrice c'est à se comprendre sans les mots, à inventer leurs signes et leur alphabet, cela permis par la distance, c'est-à-dire le regard, enfin, la transparence, transparence régulièrement contrariée pourtant. Or, pour Stendhal, "en amour tout est signe" et c'est au collage immédiat du signifié sur le signifiant que tend l'amour idéalisé que se prêtent Fabrice et Clélia, un signe pur et une communication intégrale de la pensée. La réclusion libère non seulement la vue, ainsi l'impossible panorama que contemple Fabrice depuis sa cellule, mais une conscience extralucide et la communication des âmes. Or il est significatif que cet amour soit associé à la hauteur. S'il y a évidemment hauteur de sentiment, il y a surtout amour céleste (la présence de la volière de côté de Clélia est éloquente). L'amour que porte Fabrice à Clélia n'a rien de terrestre, le seul amour terrestre, lacustre, qui lui soit proposé est l'amour incestueux de sa tante, mère de substitution, placé sous le signe d'Hippolyte. Pourtant à mesure que la relation entre Clélia et Fabrice se complique de transgression et d'aménagement avec le serment fait à la Madone, l'espace de leur rencontre se réduit dans une réclusion de ténèbres où la communication n'est plus faite que de sons et de contacts, espace utérin s'il en est et retour de Fabrice à une origine regrettée.
Revenons enfin sur la paternité. Les amours stendhaliennes sont sanctionnées non pas de stérilité mais d'une incapacité à être père (Julien sera guillotiné avant la naissance de son fils, Fabrice verra le sien mourir avant qu'il l'ait connu). Il y a là une leçon sur le romantisme dont l'Œdipe contrarié donne la clé. La faillite de l'individu face au monde, son impuissance le pousse à inventer un monde, ce qui est en soi une puissance recouvrée, mais un monde sublimé dans lequel la hauteur des aspirations permet un échec sans honte vis-à-vis d'une finalité toujours repoussée. En cela le romantisme est nécessairement chrétien, d'un christianisme abâtardi sans doute, mais chrétien pourtant. Son besoin d'un ailleurs repoussant la réalisation de son impossible désir est sublimé dans la vie après la mort qui demeure l'espoir de Fabrice et Clélia. Il y a dans l'amour romantique, dans l'amour de l'amour, un amour de la mort qui verra se concrétiser la fin des espoirs. La foi est le nécessaire reflet d'une aspiration au surnaturel, ainsi que le sonnet caché dans le Saint Jérôme l'exprime, caché à double titre, aux personnages qui ne connaissent pas les signes magiques et exclusifs de la conversation des âmes amoureuses de Fabrice et Clélia ; mais aussi au lecteur dont il n'a du sonnet que la traduction en prose. Un article développe à ce propos une comparaison intéressante entre Fabrice et Saint Jérôme (http://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1995_num_97_1_2363). Pour ce qui nous concerne ici, notons simplement qu'à cette occasion, en associant Fabrice à Saint Jérôme, Stendhal met en parallèle les commentaires exégétiques de l'ascète avec ceux amoureux du prisonnier mêlant l'amour sacré et le profane en une synthèse des deux auquel est réceptive Clélia. D'ailleurs, dépassant dans l'inspiration les limitations naturelles de la connaissance, Fabrice pressent son retour vers l'être aimée et préfigure ainsi son retour prochain à la prison autant que la réunion de leurs âmes après leur mort.
Cette belle idée : Mourir près de ce qu'on aime! exprimée de cent
façons différentes, était suivie d'un sonnet où l'on voyait que l'âme
séparée, après des tourments atroces, de ce corps fragile qu'elle
avait habité pendant vingt-trois ans, poussée par cet instinct de
bonheur naturel à tout ce qui exista une fois, ne remonterait pas au
ciel se mêler aux chœurs des anges aussitôt qu'elle serait libre et
dans le cas où le jugement terrible lui accorderait le pardon de ses
péchés; mais que, plus heureuse après la mort qu'elle n'avait été
durant la vie, elle irait à quelques pas de la prison, où si longtemps
elle avait gémi, se réunir à tout ce qu'elle avait aimé au monde. Et
ainsi, disait le dernier vers du sonnet, j'aurai trouvé mon paradis
sur la terre.
La monstruosité sacrificielle de l'enfant à la fin du roman est partie prenante de l'atmosphère archaïsante de La Chartreuse et la révélation que l'amour que se portent Clélia et Fabrice est un amour maudit dont la mort est l'avers, mort dont la maladie de son enfant prenait des tournures analogues aux yeux de Mme de Rénal dans Le Rouge et le noir, comme un avertissement divin. En cela Stendhal montre l'indifférence qu'il porte à la moralité de ses personnages, jamais passion n'aura été aussi sublimement écrite.