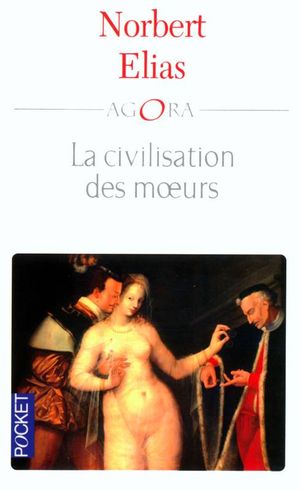La Civilisation des mœurs est, dans l'édition française, le premier tome de Sur le processus de civilisation : recherches sociogénétiques et psychogénétiques, texte fondamental de l'historien allemand Norbert Elias paru en 1939 et dont le deuxième tome est tout-à-fait dispensable (après avoir revisité l'histoire de France de façon lourdement mathématique, l'auteur ne fait que se répéter encore et encore).
Texte fondamental à plus d'un titre, c'est une référence obligée pour comprendre, dans la lignée de Nietzsche et de Freud, les implications affectives et culturelles de l'avènement des États modernes dans les sociétés occidentales. Ce texte, notamment, apporte une lumière particulièrement éclairante sur la situation présente et les débats qui ont cours depuis quelques mois.
Pour point de départ, Elias interroge les notions de civilisation en France et en Angleterre et de kultur en Allemagne, la seconde devant s'opposer à la première. L'idée de kultur apparaît dans la pensée allemande à la fin du XVIIIe siècle chez les préromantiques du Sturm und Drang, mouvement intellectuel et littéraire composé de figures comme Herder et Goethe, contestant le rationalisme de la philosophie des Lumières. L'idée de kultur doit désigner ce qui croît spontanément en nous et qui constitue notre identité intime. La civilisation, au contraire, est un ensemble de normes extérieures et superficielles auxquelles on se soumet dans le cadre de la vie mondaine. Ces auteurs, en effet, issus de la bourgeoisie (au sens de citoyen d'une ville) et fortement influencés par Rousseau, critiquent la vie sclérosée par excès de normes qui, selon eux, empêchent la libre expression du génie individuel, de la vie des cours des princes allemands, par ailleurs fort peu développées (tout comme l'État). Ceux-ci ne font que se conformer au modèle aristocratique français, rayonnant dans toute l'Europe ; au cours des guerres révolutionnaires, par hostilité à l'impérialisme français, la kultur contre la civilisation devient ainsi l'Allemagne contre la France.
C'est effectivement en France que naît la notion de civilisation, au milieu du XVIIIe siècle. La civilisation remplace l'idée de civilité qui, elle-même, se substitue à la Renaissance à celle de courtoisie. Mais ces trois notions désignent la même chose : des règles de sociabilité qui adoucissent les mœurs en imposant aux individus un souci plus grand à la sensibilité d'autrui, qu'il s'agit, donc, de ne pas froisser. Déjà conçue comme relevant d'un processus historique, la notion de civilisation, en France, inspire un sentiment de confiance et de supériorité face aux nations qui sont encore restées aux « stades antérieurs » du « progrès historique. » Comme Herder le remarquait déjà à cette époque, l'idée de civilisation commence à justifier et à légitimer un impérialisme, colonial notamment, se voulant bienveillant, devant apporter les bénéfices du progrès aux peuples qui n'y ont pas encore accès (c'est aussi la mission que s'étaient donnée les révolutionnaires lors des guerres en Italie ou en Allemagne notamment).
Ce processus de civilisation, Norbert Elias l'interroge dans son historicité. Pour ce faire, il rassemble des sources... pour le moins inattendues. Comment dormir, comment uriner, comment se tenir à table, comment se comporter avec les femmes ? Toutes questions abordées dans des traités de courtoisie ou de civilité du Moyen Âge au XIXe siècle. Elias remarque ainsi une tendance à une réglementation croissante des comportements, renforçant les sentiments de pudeur ou d'hygiène. Si au Moyen Âge il était normal de se dévêtir chez soi et d'aller nu jusqu'aux bains publics, femmes et jeunes filles comprises, la nudité devient un véritable tabou au XIXe siècle et au XXe siècle. De manière générale, tout ce qui est relatif au corps s'auréole d'interdits nombreux. Mais ceux-ci, loin d'avoir pour origine des considérations hygiéniques et rationnelles comme on le pensait alors au XIXe siècle et au XXe siècle, sont surtout motivés par des sentiments de gêne et d'angoisse, par une affectivité particulière. Poursuivant les intuitions géniales de Nietzsche (dans sa Généalogie de la morale notamment), qui elles-mêmes ont inspirées la notion de Surmoi à Freud, Elias montre que ces sentiments naissent d'abord des contraintes croissantes imposées dans le cadre de la vie de cour dont l'importance grandit à mesure que l'État se consolide et que la noblesse, qui perd son autonomie et son rôle de gouvernement décentralisé, se réduit à un rôle de service du prince et de l'État.
Ces normes, d'abord imposées par une autorité extérieure, deviennent un ensemble d'autocontraintes jouant un rôle crucial dans l'économie affective de l'individu. La tendance en est à l'effacement du désir individuel, à la régulation de ses pulsions, lesquelles deviennent objets de honte et de gêne. En conséquence, si l'affectivité médiévale permettait une expression spontanée et « naïve » de ses sentiments avec une grande force, ce qui conduit à une juxtaposition sincère de sentiments contraires qui paraît irrationnelle aux modernes, l'affectivité de ces derniers nécessite une grande retenue. De fait, les relations sociales s'apaisent, deviennent plus pacifiques, à tout le moins extérieurement. Ce n'est pas simplement par bonté d'âme ; c'est surtout parce que la violence nous inspire désormais un immense sentiment d'angoisse et d'inquiétude, si bien que nous préférons systématiquement y renoncer, ne trouvant pas que son usage puisse servir notre intérêt. Car cette modification de l'affectivité s'accompagne d'une sensibilité plus grande. Étudiant les dessins (géniaux) du Hausbuch (sorte de Très riches heures du duc de Berry allemand) datant de la fin du XVe siècle, Elias remarque qu'il s'y dessine un panorama de la société de l'époque honnête, sincère, ne cachant pas ce qu'il y a de hideux dans la vie quotidienne : pénibilité du travail, différences sociales nettement marquées, pauvreté, brutalité de la guerre (devenue particulièrement violente à cette époque), cruauté des peines pour les suppliciés, mais aussi expression sincère et publique des sentiments amoureux. Cette façon de représenter la dure réalité disparaît ensuite : elle aurait heurté la sensibilité aristocratique qui préfère qu'on lui cache cette « laideur », souhaitant se bercer d'images idéalisées des campagnes ou de la vie populaire.
On voit, donc, qu'il y a un lien — que Nietzsche avait déjà entr'aperçu — entre avènement de l'État, limitation du désir individuel et naissance d'une sensibilité à fleur de peau motivant un goût pour l'idéalisme, que l'on retrouve sans mal, encore aujourd'hui, dans le domaine des idées, où la norme est à la négation du caractère pénible de la réalité (ou bien à l'espoir — la foi ! — en sa disparition future grâce au progrès historique, ce qui revient au même).
Or, Norbert Elias a ce travers de lui-même croire en de tels fantasmes.
Plusieurs aspects de ses thèses méritent d'être sévèrement critiqués. Son appréhension du Moyen Âge est, pour commencer, extrêmement désuète. Ses sources sont des historiens de la fin du XIXe siècle (que j'ai pour partie lus) fort satisfaits de la sécurité générée par les progrès de l'État et, eux qui n'ont connu ni 14-18 ni 39-45, se pâment d'effroi pour les violences de la guerre de Cent Ans, fort gentillettes à côté de la brutalité de la deuxième guerre, qu'ils tendent à accentuer pour nourrir la narration d'un progrès univoque de l'histoire — sans beaucoup chercher à pénétrer la psychologie et les mœurs du XIVe ou du XVe siècle. La vision qu'Elias a du Moyen Âge en sort profondément erronée, et de nos jours tout-à-fait démentie. Le Moyen Âge n'était pas une époque où la violence avait libre cours, de façon gratuite, sans qu'elle soit régulée par aucune institution — pas même par la religion ! Bien au contraire, un ensemble de traditions, de mœurs et de coutumes jouent un rôle important de limitation de la violence. Celle-ci, cependant, n'est pas un monopole de l'État : pendant très longtemps, la justice n'appliquait pas toujours des peines afin de résoudre les querelles entre individus ; elle se contentait de vérifier a posteriori que la vengeance privée ait été faite conformément au droit coutumier et de façon légitime. En réalité, la violence des guerres à la fin du Moyen Âge, comme le pillage des gens de guerre, ne constitue pas une norme des institutions médiévales mais plutôt une dérive rendue possible par l'avènement des États, ceux-ci tendant à déstructurer les traditions et les coutumes perdant leurs contours habituels. C'est ainsi le sentiment de naissance d'une communauté nationale rassemblée par l'État qui brouille les catégories traditionnelles et rend légitime la violence contre les non-combattants, considérés comme participant à l'effort de guerre de l'adversaire.
Deux conclusions, donc : non seulement la régulation de la violence n'est pas un produit d'un processus historique univoque poussé par l'avènement de l'État mais, en outre, cet avènement de l'État n'est lui-même pas sans causer de nouvelles formes de violence. Deux ans après la publication de ce livre, l'opération Barbarossa aura causé des violences de guerre d'une ampleur rarement atteinte — encore est-il vrai que la propagande, comme le percevait déjà Elias, y est pour beaucoup, mais qu'est-ce que la propagande, sinon la continuité presque naturelle (et toujours vraie, du moins en tant que tendance ou tentation, aujourd'hui) de l'État ?
Néanmoins, le livre d'Elias a l'immense mérite de souligner l'avènement d'une affectivité particulière corrélatif à l'avènement de l'État, que l'on peut caractériser par une peur de la violence, un dégoût du corps, et un idéalisme exacerbé devant masquer tous les aspects pénibles (ou potentiellement pénibles) de l'existence ou de l'histoire. Elias, en y voyant un phénomène absolument bénéfique et progressant de façon univoque jusqu'à une ère finale de paix éternelle, s'inscrit dans cette tradition libérale voyant dans le courage ou l'honneur des notions néfastes, car contraires à la bonne paix des marchands. À Elias on peut ainsi opposer Soljenitsyne et son discours de 1978, Le déclin du courage qui déresponsabilise les peuples et les fait accepter de nouvelles tyrannies non moins pires que les anciennes. N'est-ce pas ce que l'on vit depuis presque un an déjà ?