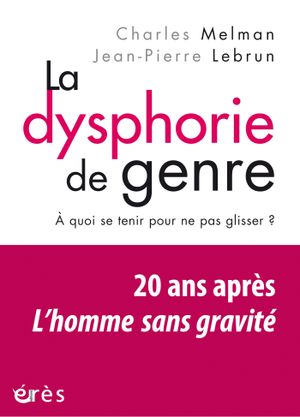L’impossibilité de débattre sereinement de certains sujets est souvent le signe d’un malaise latent. La dysphorie de genre fait partie de ces sujets épineux à partir desquels il est difficile d’instaurer une véritable discussion (ce qui suppose être capable d’entendre différents points de vue, d’entendre les désaccords, d’essayer de trouver un terrain intermédiaire, de s’autoriser le doute, de débattre de ce qui ne va pas de soi).
Soit on aborde ces questions avec une bienveillance et une empathie excessive, en évitant de soulever le moindre problème, en se plaçant sur le terrain de la « souffrance personnelle ». On prépare le terrain pour un discours prosélyte et militant. On assimile le transgenrisme et le transsexualisme à l’homosexualité, sans beaucoup d’arguments, pour renvoyer toute forme de critique à une forme d’intolérance arriérée, en utilisant très vite le ticket de la phobie. Soit on rejette la question en bloc, sans même s’y intéresser.
Ce livre, qui part d’une critique du film de Sébastien Lifshitz « Petite fille », et des soi-disant aberrations qu’il contient, est malheureusement jonché d’approximations. Les deux auteurs glissent parfois dans la facilité. Ils mélangent beaucoup de sujets et dansent sur des notions confuses, comme des saltimbanques ou des jongleurs de cirque. Ils dialoguent de manière complaisante, sans présenter beaucoup de divergences, satisfaits de leurs tours de passe-passe psychanalytiques, parfois mal fondés, peu argumentés, voire carrément ridicules (« les non-dupes errent » et tout le charabia fantaisiste de Jacques Lacan qui m’agace énormément). Les références en fin d’ouvrage sont trop pauvres pour que l’on puisse prolonger la réflexion par soi-même.
Il n’est donc pas la meilleure porte d’entrée sur le sujet.
Mais comme il arrive parfois, au milieu du marasme, il y a quand même des idées. Je suis d’ailleurs en général très intéressé par le travail de Jean-pierre Lebrun, qu’il faut arriver à extirper un peu de son ancrage psychanalytique.
Je vais d’abord rappeler une banalité : personne ne change de sexe biologiquement. On altère tout au plus une partie de son anatomie pour avoir une apparence sexuelle différente.
L’ADN de la personne (et le chromosome sexuel correspondant) n’est pas changé, on garde (pour l’instant) sa prostate ou son utérus. Le traitement hormonal est un traitement à vie. L’appareil génital, s’il est modifié, est en partie artificiel. Le corps de la personne va donc passer sa vie à « résister » à ce changement.
Les transitions sexuelles donnant lieu a beaucoup de déni, entretenu par les (soi-disant) transgenres et les transsexuels eux-mêmes (ce qui me semble créer plus de problèmes qu’autre chose), il est bon de rappeler ces évidences. Un peu plus d’honnêteté nous éviterait toute sorte de situations ridicules, où tout le monde voit que quelque chose cloche, mais où l’omerta est imposé par le politiquement correct (dans le monde du sport, de la médecine, du droit, etc) et les militants trans (Transactivists, qui ne sont pas toujours des trans, loin de là)
Voici quelques points qui sont maladroitement abordés dans la discussion entre les deux auteurs.
Le problème de l’autodétermination. En principe, on n’a pas besoin d’une autre personne pour considérer souffrir d’une dysphorie de genre. La seule conviction d’un sujet suffit. Il y a un processus d’auto-reconnaissance qui peut s’avérer problématique.
Si je passe un certain nombre d’années dans un autre pays, si je fais l’effort d’apprendre la langue locale, de m’adapter à certaines coutumes, alors j’obtiendrai peut-être, après un certain processus, une nouvelle nationalité. Les autres (institutions, personnes) pourront me reconnaître, possiblement, comme l’un des leurs, avec toutes les difficultés que cela implique. C’est un bon exemple d’un changement (et d’un désir) qui est socialisé.
En revanche si je reste en France, mais que je me considère, après quelques années de doute et de confusion, comme Espagnol, sans parler espagnol, peut-être même sans avoir jamais mis les pieds en Espagne, et que je demande aux autres, au nom de mon droit à m’auto-déterminer, voire mon droit à être heureux, de me considérer comme un Espagnol, de m’appeler Juan alors que ce n’est pas mon prénom, trouvant scandaleux de ne pas avoir un passeport espagnol, me sentant blessé si on s’adresse à moi en français, alors dans ce cas, j’impose aux autres un choix qui pourra paraître non seulement hautement arbitraire, mais surtout très problématique pour la vie en commun. Je manque l’étape nécessaire de transition entre mes fantasmes et le monde, qui doit passer par des actes socialisés et qui comportent certaines contraintes (qui permettent de transformer les fantasmes indéfinis en désirs réalisables).
De la même manière, je ne peux pas me considérer tout seul comme le meilleur cuisinier du monde (sans que personne n’ait goûté mes plats, ou sans que je n’en aie jamais cuisiné), comme le meilleur pianiste, la personne la plus intelligente de la ville, ou quoi que ce soit du même genre. Il faut que les autres interviennent dans ce jugement (qu’il peuvent refuser).
Il arrive que la dysphorie de genre (et les changements anatomiques, administratif et sociaux qu’elle peut parfois impliquer) prenne la forme de la deuxième voie décrite, passant du fantasme à la réalité, voire à la chirurgie, à travers un processus très peu socialisé (ou pas du tout), qui est très problématique.
« L’altérité est évincée. Le sujet se fait tout seul dans sa tête »
« Nous sommes, du coup, dans une société où c’est l’individu lui-même qui détermine ce que doit être la société qui devra le reconnaître comme individu »
La société est sommée de reconnaître quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Qui peut même aller à l’encontre des catégories de sens commun et rendre la vie publique compliquée. Qui peut également être jugé comme un déni du corps, voire une haine du corps, qui repose sur une étrange philosophie où le corps n’est qu’une enveloppe qui sert de réceptacle à une âme qui sait déjà, à sa naissance, qui elle est (ce qui n’a pas grand sens).
C’est aussi une apologie du monde privé sur le monde public, une personne ne possédant pas le pouvoir (et ni le droit) de définir qui elle est dans le domaine public.
L’attitude entièrement privée peut d’ailleurs favoriser la psychose (qui repose sur la perte d’altérité et sur la confusion entre ce qui n’est que virtuel et ce qui existe réellement)
Il peut y avoir également, parfois, de la complaisance, voir un certain plaisir de la transgression à jouer avec des limites qui mettent les autres mal à l’aise.
Ces problèmes peuvent s’accompagner d’attitudes psychologiques bien plus banales : refus de la négation, refus des limites, refus du réel, refus de l’adversité, refus des autres, considérés comme un obstacle.
Et au lieu d’accompagner correctement les gens qui sont parfois perdus dans ces limbes, on accepte, avec de moins en moins de discussion possible, avec une fragilisation grandissante des instances qui pourraient s’opposer au choix de la chirurgie ou de la transition, on accepte le changement de l’apparence sexuelle.
Ceci conduit à un autre problème discuté par les auteurs, qui est celui du « tout à la fois ». Un transsexuel possède, virtuellement, à la fois le corps d’un homme et le corps d’une femme (c’est encore plus confus chez une personne soi-disant transgenre qui conserve son apparence sexuelle et qui veut être considérée comme appartenant au sexe opposé). Les auteurs se demandent s’il n’y a pas là une marque d’un passage du désir au besoin. Ce besoin de vouloir jouir de tout en même temps, de baigner dans l’indéterminé. On ne veut pas souffrir de la perte que tout choix implique. On jouit d’une possession et d’une indifférenciation excessive.
Un autre problème, au-delà de la lourdeur des traitements impliqués (et des possibilités de contrecoups terribles) est l’articulation de ce désir avec l’hubris technologique. Le problème transsexuel est un sous-ensemble du problème transhumain, même si cette connexion est, finalement, rarement énoncée. Cela pose la question de la transgression des limites physiques et physiologiques. Et celle de savoir si on peut choisir son corps biologique (et d’autres éléments qu’a priori on ne peut pas choisir, comme son âge, ses parents, sa nationalité, etc) dans le but de coller à ses fantasmes.
L’ouverture d’un nouveau marché pour les industries pharmaceutiques, la médecine esthétique, l’industrie des prothèses, et bien sûr toutes les entreprises plus traditionnelles (Vêtements, industries culturelles), ne peut que rendre l’idée du transsexualisme (et du transgenrisme) favorable aux yeux de la sphère économique, qui jouera facilement le jeu, à coup de marketing, de lobbying et de postures superficielles, de la « tolérance ».
Le transsexualisme est d’ailleurs, pour moi (comme pour d'autres), un courant extrêmement libéral et une conséquence directe de la croyance aux stéréotypes dits « de genre » (les hommes se comportent comme ceci, les femmes comme cela). Ce qui n’est pas un mince paradoxe (au vu de ce que prétendent les militants, souvent associés, pour des raisons qui m’échappent en partie, à la « gauche radicale »).
Je rappelle également que, si l’eugénisme, pourtant très mal vu, désigne une procédure de sélection a priori des individus, selon des critères physiques et mentaux, vers un idéal de perfection, le transhumanisme (et le transsexualisme avec lui) conserve l’idée d’un corps (et d’une association corps-esprit) qui puisse se triturer selon les envies de l’individu, se changer à l’envie, pour correspondre à un idéal défini. Je ne suis pas sûr qu’il n’y ait aucun lien entre ces deux tendances. Je suis même plutôt sûr du contraire.
De manière générale, les auteurs s’inquiètent d’une certaine vision du social, de l’espace public, qui n’est plus destiné qu’à devenir un espace de revendication des spécificités particulières, dans un esprit que même un penseur libéral trouverait excessif et destructeur.
Une critique intelligente de la dysphorie de genre ne cherche pas à contester la souffrance propre d’une personne, ni le mal-être de certains, mais la réponse apportée à cette souffrance (ce qu’il faut quand même savoir distinguer). Les auteurs rappellent que l’on peut être attentif à ce problème, peut-être mal nommé, sans tout de suite tomber dans le prosélytisme militant, dans la bienveillance aveugle et naïve, et dans le galimatias abstrait de néo-management (cisgenre, etc), surtout au vu des implications importantes, parfois graves, qui sont en jeu.
Je me range personnellement derrière les positions féministes qui défendent l’idée que les notions de genre et d’identité de genre entraînent une régression ridicule, des tombereaux de clichés, et une confusion entre la « personnalité » et d’autres questions rendues confuses par un militantisme qui se complaît, de toute façon, dans la confusion la plus totale.
L’idée que l’on peut être « né dans le mauvais corps » ou qu’une personne puisse avoir une « identité de genre » n’ont pas grand sens (enfin en tout cas pour moi elles n’en ont aucun). Ou alors il faut accepter d’aller beaucoup plus loin dans cette philosophie irrationnelle, en partie essentialiste et en partie contradictoire, et dans ce cas, on risque de créer un chaos bien dangereux, dont la violence risque de surprendre (peut-être avant tout le monde) les militants de ces causes eux-mêmes, eux qui sont si peu habitués à la violence réelle.