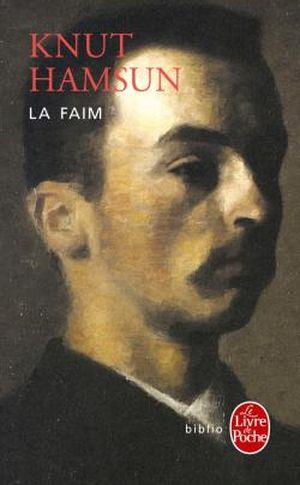J’ai un ami qui fait souvent usage du terme « se monter le bourrichon ». Je crois que cette expression décrit de façon exacte le narrateur de La Faim. Le personnage principal est un pauvre type, un paumé plein d’espoir. Un crève-la-faim qui n’a rien et qui se permet encore l’orgueil de snober la soupe populaire et ceux qui veulent lui venir en aide. J’ai retrouvé en sa personne, un autre type misérable, celui d’Umberto D. de Vittorio De Sica, sorti en 1952. Umberto est lui aussi un pauvre bougre, abandonné à lui-même, mis à la porte par une logeuse cupide qui n’a que faire des problèmes qui tourmentent le pauvre homme, de la faim qui le tenaille. Umberto, lui aussi ; a recours à des ruses pour pouvoir manger (se faire porter malade pour profiter de quelques nuits gratuites dans un hôpital) et tous deux ont honte de leur condition et ne l’assume pas, se permettant de prendre les pauvres de haut, comme lorsqu’Umberto, lorsqu’il se résigne à faire la manche et tend la main, finalement ne peut pas se laisser aller à des activités aussi misérables, se ravise en faisant semblant d’avoir tendu la main pour regarder si le temps ne virait pas à la pluie. Mais le héros d’Hamsun est encore plus misérable, car il ment. Un pauvre type affamé doublé d’un mythomane notoire. Il inspire des sentiments tellement contradictoire, tantôt il vous brise le cœur, trainant ses lamentables loques usées jusqu’à la moelle dans toute la vie, tantôt effrayant lorsqu’il plonge dans ses délires paranoïaques qu’on ne sait trop provoqués par un état naturel ou par la faim qui lui tord le ventre. Et puis il y aussi ces moments où il semble paniqué, paniqué de ne pas pouvoir aider les autres, il a pitié de tout le monde et n’ayant pas un traitre sous pour lui, il fait le fonds de ses poches pour donner quelques pièces à une enfant ou un aveugle faisant la manche. Mais ses poches sont vides. Décharné, dans ses vêtements étriqués, trainant le seul bien qui lui reste, sa funeste couverture, comme un enfant traine son doudou. Ou peut-être qu’il promène son linceul. Umberto D. lui, a son bâtard en guise d’ami, de soutien à sa lamentable vie, mais le héros de Knut n’a rien ni personne, hormis peut-être cette jolie jeune femme, grasse, blanche et pleine de vie qu’il nomme Yladjali, sans trop que l’on sache si elle est réelle ou fruit de son cerveau détraqué. Elle pourrait tout aussi bien être une figure aguichante de la mort qui viendrait se donner à lui ; lui l’attendant chaque mardi comme la promesse d’un avenir meilleur. Quand le pauvre homme, à force de se creuser la tête trouve quelques connaissances à aller voir, il se retrouve devant porte close ou il invente un millième mensonge pour ne pas laisser à son interlocuteur l’occasion de le voir dans sa condition, plutôt mourir. Seigneur Dieu, il n’est pas un pauvre gueux qui se retrouve à dormir dans un centre pour sans-abri car il n’a plus de toit, non ! Il est un journaliste à la vie confortable qui a tout simplement trop nocé et n’ayant pas vu l’heure passer, se retrouve à la rue. Il n’est pas sans emploi, il invente toujours des postes plus prestigieux et impressionne toutes ses connaissances. Et en homme aisé il ne vient pas faire emballer sa couverture poisseuse car il en a honte mais bien parce que celle-ci contient deux superbes vases qu’il veut faire envoyer. Il imagine sans cesse des plans plus foireux les uns que les autres en pensant grappiller quelques sous, se monte des histoires folles, s’imagine que les gens le jalouse et que la belle jeune femme est amoureuse de lui. Knut Hamsun a ce don incroyable de pouvoir jouer avec nos sentiments, d’être changeant et de nous déstabiliser, si bien qu’au final ouvrir ce livre c’est la garantie d’avoir envie de le dévorer jusqu’à la f(aim)in, sans trop arriver à déterminer ce qu’on ressent. L’auteur nous pousse dans les retranchements de nos passions malsaines pour la souffrance des autres, toujours plus pressé de tourner la page pour nous réjouir de la misère de ce fou affamé.