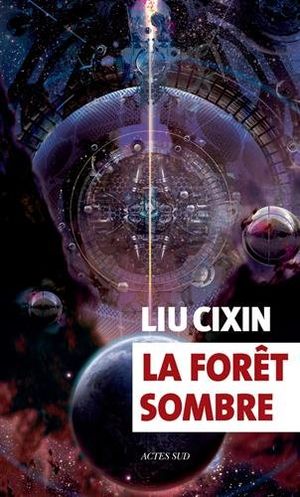(Pour un maximum d'éléments de contexte, voyez ma critique du premier tome.)
Liu Cixin signe une ouverture qui a du mal à renouer avec son style, ce qui est le premier signe avant-coureur d'une théorie que j'ai élaborée sur la trilogie : l'auteur s'est vraiment éclaté à écrire le premier bouquin, et le succès lui en a fait écrire plus qu'il n'aurait dû. Mais passons ; à ce stade de ma lecture, je m'embourbe dans des analogies peu fameuses de l'Homme à des animaux, et j'attends patiemment la fin d'une première scène qui s'étale sur une bonne quantité de pages pour pas grand-chose.
Heureusement, la première vraie qualité de La Forêt sombre frappe bien vite : Liu, en bon auteur de hard SF, parvient très bien à installer la SF directement dans l'esprit rationnel, étayant ses procédés narratifs de ses propres connaissances d'ingénieur – visiblement bien élargies par de la documentation ad hoc –, et c'est parfait. Pendant ce temps là, la crise existentielle autour de laquelle tourne toute la première moitié du bouquin passe à l'attaque : à quel point est-il légitime de pleurer la disparition de l'espèce humaine dans 400 ans puisqu'aucun humain vivant en ce moment ne la verra ? Pour autant que cette grande question est posée, les longueurs sont tolérables, car le concept est fertile.
Avant la fin de sa première moitié, La Forêt sombre tend à faire penser qu'elle gagne sur la longue contextualisation du premier tome ; ici, il y en a moins, on nage dans l'histoire plus à l'aise. Mais les 656 pages ne sont pas blanches, et le temps aidant, ce qui avait été long et intéressant dans le premier livre devient ici long et ch**nt.
On est sauvé d'un premier accès de détresse lectorale par l'arrivée inattendue d'une romance qui rappelle presque la maladresse de Douglas Adams en la matière, qui en avait ajouté une à sa fantastique série H2G2 dans la contrition pour s'en débarrasser au plus vite. Liu fait un peu pareil, mais au moins parvient-il à nous convaincre de la réalité d'une idylle rêvée (mini spoiler : ce n'était pas gagné d'avance puisque la romance est presque artificielle ; le personnage principal, Luo Ji, s'invente une femme idéale qu'un agent secret – pour simplifier – lui trouve, et leur aventure commence et fonctionne sur cette base étrange). Elle arrive bien, elle est authentiquement convaincante et paradisiaque à souhait. Mais elle fait long feu, et pas seulement parce qu'une telle idylles n'est pas faite pour durer ; La Forêt sombre est fait pour durer, lui, et l'on se passera d'une réussite romantique pour le reste de l'ouvrage, laissant flotter la muse de Luo Ji comme un iceberg moche au milieu d'un océan de pages.
Puis viennent les Colmateurs. (Mini spoiler pour les expliquer : ce sont des gens triés sur le volet à qui l'on donne des droits immenses, et surtout le droit de ne dire à personne en quoi consiste leur mission, car ils ont pour but de mener l'humanité à la victoire contre les Trisolariens (confer le résumé dans mon précédent article) sans que personne ne le sache, et surtout pas les Trisolariens eux-mêmes.) Les Colmateurs... de sacrés guignols, en fait. L'auteur les justifie en les qualifiant d'une erreur commise par l'humanité à partir du moment où le temps se met à avancer vite, mais la vraie erreur vient de l'écrivain. Des personnages avec tous les droits, au comportement et aux projets infantiles ? Pitié. Et Luo Ji, bien sûr, est l'un d'entre eux, et c'est grâce aux énormes avantages octroyés aux Colmateurs qu'il a obtenu de vivre son idylle dans la luxure et l'isolation – c'est rigolo, remarque, de voir un personnage adulte et responsable se comporter de manière aussi puérile ; ça fait passer le temps. Mais déjà que le passage est bancal, il est intolérable que la solution vienne, finalement, de lui.
Puis vient la partie du livre se passant dans l'espace. La sortie atmosphérique se passe bien. L'auteur continue de s'emmêler les pinceaux dans son idée de Colmateurs, ses « principes de base » partent à vau-l'eau sans qu'il puisse les rattraper, mais on est de nouveau sauvé de la détresse lectorale par l'avènement d'une nouvelle partie. Il utilise alors un procédé que je qualifierais ordinairement d'abominable, mais c'était la seule solution qui lui restait : la remise à zéro. Les Colmateurs, et l'esprit qu'il avait développé sur la Terre au début de la crise trisolarienne... boum, poubelle. Saut dans le temps de deux siècles. Ce que c'est devenu ? Bah, des foutaises d'une Terre paniquée, nous avons mûri maintenant ! disent les « nouveaux Terriens ». Notons quand même le coup de force de l'auteur qui parvient à retourner la situation à son avantage en montrant que ces nouveaux Terriens sont tout autant dans l'erreur que les anciens ; il parvient ensuite à établir un juste milieu in extremis.
Jusque là, on est tenu en haleine bon gré mal gré (et par « on », je veux dire « je », car je suis un lecteur patient qui ne supporte pas l'idée d'abandonner une lecture en plein milieu, mais je suis prêt à parier que les gens qui apprécient ce livre sont tous très patients) par des conflits interpersonnages rythmant bien le tout, et des mignardises occasionnelles comme l'ajout au rang des chefs d'inculpation de l'ONU de la tentative d'exterminer l'humanité. Plutôt marrant.
La transition au futur lointain est l'un des rares trucs qui soient excellemment faits ; les changements idéalisés de la société nous font enfin rêver, mais – car il y a déjà un « mais » – les « bulles » de la fascination qu'ils exercent sur le personnage qui les découvre éclatent en même temps que pour le lecteur. Et les lignes continuent de se répéter, et les formulations continuent de se répéter dans la lourdeur et la mocheté les plus élémentaires du style littéraire. La fin se rapproche, on se force, on se dit qu'on y est presque, mais en fait, le plaisir qu'on tire de la lecture se résume à la fierté d'avoir abattu un si grand et médiocre ouvrage.
Quantième Art