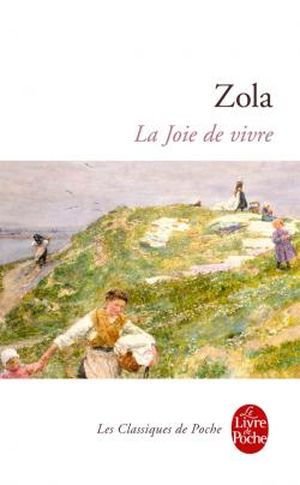« La Joie de vivre » : comment aurais-je pu deviner, ne connaissant pas le roman, que ce titre innocent et léger, porteur de vie et d’espoir, désignait le douzième tome des Rougon Macquart?
Comment expliquer chez Zola, ce titre presque incongru, sinon par son envie de créer, face au vice incarné par Nana, une figure de jeune fille oblative, irradiant de bonté, un être solaire, portant sur ses épaules toute la douleur du monde.
Jamais choix ne s’avéra plus ironique et plus ambigu tant le contraste se révèle saisissant et la tempête qui s’insinue puis se déchaîne dans la « maison de souffrance » n’est pas loin d’évoquer la mer qui ravage, lors des grandes marées, les côtes du petit village de pêcheurs coincé sous une falaise, entre mer et terre.
Fragilisé par le décès de sa mère, en proie au doute et à l’effrayante angoisse du vide, miné par l’obsession et la terreur de la mort, Zola signe là un roman pessimiste, ô combien, marqué du sceau de la décadence, Huysmans n’est pas loin, où il semble poser la question : la pulsion de mort serait- elle supérieure à l’instinct de vie ?
Pauline, 10 ans, petite orpheline d’un couple de charcutiers parisiens, héritière d’une belle fortune, se retrouve catapultée dans un modeste hameau normand en bord de mer, chez les Chanteau, de lointains parents ayant accepté, moyennant finances, de lui tenir lieu de tuteurs.
Entre un oncle paralytique, cloué dans son fauteuil par de diaboliques crises de goutte, une tante au verbe acerbe, à qui sa boulimie d’activité occasionne d’incessants troubles nerveux et son cousin, Lazare, adolescent perturbé de 19 ans, la fillette va devoir trouver sa place.
Mais c’est une enfant facile, qui semble « née pour les autres » bêtes et gens : ce brave Mathieu, ne s’y est pas trompé, posant avec confiance sa grosse gueule de Terre-Neuve sur les genoux de la nouvelle venue et la fixant de ses bons yeux de chien fidèle, tandis que La Minouche, coquette invétérée et mère indigne, tout absorbée qu'elle est à sa grande toilette, condescend, le temps d’une offrande, à se laisser choyer comme une poupée, surveillant de ses prunelles dorées le beau morceau qui lui échoira.
Seule, Véronique, « mains d’homme et face de gendarme », au service de ses maîtres depuis vingt ans, elle en avait quinze alors, n’apprécie guère « l’intruse », grognant et vitupérant contre Pauline dès que celle-ci a le dos tourné.
Toutefois, la franche santé de la fillette, sa belle simplicité et sa gaieté contagieuse semblent rejaillir sur chaque membre de la famille et tous de louer, au moins pendant les premiers mois, cette joie de vivre que Pauline répand autour d’elle, souriant, soulageant, se mettant à l’entière disposition de ses tuteurs dont elle illumine le triste quotidien.
Même Lazare, l’ombrageux, se surprend à rire, distrait qu’il est par cette petite cousine qui le bouscule et le sollicite dans ses jeux de garçon manqué, brusque, mais toujours affectueuse et dévouée, prompte à lui sauter au cou à la moindre occasion avec son entrain primesautier.
Chanteau, souffrant et « gueulant » pour avoir cédé à son irrépressible gourmandise et en payant le prix dans d’atroces souffrances, a trouvé en Pauline une garde-malade idéale et Eugénie Chanteau, rassurée par les titres, rangés sous clé dans un tiroir, est bien décidée à faire prospérer la fortune de sa pupille.
Ah, l’Argent !
Cette ancienne fille de bonne famille, qui n’a jamais accepté la ruine, aigrie et d’une cupidité sans bornes, a aussi un talon d’Achille : son fils Lazare pour qui elle nourrit de riches ambitions et qui à son grand dam, n’en fait qu’à sa tête, passionné de musique alors qu’elle le verrait bien préfet ou juge , « une carrière d’honnête homme ».
Lazare, chez qui les idées se pressent et s’accumulent, changent et s’échangent, encombrant son esprit, à l’image de sa chambre en désordre, où règne un fouillis indescriptible, ne sait pas se fixer : emporté par les soubresauts de sa volonté, velléitaire incapable de réaliser ses aspirations, il vogue toujours vers de nouveaux rivages, changeant de plan tous les trois mois.
Un ennui et une insatisfaction chronique qui vont accélérer les choses : du magistrat espéré par sa mère, au compositeur de musique raté, du médecin au chimiste exploitant le varech « qui doit rapporter des millions » à la construction d’un barrage pour retenir la mer.
Mais ce dernier projet en date a un coût : la valse lente et régulière du pactole de Pauline a commencé, un émiettement qui ne s’achèvera qu’à la dernière mesure, 20 ans plus tard...Qu’en restera -t-il ?
Et le vent tourne : Madame Chanteau prend en grippe celle qui « s’arracherait le cœur » pour faire le bonheur de son cousin :
« Même en donnant son argent, Pauline se sentait moins aimée qu’autrefois, c’était donc possible? La charité ne suffisait pas, on pouvait aimer les gens et faire le malheur ? Car elle voyait son cousin malheureux, peut-être par sa faute ?
« Madame Chanteau exécrait Pauline de tout l’argent qu’elle lui devait , de même qu’elle exécrait la maladie comme l’ennemie, la gueuse qui avait gâché son existence, ruiné son fils, tué son ambition. »
À l’instar du village rongé par la mer et battu par les vents, dont la jeune fille serait le batelier sacrificiel, c’est tout l’écrasement d’une famille que Zola, en démiurge cruel et cynique, nous dépeint dans un tableau d’une violence, d’une noirceur et d’une désespérance inouïes, et les douleurs de l’enfantement, revêtent sous sa plume l’aspect d’une abominable torture, où la femme met bas, telle une bête, dans d’effroyables contorsions.
« Ce n’étaient plus seulement des efforts, tout son corps s’ébranlait, il lui semblait qu’on la fendait à l’aide d’un couperet très lourd, comme elle avait vu séparer les bœufs dans les boucheries . Sa rébellion éclata si violente, qu’elle échappa à sa cousine et que l’enfant glissa des mains du docteur. »
Il semble que Zola, terrorisé à l’idée de la mort, ait voulu, par ce roman, cette «machine à broyer les rêves et les espoirs», exorciser ses propres démons, apaiser un peu ses angoisses et ses obsessions : les cauchemars de Lazare sont aussi les siens, et le baume que verse Pauline, cet ange d’optimisme et d’amour, sur les souffrances, s’il est bien réel, n’en reste pas moins une goutte d’eau dans la mer, nous laissant abasourdis et sous le choc.
« Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance » : telle était l’inscription qui accueillait les damnés dans l’«Enfer» de Dante.
La première phrase de Zola donne le ton, illustrant le pessimisme d’un noir d’encre, qui va peser comme une chape de plomb sur tout le roman :
« Comme six heures sonnaient au coucou de la salle à manger, Chanteau perdit tout espoir. »