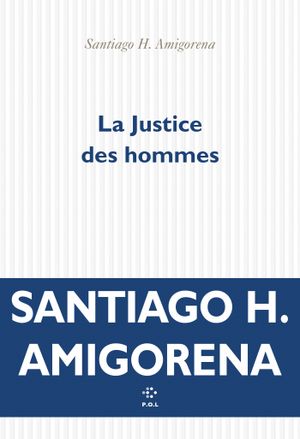Depuis combien de temps ne suis-je pas venu ici ? Lire ce qui se dit, des livres, des films, des albums ? Combien de temps surtout, n'ai-je pas écrit ? J'ai, je ne le sais que trop bien, une pratique solitaire de l'écriture. Même quand il s'agit de commenter. Au fond, longtemps, ici, il s'agissait pour moi, en même temps que je partageais mes engouements, de remuer le couteau dans la plaie. C'est que les œuvres qui me plaisent, celles que je veux défendre, sont en général celles qui me font mal. Celles qui me renvoient à ma faiblesse, à ma lâcheté, à mon incapacité à me sortir de ma solitude. L'écriture devrait être cela, une ouverture à l'autre, ménagée en soi pour l'autre. Mais je suis de ceux qui ruminent trop leur culpabilité pour se sentir encore digne des autres. Pourtant, je sors de mon silence. Un silence long de plus de 200 livres dont je n'ai pas parlés.
La justice des hommes est de ceux-là.
Amigorena nous donne à voir un homme rongé par sa culpabilité. En premier lieu parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il porte en lui, de ce que les autres projettent en lui, des sacrifices qu'ils font. Il se rêve écrivain mais n'écrit pas. Ça pèse, ça envenime, une œuvre qui ne sort pas. En deuxième lieu à cause d'un moment d'égarement. Ce moment, ça aurait pu n'être rien, il a couru, la nuit, ses enfants dans les bras, après sa femme. Après leur mère. Les a posés, s'est perdu dans la foule, hurlant le prénom de sa femme. Quand il est revenu retrouver ses enfants là où il les avait posés, il trouve des policiers qui les embarquent, s'énerve, se débat, se retrouve en prison pour 9 mois. Je ne spoile rien, c'est le premier chapitre.
Maintenant je spoile.
Comment vit-on avec la culpabilité ? Comment vit-on avec la certitude d'avoir détruit ce qui comptait le plus à ses yeux, non pas seulement par inadvertance, un soir, pris par un coup de folie, en courant dehors après sa femme, sa famille dans les bras, mais par obstination, en refusant de voir jusqu'à cette nuit lamentable que ces trois êtres valaient plus que tout le reste ? Le personnage, j'ai oublié son nom, se terre dans le silence. Il se mure. Il s'enferme. Ce silence, il ne se l'explique pas et on se l'explique mal. Le réduire à la culpabilité ou à l'envie de disparaître ne suffit pas, en faire une mortification non plus, il y a quelque-chose d'animal, de dégradant, pour lui comme pour ceux à qui il oppose ce silence. Ce silence dégrade sa femme, son couple, il le prive d'humanité, il est un rejet féroce du monde. Ce n'est pas un silence méditatif, il n'apporte aucune lumière, c'est une rumination agressive. Il en sort comme un animal, dangereux, qui aboie, qui mord, dont il faut se défendre.
Se défendre de cet homme qui n'en est plus un, de ce mari qui n'en est plus un, de ce père qui ne l'a peut-être jamais vraiment été. C'est ce que va faire son épouse, poussée en ce sens par sa sœur, avocate. Il est dangereux, il est imprévisible, il représente un risque pour toi et pour tes filles. C'est là que le livre tire son titre. La justice des hommes est d'abord la volonté de judiciariser les relations humaines, d'intégrer dans les échanges intimes les mots de la justice, son rythme, ses exigences. Non content de devoir se débattre avec une langue qu'il n'a pas utilisée pendant 9 mois, il doit en plus lutter avec un langage technique qui lui échappe et fait échapper son vécu, ses émotions, dans des mots qui ne traduisent rien d'intime mais prétendent en juger. Ce silence qui était le sien, peut-être, se comprend mieux en face de cette langue froide : l'incapacité des mots à exprimer et à traduire ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu et perdu sans s'en rendre compte. Le livre s'ouvre en effet sur une dispute, sur une défaite des mots, sur l'incapacité à parler avec l'autre, à le faire rester, à se faire comprendre. Cette débâcle des mots dans l'intimité ouvre à une violence juridique des mots et à un silence qui devient le moyen de manifester l'absence de communication depuis longtemps établie et l'hostilité depuis longtemps larvée. Mais ce silence, comment en sortir autrement que dans ces colères qui explosent à chaque tentative de conciliation ?
C'est un talent que de parler. Je m'en rend compte. Parler, ce n'est pas simplement utiliser des mots pour se faire comprendre, c'est autre chose, parler, c'est retors. Se faire comprendre n'est peut-être même pas l'essentiel. L'essentiel, toujours, a été de dire ce qu'il faut, ce qui est attendu compte tenu de la situation. L'aisance à parler, quelque soit la situation, est un privilège de classe. Ou une habitude de comédien. Dire ce qu'il faut à une fête, à un entretien d'embauche, deux situations dans lesquelles je n'ai cessé de me retrouver ces derniers temps, je n'y arrive pas, je préférerai garder le silence dans ces situations, qu'on m'autorise à ne pas parler. Mais trouver le bon silence, y arriverai-je ? Ce n'est pas donné à tout le monde de garder le silence sans disparaître, sans se rendre hostile, d'être dans un silence qui fait être là juste ce qu'il faut, autant qu'il le faut dans une ouverture absolue. C'est cette qualité de silence que trouve le personnage mutique et perdu auprès de son bailleur quand il trouve un appartement. Un appartement miteux qu'il va retaper. C'est un peu cliché de faire le ménage pour faire le ménage dans son esprit, de retaper un appartement pour se reconstruire. De se Pascal-le-grand-frèriser ou de se Marie-Kondoïser tout seul, mais les bons romans survivent aux quelques clichés qu'ils ont la coquetterie d'exploiter. Parce qu'au fond, ce passage M6 D&co n'est là que pour opposer à ce silence agressif cet autre silence, positif, accueillant, plein de compréhension et d'acceptation, un silence qui s'accompagne de gestes de soutien et d'actes d'entraide. Un silence qui est une justice humaine, qui répare plus qu'il ne condamne.
Mais le prix a payer pour atteindre un tel silence, disons-le, une telle sainteté, est trop lourd pour le désirer. On ne peut être humain qu'à ses dépends, peut-être, ou par sursaut. Après avoir été frappé d'indignité. Après s'être retrouvé en proie à une de ces nombreuses dialectiques entre parole et silence, innocence et culpabilité. Je n'en dirai rien de plus. Mais cela joue dans la libération du personnage, comme joue les longues conversations qu'il tient, mais dont on ne saura rien, sur lesquelles il sera fait silence mais dont on pressent que ces conversations sont autant de pardons réitérés. Ce pardon qui se dit sans se dire, peut-être est-ce là réellement ce qu'est la justice. C'est en partie ce que dit Geoffroy de Lagasnerie dans Se méfier de Kafka. Lagasnerie propose une lecture anarchisante de Kafka et affirme que, pour Kafka, ce qui produit la culpabilité n'est pas la faute, mais sa judiciarisation. La machine judiciaire, le procès, le tribunal, le juge, transforment le fauteur en coupable, essentialisent un acte : le fauteur, devenu coupable, l'est profondément et définitivement aux yeux de tous, il devient un atome de culpabilité alors que la culpabilité qu'il endosse est en réalité sociale, diffuse, le fait de tous. Joy Sorman, dans ce mauvais livre qu'est Le témoin, montre bien cela, que la société rejette sa propre responsabilité sur quelques individus que l'on va charger, dans tous les sens du terme, parce qu'ils ne peuvent s'en défendre. Ce silence de 9 mois est-il aussi un moyen de refuser d'être un prisonnier ? Non pas une prison, mais un retrait au centre de la prison, un trou dans lequel s'évader, un moyen de ne pas participer de ce lieu, de n'y être pas. Il y a je crois dans ce silence un refus de reconnaître sa culpabilité, de la rejeter. C'est étrangement proche, ce qu'écrit Sorman, parce que le témoin qu'elle nous donne à voir fait lui aussi vœu de silence. Évoque aussi Kafka. Un silence observateur, d'abord, puis accusateur. Quel dommage qu'elle ait ruiné son texte avec le dernier chapitre … Mais, si judiciariser la faute n'est pas rendre justice, comme rendre une justice humaine ? Suivant Lagasnerie et Kafka, en connaissant les hommes et en s'intéressant à eux personnellement, en les aimant. On ne judiciarise pas la faute de nos proches, nos proches, on les prend entre quatre yeux pour leur dire que leur conduite nous blesse, pour essayer de comprendre, pour proposer des manières de réparations. Comme la mère avec son enfant, comme le Ho'oponopono, version originale, pas cette espèce de prière naïve faite à l'univers. Ho'oponopono est une intervention, une psychanalyse collective quand le comportement d'un des membres de la communauté blesse les autres : on en discute et on cherche à régler collectivement le souci avec celui qui pose problème, ce qui le rend acteur de la réparation, là où la justice rend le fauteur objet d'une sanction. Mais Lagasnerie nous dit que, le plus souvent, nous haussons les épaules et tolérons quelques écarts.
Bien sûr, je sais ce que tout cela a d'anecdotique aujourd'hui : le silence est rarement celui des coupables, trop souvent celui des victimes. Victimes auxquelles la société refuse le droit de parler, d'être entendues. Victimes qui, sachant que malgré leurs efforts le risque de voir leur bourreau condamné par la justice, n'ont guère comme arme, avec leurs soutiens, que l'effort concerté pour réduire au silence le bourreau intouchable. Mais cette autre dialectique du silence et de la culpabilité, qui met aussi en jeu une responsabilité collective que beaucoup refusent de voir, est l'objet des articles de presse et des tribunes, non des romans que je voulais évoquer ici.