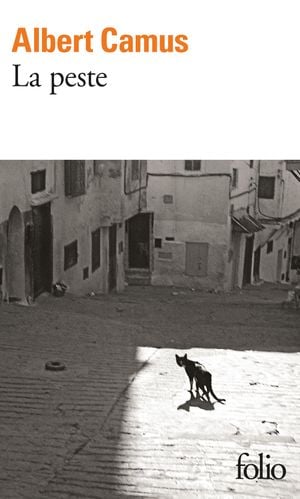Ce que j’aime bien avec Camus, c’est sa façon, sur un ton neutre et avec des mots simples, de nous dire la vérité. Cette vérité, on avait pu la soupçonner auparavant, mais sans forcément parvenir à l´extirper de la linéarité continue de notre quotidien. Camus se sert de cette même linéarité pour mettre pile le doigt dessus_et souvent là où ça fait mal. La peste, faux témoignage détaché de toute forme d’émotion, ne se gêne pas pour nous mettre devant les yeux son lot de vérités sur la nature humaine, mettant son lecteur face à ses personnages (et donc à lui-même): ce que vivent les habitants de la ville d’Oran en temps de peste, n’importe qui pourrait le vivre. Maintenant, peut-être. Dans ce roman, tout le monde est mis au même niveau, sans élus ni damnés, et c’est une erreur de croire que l’on peut échapper au fléau: ce dernier est omniprésent, ronge la ville et ses habitants, avec l’intention de n’en épargner aucun.
Malgré toute la lucidité magnifique dont ruisselle l’ouvrage, il faut cependant tenir bon pour le lire: « La Peste » est empli d’une monotonie pesante, quoique nécessaire: Hormis au début et à la fin, le livre est en effet plongé dans une torpeur permanente, où seul compte le présent, qui se répète jour après jour, adoptant ainsi l’atmosphère de cette ville assiégée. Assiégée, oui, c’est le mot: la peste qui l´accable sera toujours évoquée à la manière d´un ennemi belliqueux, avec lequel il est impossible de traiter (on pense inévitablement au nazisme).
Si on ne peut pas fuir, ni négocier, alors que faire? Chaque personnage aura sa manière d’agir, plus ou moins discutable: celui-ci se réfugiera dans la foi, préférant remettre sa destinée entre les mains de Dieu, celui-là choisira d’abord la fuite vers un amour idéalisé, cet autre refusera de voir les choses en face avant la mort de son enfant, cet autre encore se réjouira de la situation, qui lui fera se sentir l’égal des autres dans le mal. Et puis on aura le « héros », médecin de profession, qui, lui, ne se bat au nom d’aucune idée, d’aucun idéal plus grand que lui. Soigner les gens est son métier, et l’heure est grave, alors simplement, il constate ce qui se passe, et fait ce qu’il y a à faire, d’abord pour les soins à apporter, ensuite pour le « devoir » de témoigner de ce qu’il a vécu, afin d’aider ceux qui lui succèderont. Tout ce qui compte, c’est ce qui se passe ici, maintenant, et l’action qui doit en découler. Le reste n’est qu’objectifs incertains et principes inadaptés à la situation (c’est d’ailleurs là que la « neutralité » du livre trouve ses limites: si le narrateur ne prend pas parti, l’auteur si, et on peut le constater en voyant quels personnages s’en tirent le mieux à la fin: ils correspondent à l’idéal humain de Camus, celui de l’homme qui accepte sa condition limitée, tout en l’affrontant).
Camus, comme ses protagonistes, n’a pas pour but de changer la face du monde; il se contente d’observer, d’agir quand c’est nécessaire, puis d’informer. Il espère ainsi que les gens sauront, à défaut de pouvoir toujours agir. L’homme est prisonnier de l’existence depuis le départ; mais le fait qu’il prenne conscience de cet emprisonnement est déjà une victoire; et le fait qu’il tente d’agir sur cette même condition, même si la lutte est vouée à l´échec, et que le résultat final ne peut en être que la mort, est une victoire encore plus grande.
Mais lui, Rieux, qu’avait-il gagné? Il avait seulement gagné d’avoir connu la peste et de s´en souvenir, d’avoir connu l’amitié et de s’en souvenir, de connaître la tendresse et de devoir un jour s’en souvenir. Tout ce que l´homme pouvait gagner au jeu de la peste et de la vie c’était la connaissance et la mémoire. Peut-être était-ce cela ce que Tarrou appelait « gagner la partie »!