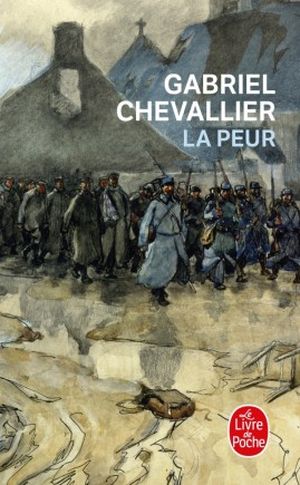Un (long) extrait pour vous éviter une médiocre critique:
Les artilleries tonnent, écrasent, éventrent, terrifient. Tout rugit,
jaillit et tangue. L’azur a disparu. Nous sommes au centre d’un remous
monstrueux, des pans de ciel s’abattent et nous recouvrent de gravats,
des comètes s’entrechoquent et s’émiettent avec des lueurs de
court-circuit. Nous sommes pris dans une fin du monde. La terre est un
immeuble en flamme dont on a muré les issues. Nous allons rôtir dans
cet incendie…
Le corps geint, bave et se souille de honte. La pensée s’humilie,
implore les puissances cruelles, les forces démoniaques. Le cerveau
hagard tinte faiblement. Nous sommes des vers qui se tordent pour
échapper à la bêche.
Toutes les déchéances sont consommées, acceptées. Être homme est le
comble de l’horreur. Qu’on me laisse fuir, déshonoré, vil, mais fuir,
fuir… Suis-je encore moi ? Est-ce moi cette gélatine, cette flaque
humaine ? Est-ce que je vis ?
— Attention, on va sortir !
Les hommes blêmes, privés de raison, se redressent un peu, ajustent
leur baïonnette au fusil. Les sous-officiers s’arrachent des
recommandations de la gorge, comme des sanglots.
— Frondet !
Mon camarade claque des dents, ignoble : ma propre image ! Le
lieutenant Larcher est au milieu de nous, crispé, cramponné à son
grade, à son amour-propre. Il grimpe sur la banquette de tir, montre
en mains, se tourne :
— Attention, les gars, on y va…
Les secondes suprêmes, avant le saut dans le vide, avant le bûcher.
— En avant !
La ligne ondule, les hommes se hissent. Nous répétons le cri : « En
avant ! » de toutes nos forces, comme un appel au secours. Nous nous
jetons derrière notre cri, dans le sauve-qui-peut de l’attaque…
Debout sur la plaine.
L’impression d’être soudain nu, l’impression qu’il n’y a plus de
protection. Une immensité grondante, un océan sombre aux vagues de
terre et de feu, des nuées chimiques qui suffoquent. Au travers, des
objets usuels, familiers, un fusil, une gamelle, des cartouchières, un
piquet, d’une présence inexplicable dans cette zone irréelle.
Notre vie à pile ou face ! Une sorte d’inconscience. La pensée cesse
de fonctionner, de comprendre. L’âme se sépare du corps, l’accompagne
comme un ange gardien impuissant, qui pleure. Le corps paraît suspendu
par une ficelle, comme un pantin. Rétracté, il se hâte et trébuche sur
ses petites jambes molles. Les yeux ne distinguent que les détails
immédiats du terrain et l’action de courir absorbe les facultés.
Des hommes tombent, s’ouvrent, se divisent, s’éparpillent en morceaux.
Des éclats nous manquent, des souffles tièdes nous dominent. On entend
les chocs des coups sur les autres, leurs cris étranglés. Chacun pour
soi. Nous courons, cernés. La peur agit maintenant comme un ressort,
décuple les moyens de la bête, la rend insensible.
Une mitrailleuse fait son bruit exaspérant sur la gauche. Où aller ?
En avant ! Là est le salut. Nous attaquons pour conquérir un abri. La
machine humaine est déclenchée, elle ne s’arrêtera que broyée.