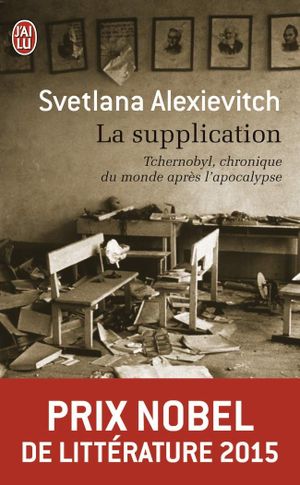Le 26 avril 1986, la centrale de Tchernobyl explosait. Du jour au lendemain, ce nom jusqu’alors inconnu est revenu sur toutes les lèvres, fit la une des journaux télévisés du monde entier. Ou presque. Car si l’occident a suivi la situation d’heure en heure et a scruté l’avancée du nuage radioactif en espérant qu’il stoppe sa progression avant d’atteindre nos frontières, le pouvoir soviétique a tenté par tous les moyens de tuer dans l’œuf tout mouvement de panique.
Svetlana Alexievitch est biélorusse. Et en tant que telle, elle est une ancienne russe, une ancienne soviétique. Son pays est le plus touché par la catastrophe. J’ai manqué d’écrire « a été le plus touché » avant de me reprendre et de rétablir le présent de l’indicatif. Car les conséquences de l’événement sont toujours actuelles. Et devraient le rester encore quelques milliers de siècles. L’auteur nous informe que 20% du territoire national est contaminé et qu’un quart des habitants vivent en zone irradiée.
En guise de prologue, Svetlana Alexievitch donne la parole à l’épouse d’un pompier de Tchernobyl. L’homme fut l’un des tout premiers à se rendre sur les lieux de l’accident. Dans l’ignorance totale de ce qu’il s’était passé. Sans aucune idée des risques qu’il encourait à obéir à l’ordre qui venait de lui être donné. Sans équipement et durant toute la nuit, le pompier a ratissé la matière radioactive en fusion, ramassant les barres de graphite à mains nues. Son agonie aura duré quatorze jours. Quatorze jours insupportables contés dans le détail par son épouse enceinte qui a dû cacher son état pour avoir une chance d’accompagner son mari dans ses dernières souffrances.
Après une telle introduction, le lecteur entame le premier chapitre avec le cœur au bord des lèvres. Et la seconde couche ne tarde pas apparaitre avec les témoignages de ceux qui vivent encore sur place. Dans la zone interdite elle-même ou à proximité immédiate. Et pour diverses raisons. Parce qu’on nous a caché le réel danger à rester chez soi. Parce qu’on n’imagine pas aller vivre ailleurs que sur la terre de ses ancêtres. Parce qu’on n’a nulle part ailleurs où aller. Parce qu’on vivait tellement mal l’exile et le déracinement qu’on a fini par revenir chez soi. Parce que le pouvoir nous avait envoyé là et qu’on n’imaginait pas désobéir aux ordres. Parce qu’on fuyait une situation pire encore et que la proximité de la centrale détruite nous assurait une certaine tranquillité…
Le peuple soviétique n’a pas de conscience individuelle. L’individu ne pèse rien face à l’intérêt de communauté. Personne n’imaginait protester lorsque le parti désignait les volontaires. On se contentait de répondre à la convocation. On était même fier d’avoir été choisi pour monter chaque mois sur le toit du réacteur remplacer le drapeau flamboyant d’Union soviétique bruler par les radiations. Heureux d’être ainsi hissé sur le devant de la scène, d’exister durant un bref instant en tant qu’individu et non plus seulement comme membre anonyme d’une communauté. Heureux de toucher une prime dérisoire qui nous permettra, au retour, de nous rendre en Crimée, sur la côte de la mer noire, acheter une voiture, déménager…
Mais si certains veillent à ne pas trop réfléchir, d’autres s’inquiètent. De nombreuses femmes avouent avoir peur de leur compagnon. Peur de ces bras qui les enlacent dans un moment de désir. Peur de faire l’amour et de tomber enceinte. Terreur à peine avouable de donner naissance à un enfant malade, souffrant de graves malformations ou même mort-né. La douleur des parents devant choisir entre empoisonner sciemment leurs enfants en leur donnant à manger de la nourriture contaminée, et les laisser mourir de faim. Détresse de ceux qui ont connu le terrible front de l’est durant la seconde Guerre Mondiale, la sanglante dictature stalinienne et qui étaient persuadés de ne jamais rien connaitre de pire. Et la sempiternelle peur de l’autre.
J’ai manqué dix fois d’interrompre ma lecture, ne supportant plus ce que je lisais. Mais je me devais d’écouter les voix de ces petites gens, ces voix que jamais personne n’avait écouté avant que Svetlana Alexievitch n’aille les interroger un à un dix ans après la catastrophe. Ceux auquel le pouvoir soviétique a menti afin de sauvegarder les apparences, conscient que l’explosion du réacteur pouvait suffire à faire exploser le communisme dans son ensemble. Je n’ai pas eu la force (ou la faiblesse) de fermer les yeux, de me boucher les oreilles. J’ai poursuivi jusqu’à son épilogue cette lecture très difficile afin d’écouter ces gens qui, pour beaucoup, se confiaient pour la première fois.
A lire !