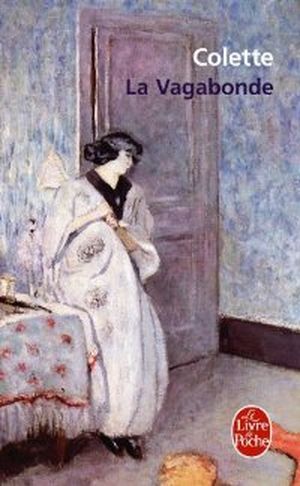"La Vagabonde" et "L'entrave", dyptique de l'antagonisme au féminin, est le roman du choix douloureux, voir impossible, entre deux aspirations contraires.
La légèreté angoissante de la solitude contre le confort narcotique de l'union.
Comme toujours chez Colette, le choix du titre n'est pas anodin. La liberté devient vagabondage, l'attache se fait entrave.
Avant même la première ligne, on se doute que le problème est sans issue.
L'écriture des deux parties du récit encadre le remariage de Colette avec Henry de Jouvenel, baron journaliste et politicien volage.
Elle a 37 ans.
Emancipée du joug de Willy, passée par une période d'intense libération morale et d'excès en tous genres, c'est ne femme faite mais loin d'être revenue des agitations de la passion.
Si les soubresauts de son parcours singulier traversent toute son oeuvre, c'est ici qu'elle dessine avec le plus d'acuité les désirs discordants qui la guident.
Désir d'autonomie, désir d'appartenance. Désir de se voir nouvelle et achevée dans le regard de l'autre, refus de l'image qui emprisonne.
Renée, alter ego au prénom ambigu, oscille sans cesse entre un goût viscéral pour la bohéme, les valises vite bouclées, la douceur rassurante des engagements sans lendemain, et un goût non moins puissant pour les draps bien chauffés aux bras d'un amant souverain.
Elle aime parfois que ces bras-là soient la limite du monde, mais pas toujours et pas très longtemps. Complication sur complication, l'homme a aussi ses humeurs.
La grâce, réduite à peau de chagrin, n'aura plus qu'à se réfugier dans les interstices.
Si la figure de la femme lestée par son corps est centrale, on n'est pas dans une analyse lucide et intraitable à la Beauvoir. Il est bien trop tôt encore, et rien ici n'est entaché de rigidité ou d'idéologie.
Colette fait grandir Renée lentement, par petites touches, sans aucune résonance stéréotypée. L'esquisse se détache et finit par être si vraie qu'elle se suffit à elle-même.
Un des génies de Colette est de n'écraser ses personnages d'aucun discours, d'aucune hyperbole. Elle se tient à leur hauteur.
Assurément marquée par un héritage romanesque classique, elle s'en détache pourtant par ce sentiment de flottaison qui marque toute sa narration.
Pas d'intrigue véritable, pas de dénouement, tout se joue dans l'ordinaire. Renée comme les autres semble toujours suspendue ou errante, ne sachant que faire d'une liberté sans objet.
La fin est au choix une guérison ou un constat d'échec atroce :
"Je le seconde, mais en arrière de lui, ralentie, adoucie, changée. Il me semble, à le voir s'élancer sur la vie, qu'il a pris ma place, qu'il est l'avide vagabond et que je le regarde, à jamais amarrée...".