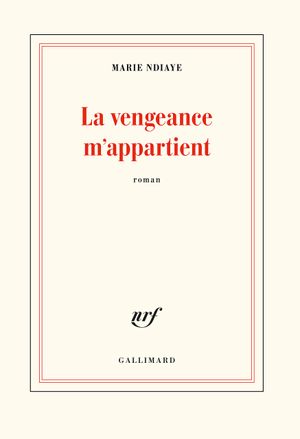Sans jamais avoir lu une ligne de ses livres, je me suis fait du travail de Marie Ndiaye une image assez respectueuse, voire intimidante.
D’abord publiée aux éditions de Minuit (où elle décroche le prix Fémina en 2001 pour Rosie Carpe), puis chez Gallimard, où elle obtient le Goncourt en 2009 pour Trois femmes puissantes, elle est, à 53 ans seulement, à la tête d’une œuvre déjà imposante incluant plus d’une dizaine de romans et recueils de nouvelles, autant de pièces de théâtre et quelques textes pour la jeunesse.
Je ne sais pas si La Vengeance m’appartient est à l’image de son travail passé. Mais si c’est le cas, je ne suis pas sûr d’y revenir.
Je ne nie nullement l’intelligence extrême à l’œuvre dans ce livre, évidente dès les premières lignes. Tout, dans le style de Marie Ndiaye, est pensé, pesé ; c’est bien le livre d’une auteure posée, maîtresse d’une écriture qui se déploie en phase avec son propos.
En l’occurrence, le portrait d’une femme, simplement désignée sous son nom et l’attribut de sa profession, Me Susane. Avocate quarantenaire, sans envergure, dont les débuts à la tête de son cabinet sont laborieux, et qui s’efforce de composer avec les attentes de tous et toutes autour d’elle, à commencer par ses parents, éperdus d’espoir pour elle mais déçus par son manque de réussite flagrant. Même lorsqu’elle hérite d’un dossier criminel de grande envergure, qui va lui causer plus de soucis que de prestige.
Pour développer ce personnage, Marie Ndiaye avance à reculons et par chausse-trappes. Elle nous donne à lire toutes ses réflexions, en particulier tout ce qu’elle n’ose pas dire aux autres. Ce qui donne de longs passages en italiques, explicitant par le détail une pensée qui ne s’exprime jamais.
Le procédé est intéressant, et permet de concrétiser l’immobilisme de la protagoniste, le blocage essentiellement constitutif de son caractère.
S’y ajoute un recours massif aux adjectifs et aux adverbes, comme autant de signaux incarnant les sentiments mêlés et extrêmes de Me Susane.
Un choix qui va à l’encontre d’un des conseils les plus fréquemment adressés aux apprentis littérateurs : proscrivez autant d’adverbes que possible, et méfiez-vous des avalanches d’adjectifs.
Il faut du talent pour s’opposer à cette sage remarque, et Marie Ndiaye, évidemment, n’en manque pas. Pour autant, je ne peux pas dire que j’adhère. Face à une telle débauche, j’ai tendance à subir. Ici, ça n’a pas raté.
Si je comprends les partis pris de la romancière, j’avoue m’être très vite ennuyé. Impossible de me passionner pour les tergiversations de cette anti-héroïne, ni de vibrer à l’écriture de Marie Ndiaye, que j’ai trouvé trop chargée, voire invraisemblable dans certains dialogues.
Qui irait dire (au téléphone, en plus) : « Ce garçon, maman, c’est l’enkystement d’une pure joie ! »
(Je ne sais même pas ce que c’est censé signifier, je l’avoue…)
J’imagine que c’est fait exprès. C’est peut-être même censé être drôle, ou ironique, ou que sais-je encore. Ce genre de subtilités me passe au-dessus de la tête, et je n’ai guère de temps à perdre à me mettre sur la pointe des pieds pour tenter de les attraper.
La Vengeance m’appartient est l’exemple même de texte trop cérébral pour moi, où il me semble que le soin apporté à la forme finit par écraser le propos, par le mettre trop à distance.
Pas le genre de prose qui me parle ni qui me touche, je la laisse sans remords à ses nombreux amateurs et admirateurs.